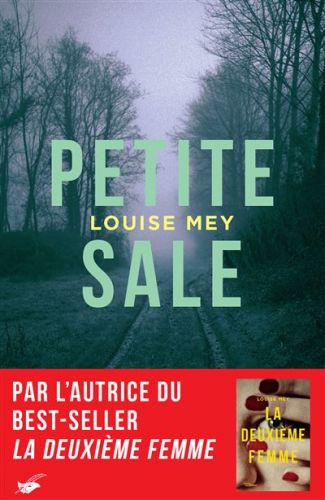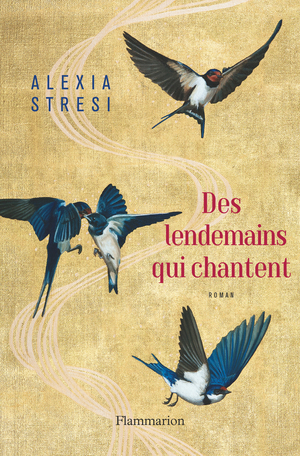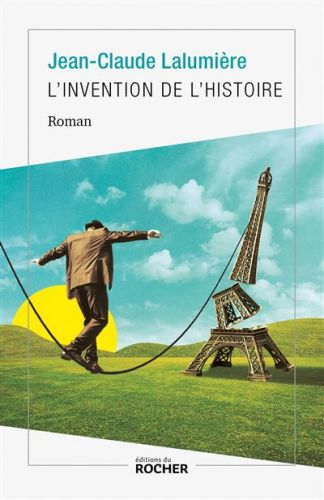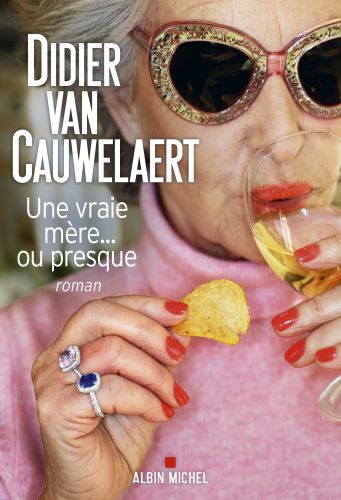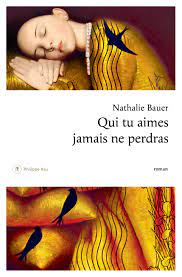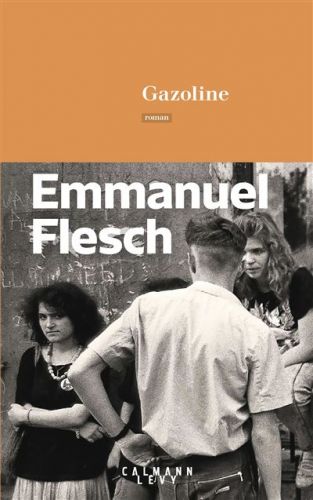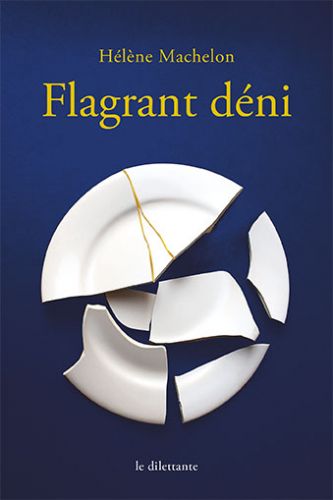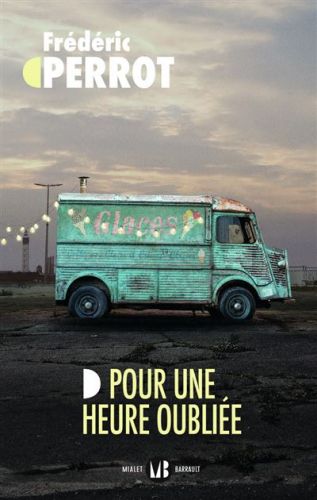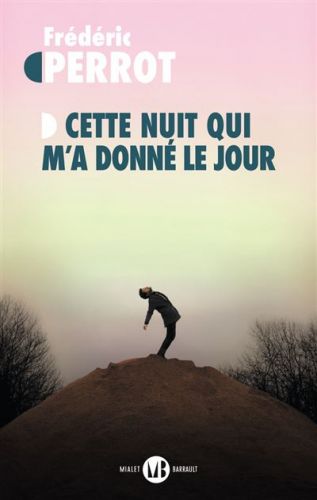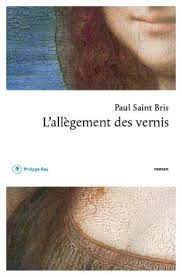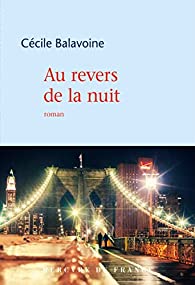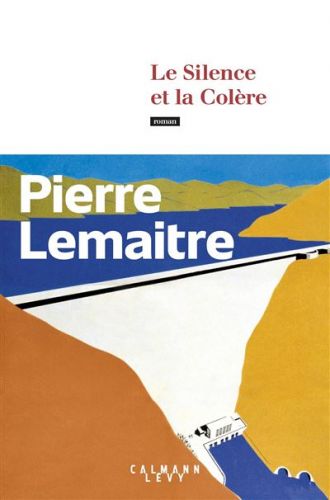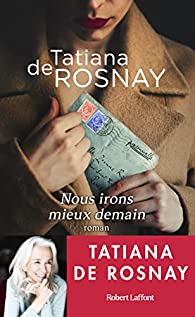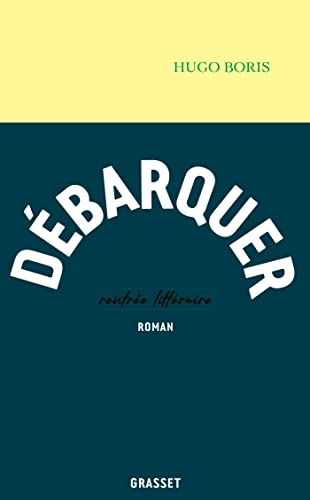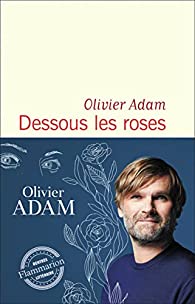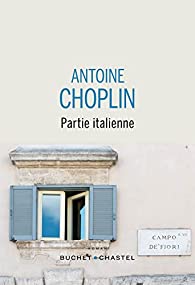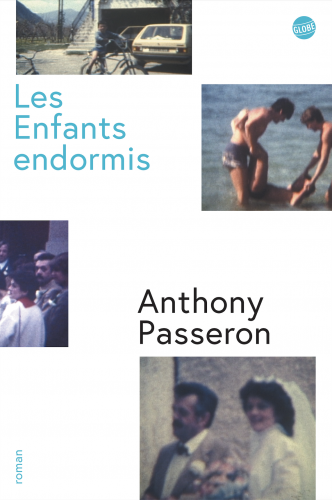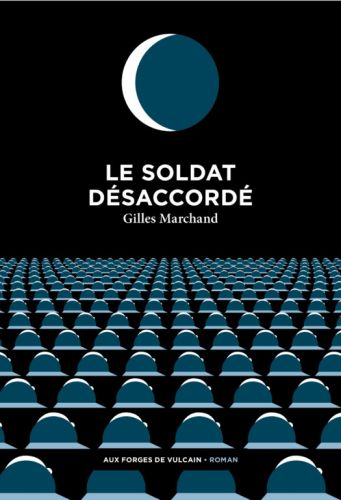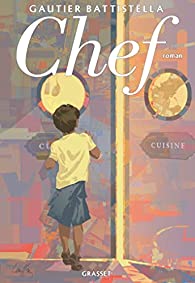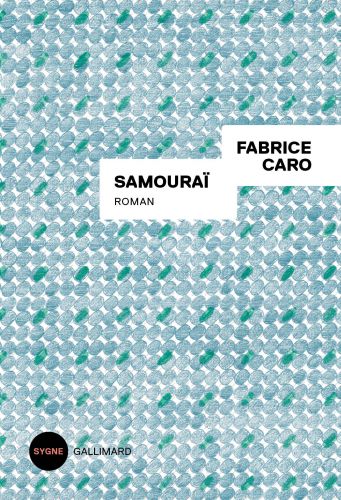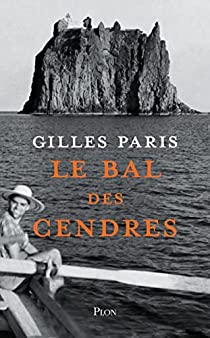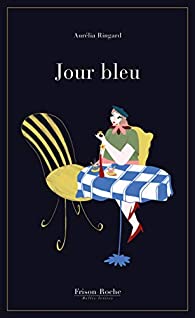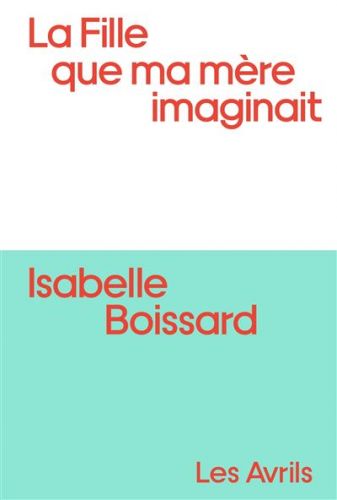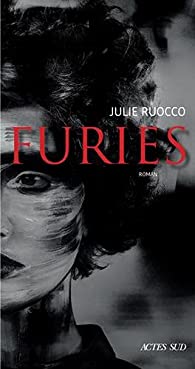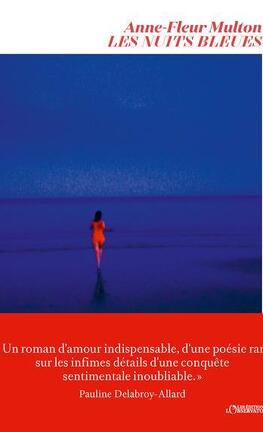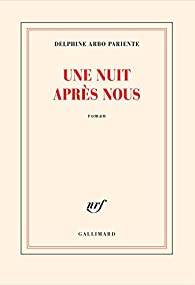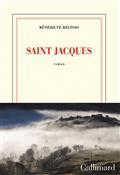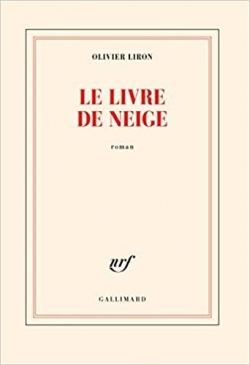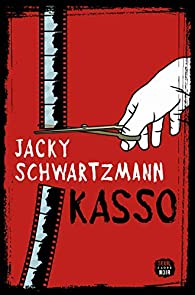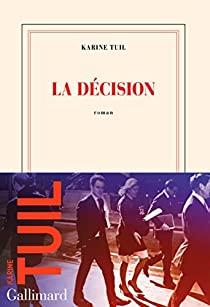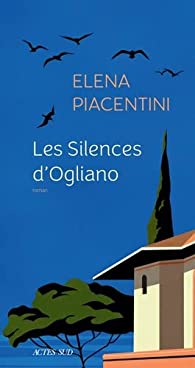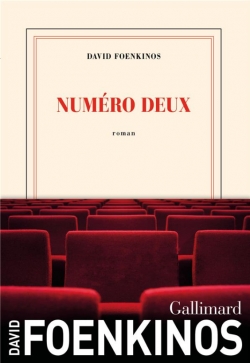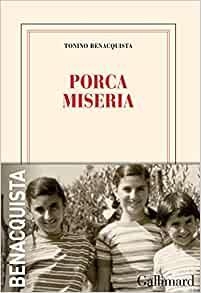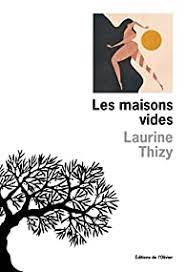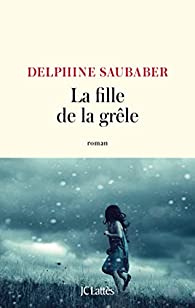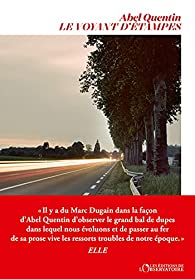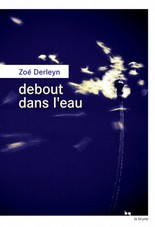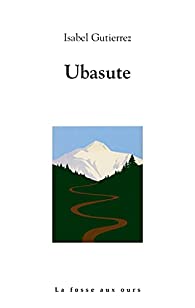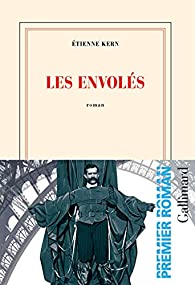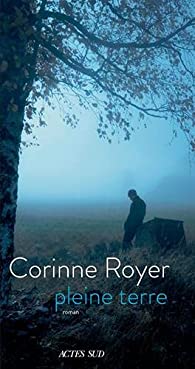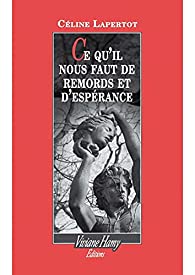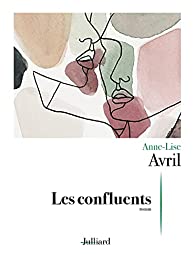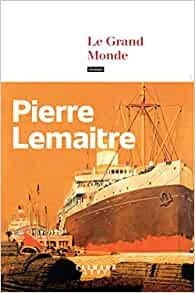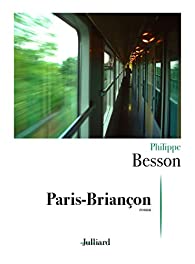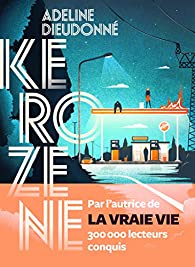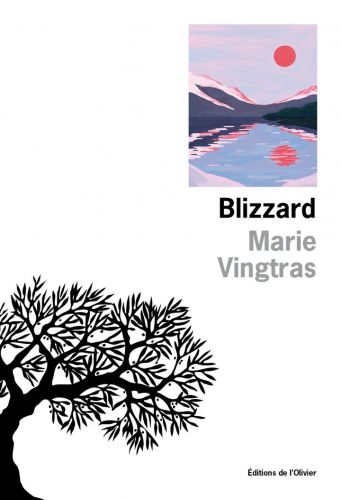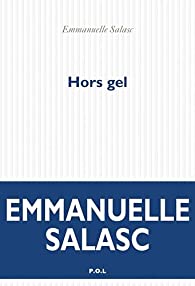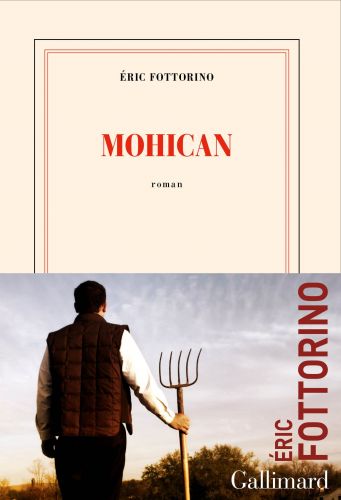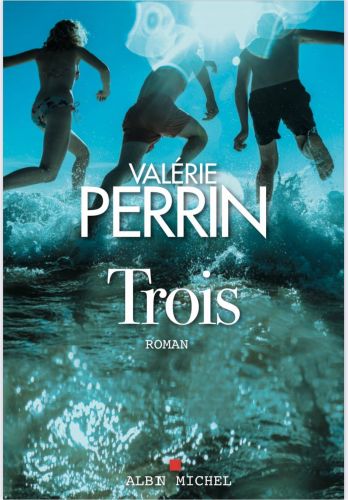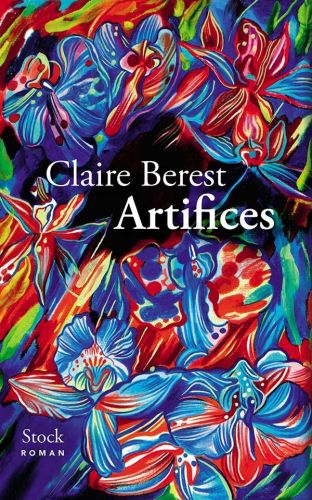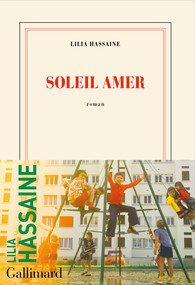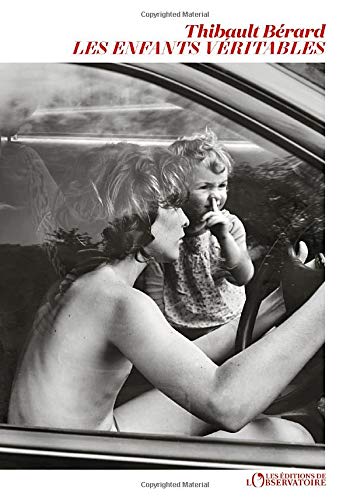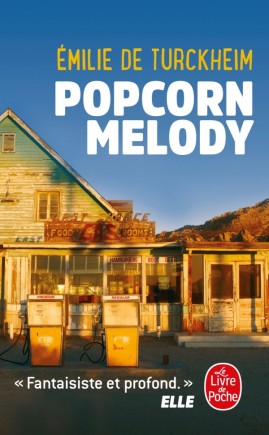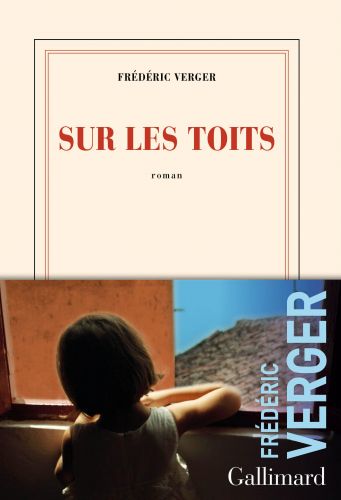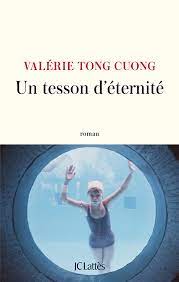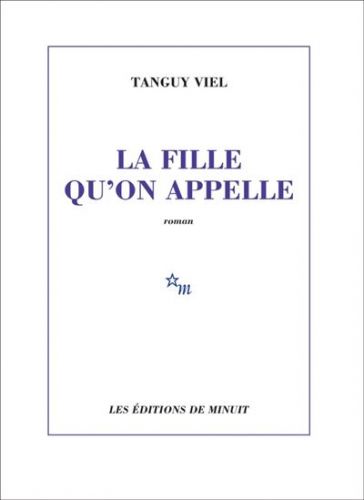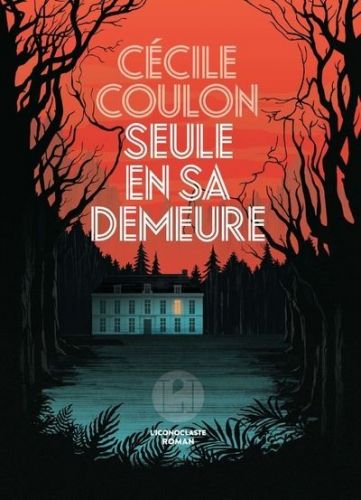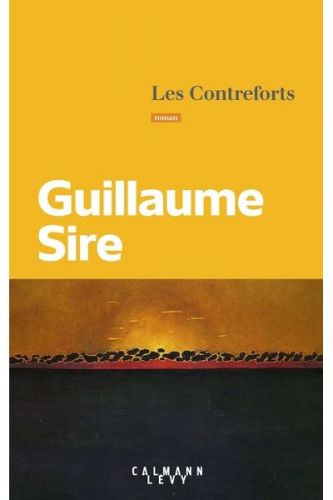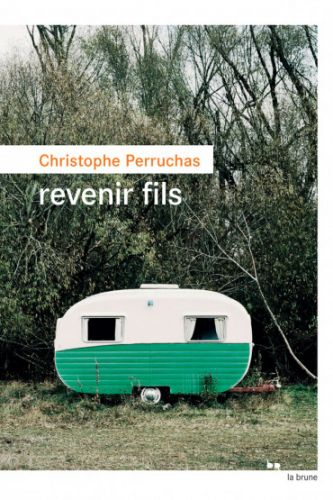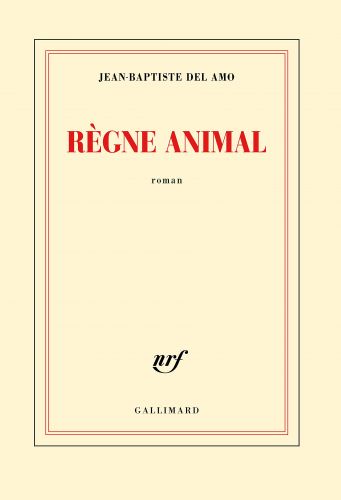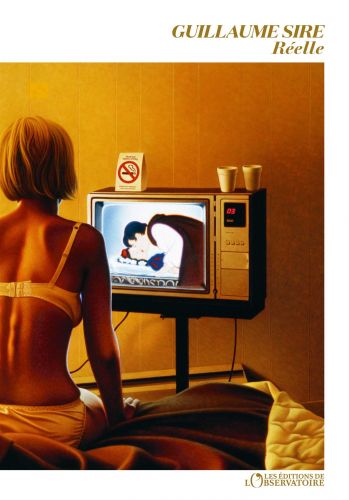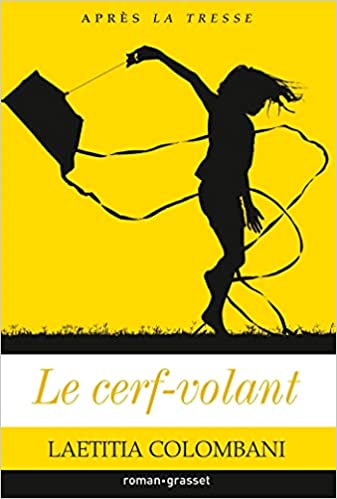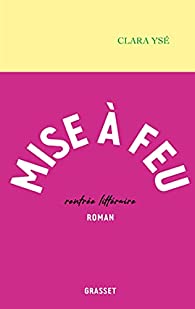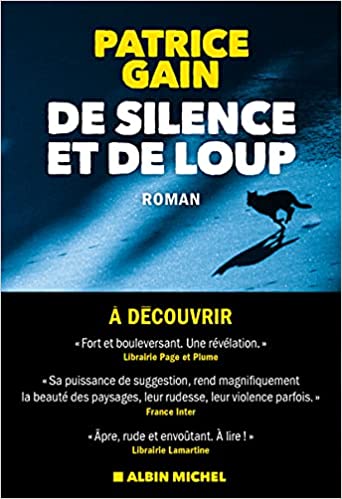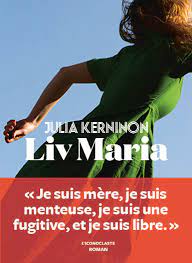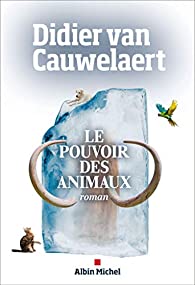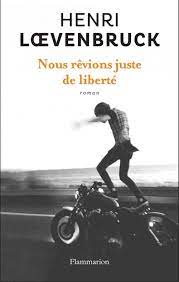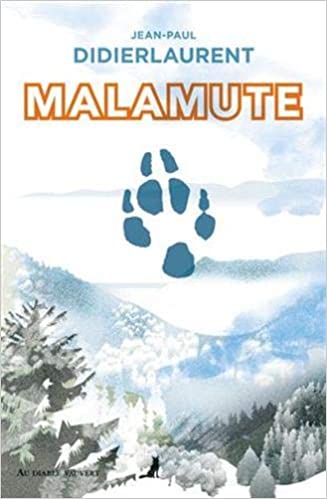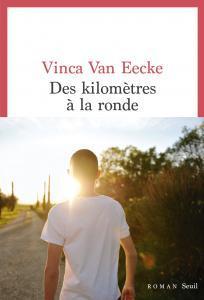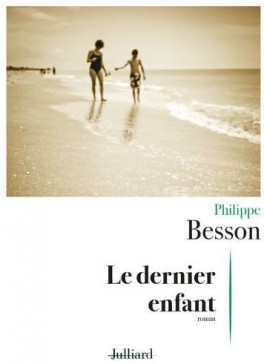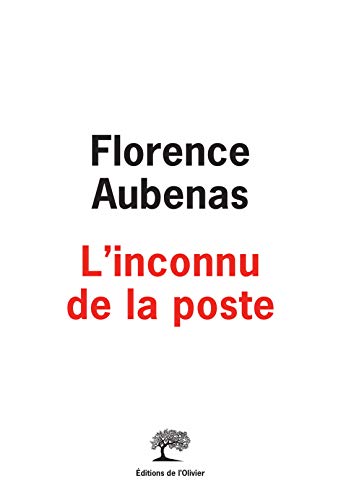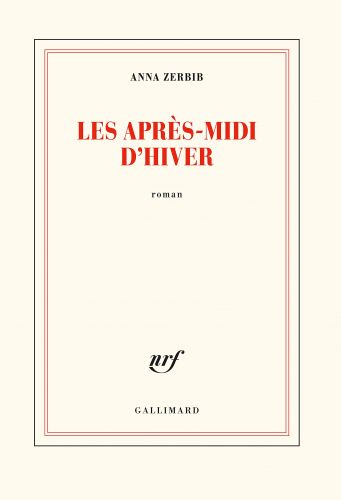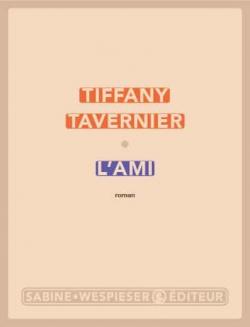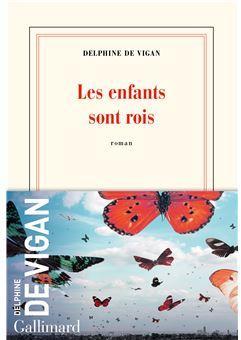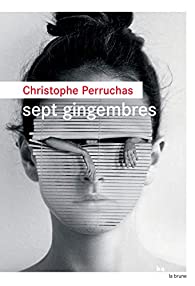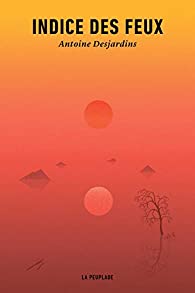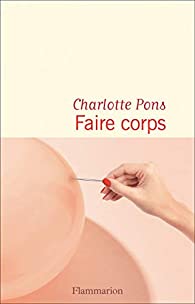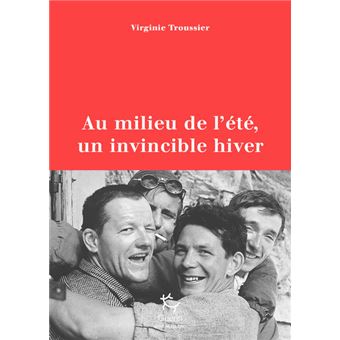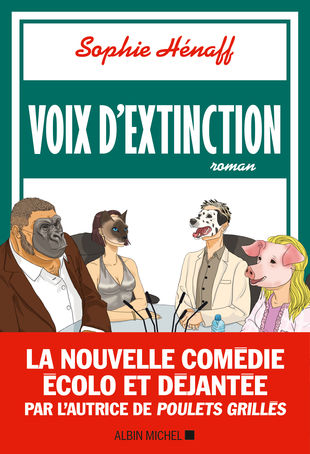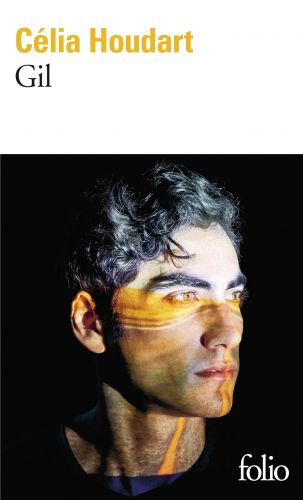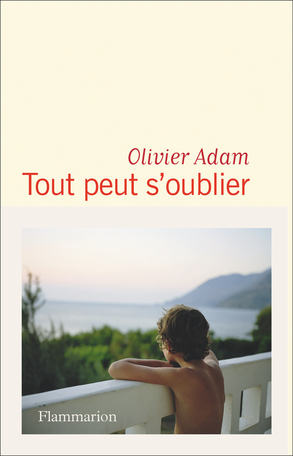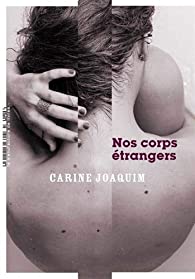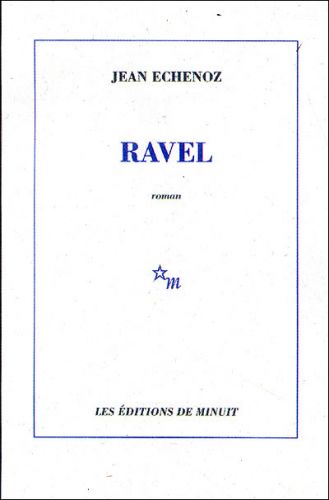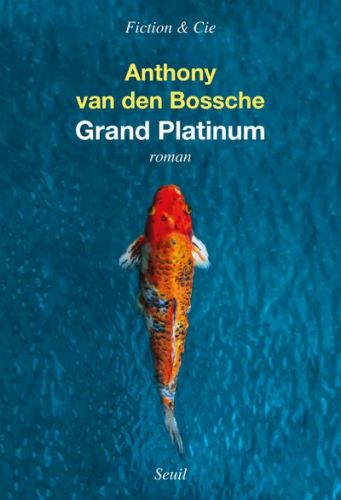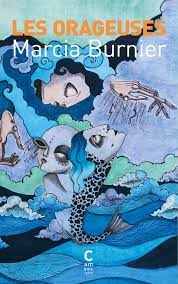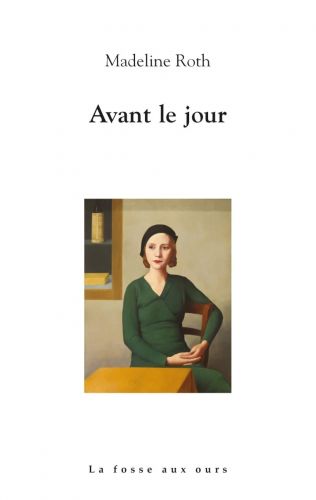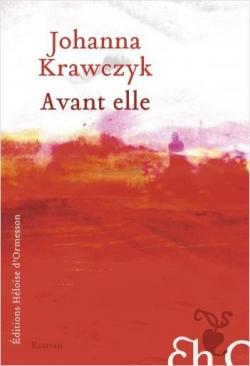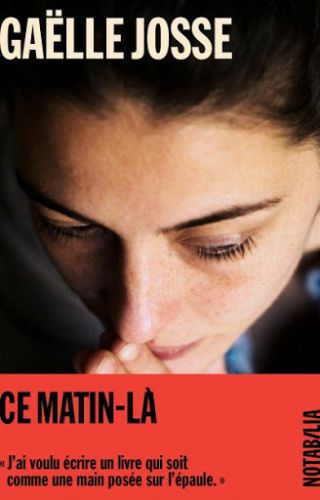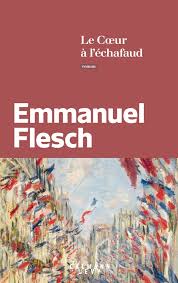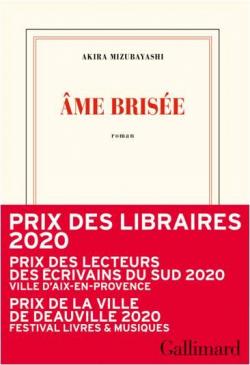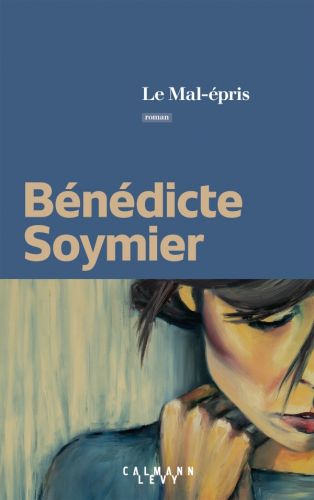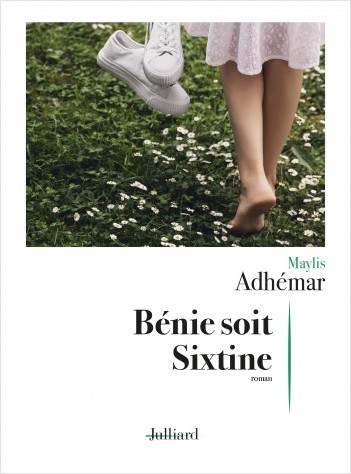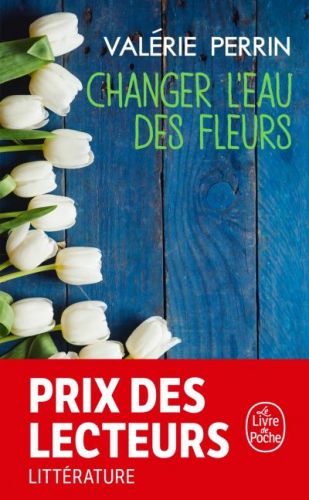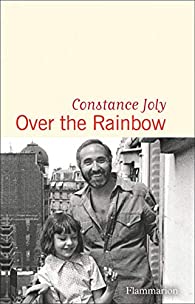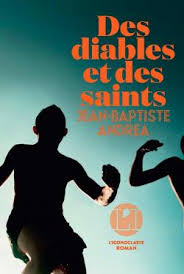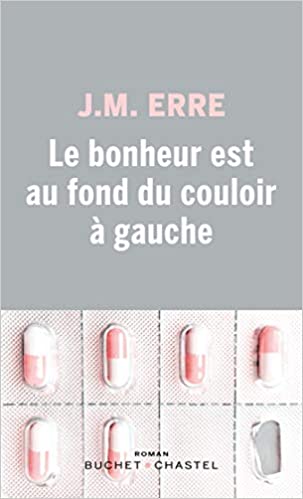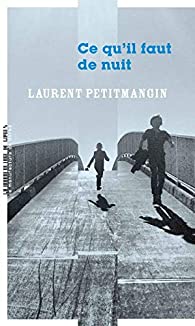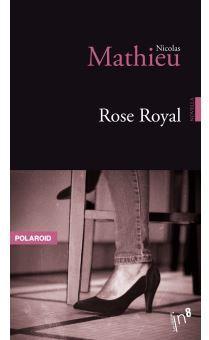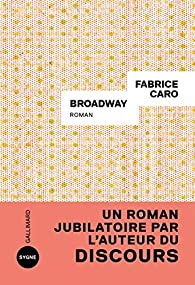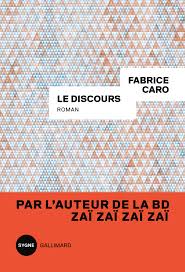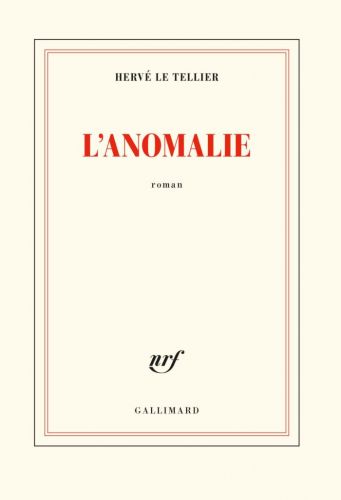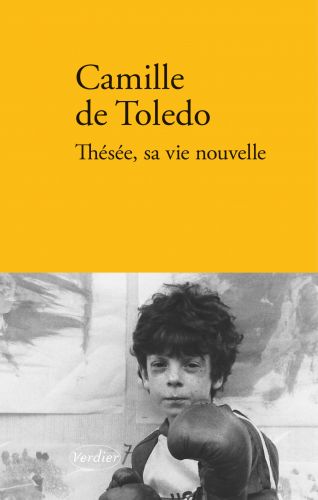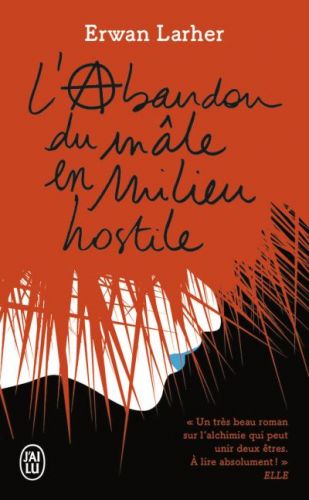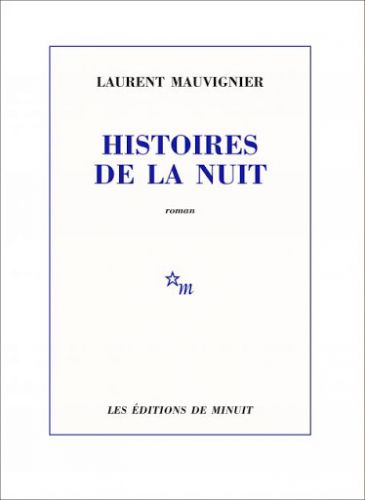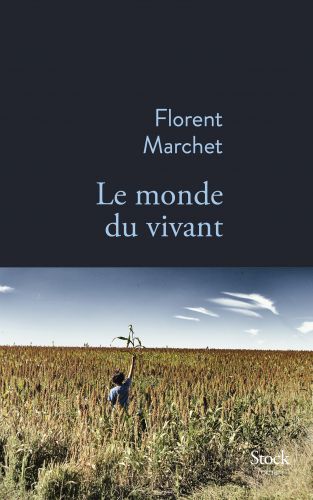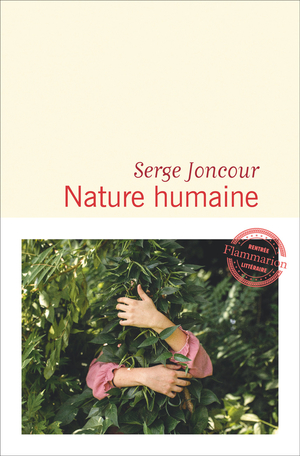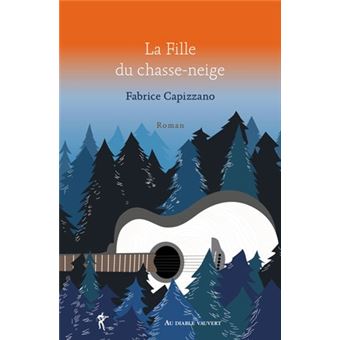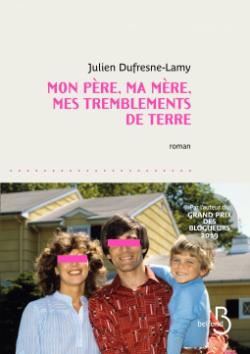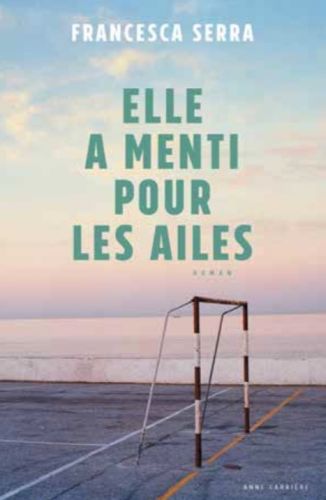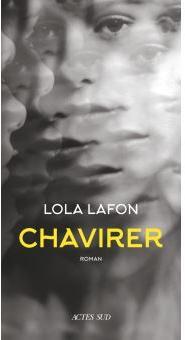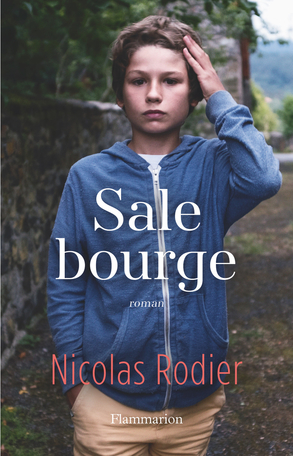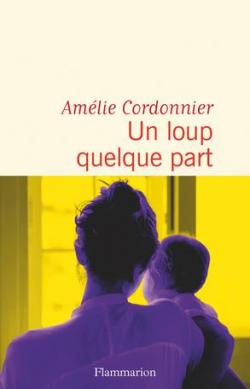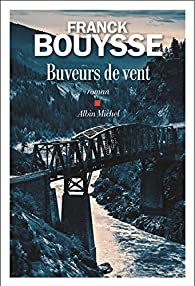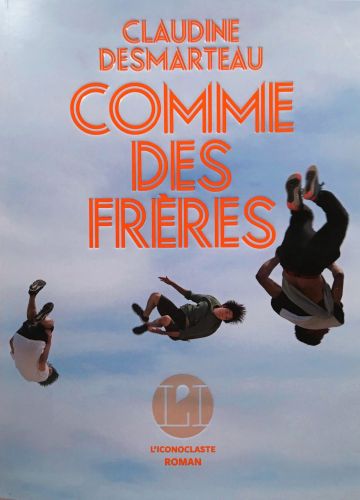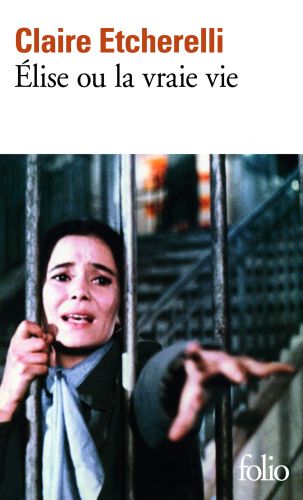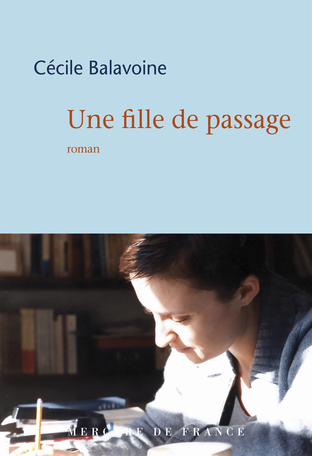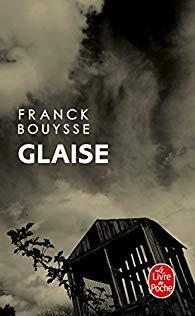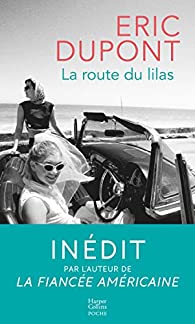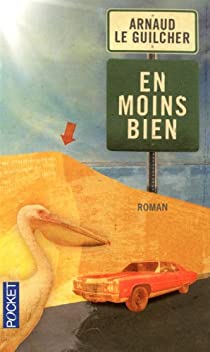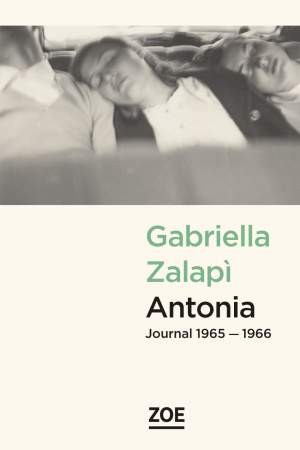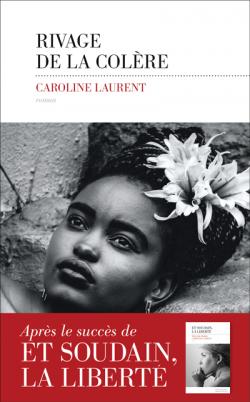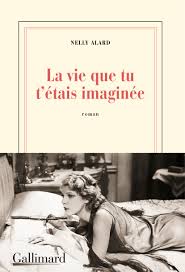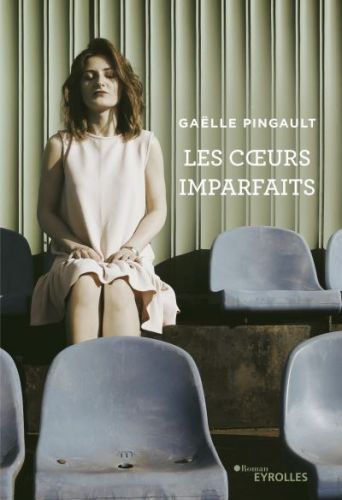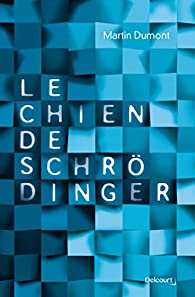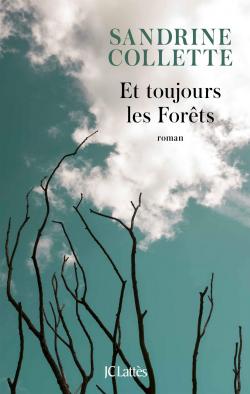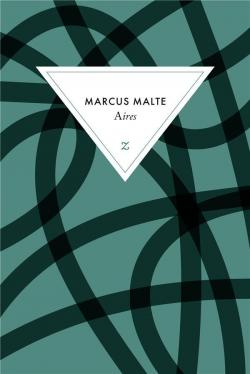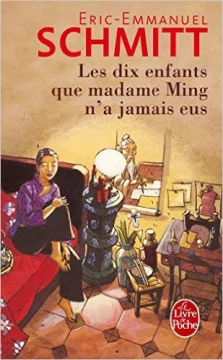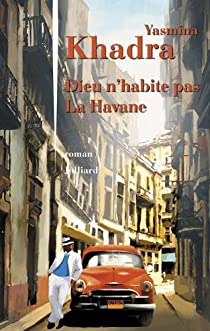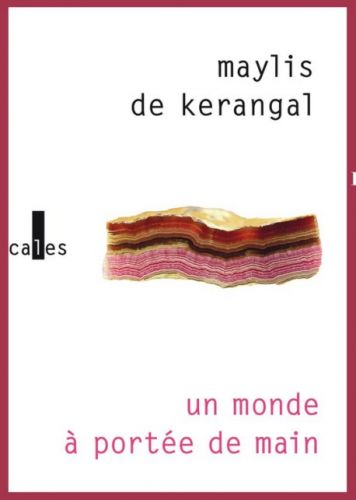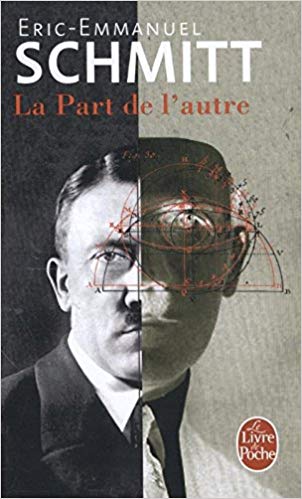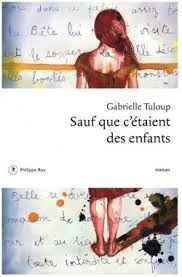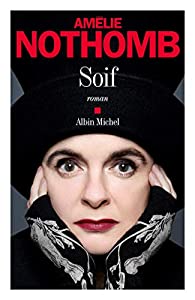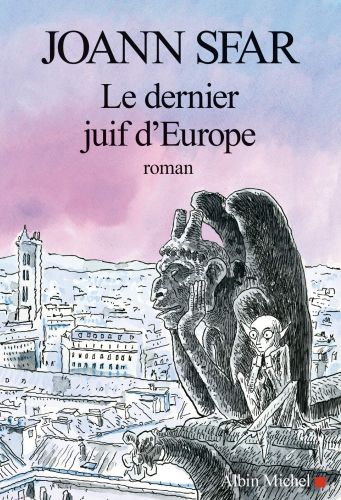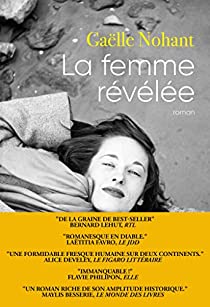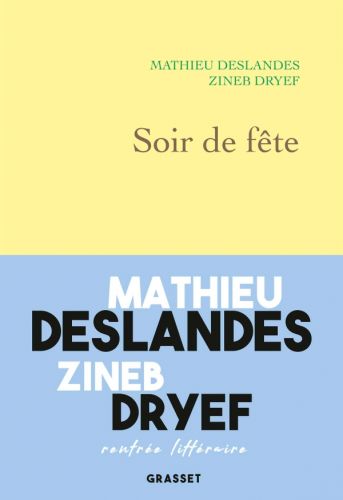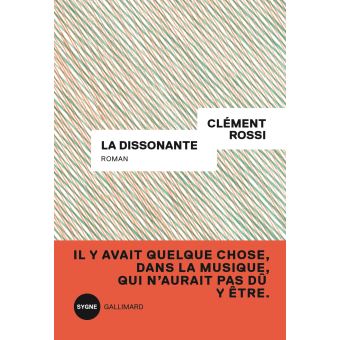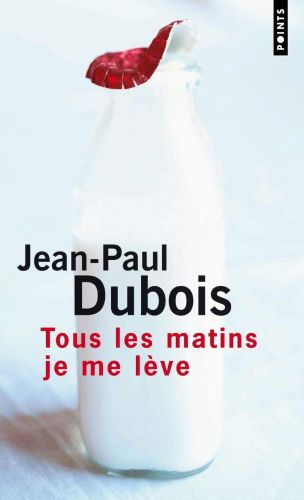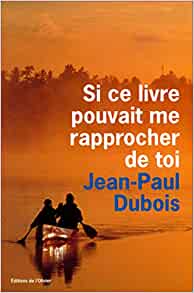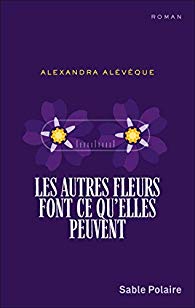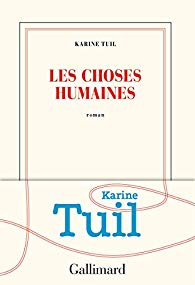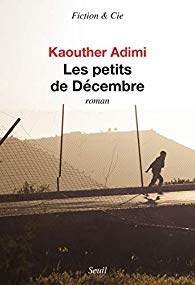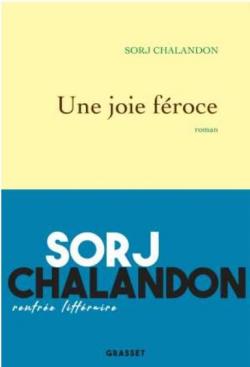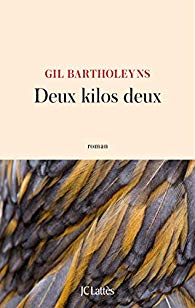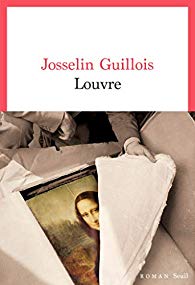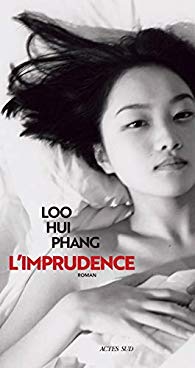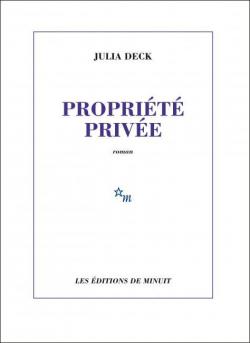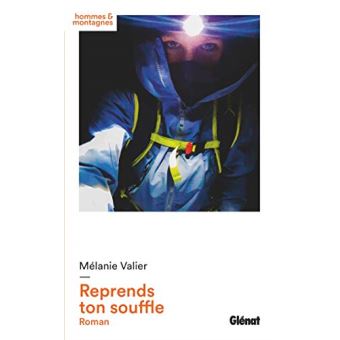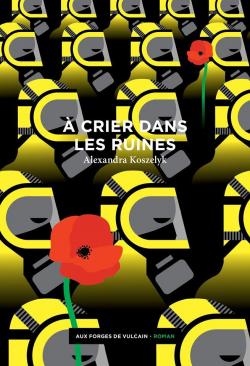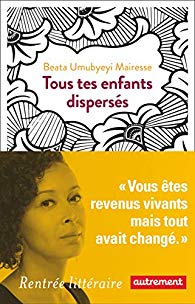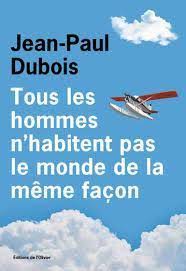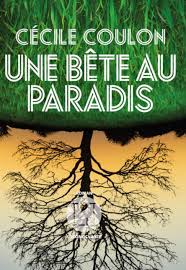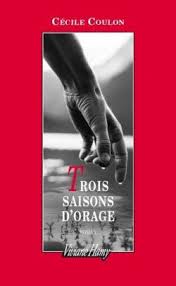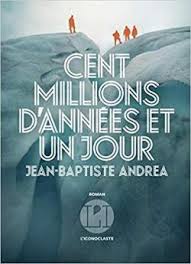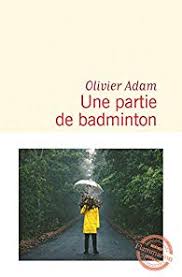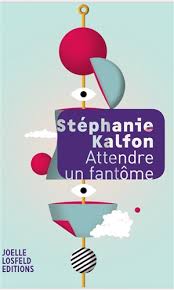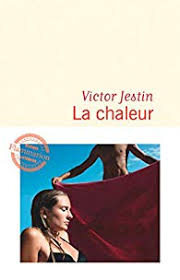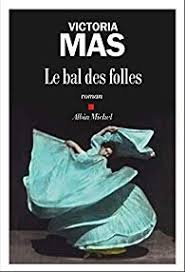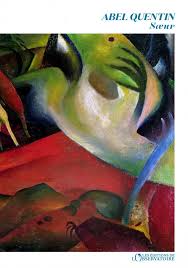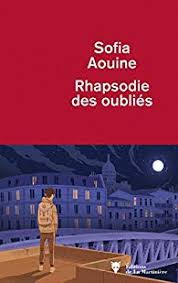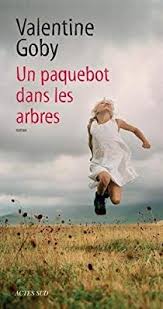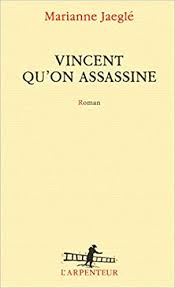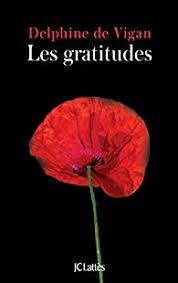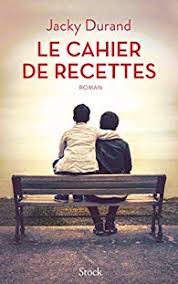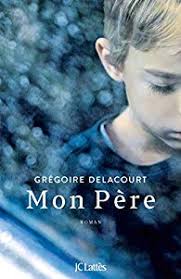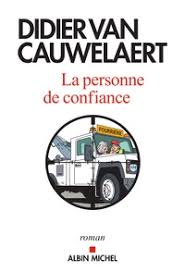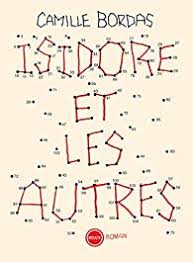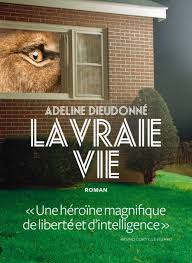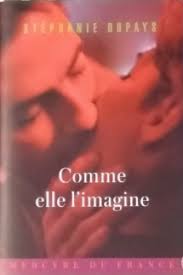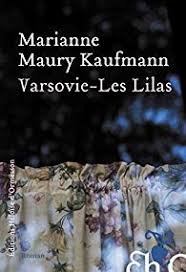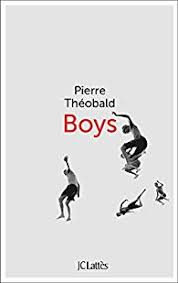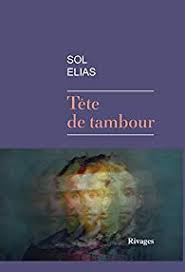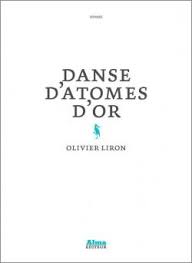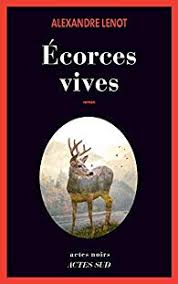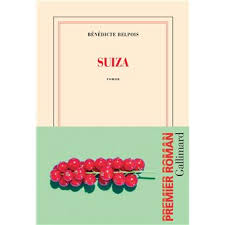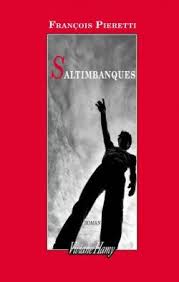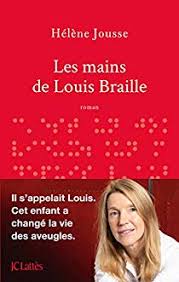Hiver 1969, quelque part en France. Tout le
village travaille pour « Monsieur », qui gouverne tout son domaine
d'une main de fer, avec pour seul objectif : en tirer un maximum de profit.
Personnage détestable et despotique, il est craint de tout le monde, à
commencer par les domestiques, notamment les femmes, qui n'osent jamais se
rebeller et vivent sous le joug de ce seigneur d'un autre âge. Mais voilà que
Sylvie, sa petite fille âgée de quatre ans, échappe à la surveillance de
Catherine, une bonne à tout faire d’une discrétion de fantôme. Il s’avère que l’enfant
a été enlevée, et qu’on réclame une rançon. Deux policiers arrivent de Paris
pour épauler les gendarmes, mais l’enquête piétine.
Le froid, la neige, la misère. Et la boue
surtout. La terre fangeuse conditionne la vie des habitants du Domaine : on y
plante des betteraves qui s’étendent sur tous les champs achetés peu à peu par Demest,
une sorte d’ogre qui ne fait rien qui ne soit rentable ; on y patauge sans
plus y prendre garde tellement on s’y est habitués ; on y vit et on y
meurt sous le joug d’un tyran sans sentiment, capable d’incendier une grange
avec des vaches au prétexte que les bêtes rapportent plus mortes que vivantes. D’ailleurs,
c’est moins son affection pour sa petite fille que le coût de la rançon qui l’a
motivé à faire appel aux gendarmes. Demest fait vivre la moitié des habitants
de la commune, qu’il maintient dans une relation de dépendance dont ils ne
peuvent sortir. Quant aux femmes, elles le fuient tant qu’elles peuvent.
Catherine a appris à devenir invisible, muette, peu attirante, tant et si bien
que Mme Demest l’a surnommée la Petite Sale, et qu’elle est cantonnée aux
tâches ménagères. Elle ne dit rien aux deux flics venus de Paris, et qu’aurait-elle
à dire, elle que l’on considère comme simple d’esprit ? Le récit donne
alors la parole à Gabriel, l’un des membres du duo parisien, qui souffre du
froid et de la pluie, patauge dans la fange et maudit ce pays et cette enquête,
qui l’éloignent de sa Claudia et de ses tendres « Caro mio ».
Roman d’atmosphère et roman noir, ce récit
nous plonge dans la réalité rurale de la fin des années 60, où les salles de
bain sont encore un luxe, et dans un monde glaçant où le droit de cuissage reste
d’actualité. Il n’est pas exempt de longueurs, mais l’intrigue se noue point par
point, efficacement, pour justifier de façon imparable les motivations des
ravisseurs.
Catégorie :
Littérature française
milieu
rural / hiver / froid / boue / famille / patriarcat / exploitation agricole /
esclavage /
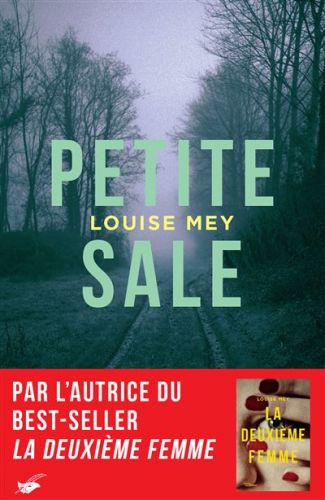
Posté le 29/03/2023 à 17:35
Lors de la première de
"Rigoletto" de Verdi à l'Opéra-Comique en 1935, le jeune ténor Elio
Leone reçoit l'ovation du public qui découvre sa voix superbe, au détriment du rôle-titre.
Qui est ce jeune homme surdoué ? Elio est né en 1912 dans une ferme des
environs de Naples, d’une fille mère morte quelques heures après sa naissance. Elevé
dans un orphelinat de religieuses sous le nom d’« Elio Abandonnato »,
il a passé son enfance à voler pour manger et à se protéger des coups, jusqu'à
ce que le hasard lui fasse croiser un médecin directeur d’une école pour
orphelins, un prêtre mélomane, puis une professeure de chant, des bienfaiteurs
qui ont vu son talent et vont l'amener à développer sa voix. Un conte de fées ?
L'homme a ses failles, et le spectre de la seconde guerre mondiale rôde...
Rythmé par les airs les plus célèbres,
qu’il s’agisse des chœurs des esclaves de Nabucco
ou du tube napolitain O sole mio, ce
roman retrace la vie en montagnes russes de ce chanteur prodige. Passionné de
musique, doté d’une voix telle qu’il n’en existe que deux ou trois par siècle,
Elio, aidé il est vrai par ses trois protecteurs successifs, sait conjuguer
travail et talent, et mérite amplement son triomphe. Mais la vie est cruelle,
qui va briser nombre de ses idéaux : guerre, abandon, deuil, le sort
semble s’acharner sur cet orphelin qui tombe et se relève, jusqu’à la dernière
chute dont on craint qu’il ne reste à terre. Mais c’est l’amitié et la
bienveillance qui, là encore, vont le sauver. Ce beau roman se lit comme on écoute
un aria, avec ses contrastes, les prouesses du chanteur, son émotion, et livre
ainsi un hommage vibrant à la musique et à l’opéra, à l’amitié, au travail, à
l’humilité, et aux gens de bien qui rendent le monde un peu moins mauvais.
Catégorie :
Littérature française
opéra
/ ténor / soliste / chant / amitié / destin / Italie / Naples /
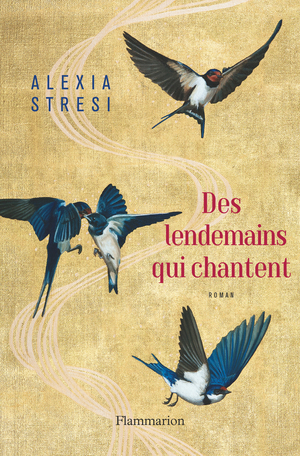
Posté le 29/03/2023 à 17:33
Le fils de Thomas Poisson lui demande de
l'aider à réaliser l'arbre généalogique de la famille. L'événement fait
remonter le souvenir de la légende familiale, racontée par sa propre mère,
selon laquelle son arrière-grand-père ferrailleur a été victime d'une arnaque en
achetant la tour Eiffel à Viktor Lustig, un escroc notoire, dans les années 20.
Il entreprend des démarches en médiathèque, puis, poussé par ses amis, décide
de poursuivre son enquête en allant questionner son père, hospitalisé en EHPAD,
en espérant que tous ses souvenirs n'aient pas été effacés par la disparition
progressive de ses facultés cognitives.
L’intrigue est intelligemment construite,
dévoilant peu-à-peu ses éléments ; le roman est écrit d’une plume alerte
et drôle, avec une bonne dose d’autodérision. A commencer par le
protagoniste : au chômage, Thomas a le temps. Il entreprend de ranger le
garage, de trier et jeter, et de mettre de côté des cartons de documents, avant
de jeter l’éponge. Il se consacre alors à son enquête, afin de vérifier si
André Poisson a bien tenté d’acheter la grande dame de fer qui, se
rappelle-t-on, était vouée à la destruction après avoir été le clou de
l’Exposition universelle de 1889. En menant ses recherches, il lie amitié avec
des personnages assez truculents : Françoise, qui complète sa petite
retraite en vendant des confitures maison aux usagers de la médiathèque,
Mansour qui l’encourage à parler avec son père puisqu’il n’a pas pu le faire
avec le sien, ancien harki torturé, Francky arrêté et suspecté d’être un
casseur parce qu’il portait un gilet jaune devant sa voiture en panne, et Lina,
la jeune et joie bibliothécaire qui remue quelque peu notre héros. Finalement,
ce n’est pas tant de faire la lumière sur ce mythe familial qui intéresse
l’auteur, mais cette galerie de personnages et les liens qu’ils tissent entre
eux, ainsi que la quête personnelle de Thomas qui s’interroge sur son couple,
sa paternité, ses relations avec ses parents, la société qui l’entoure, en plein
mouvement social des Gilets jaunes.
C’est là que le titre prend tout son
sens : l’histoire de Thomas et de ses amis rencontre l’Histoire des
livres. Et dans une période rythmée par les mouvements sociaux, dont on n’est
pas sorti, à l’heure de la réforme des retraites, l’humour a quelque chose de
salvateur.
Catégorie :
Littérature française
Famille
/ arnaque / quête / passé / amitié / manifestations / social /
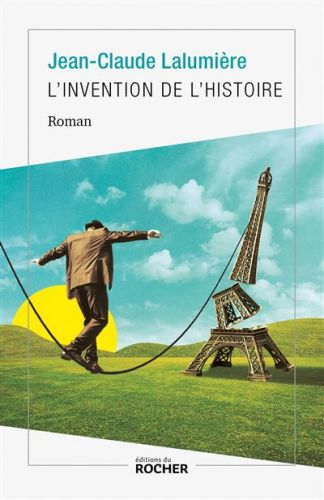
Posté le 29/03/2023 à 17:32
Simone Pijkswaert, la mère de Pierre est
morte en se rendant aux obsèques de son oncologue. Un bête accident, dont la
soudaineté a empêché son fils d’accomplir les démarches administratives
indispensables. Fidèle à la promesse qu'il lui a faite de conserver son
appartement niçois et de continuer à faire rouler sa voiture, une Renault Fuego
ringarde mais équipée d’un moteur Turbo à faire pâlir d’envie les conducteurs
d’hybrides haut de gamme, l’écrivain s'acquitte des amendes qu'elle a reçues à
cause de lui en tâchant d’écrire un nouveau roman qui sera consacré à sa mère.
Jusqu’au jour où il reçoit un courrier de la préfecture informant Simone
qu’elle ne possède plus qu’un point sur son permis et qu’elle est convoquée à
un stage de récupération de points. Mais c’est sans compter avec Lucie
Castagnol, amie de la défunte et comédienne en retraite, qui va lui proposer
d’endosser son dernier rôle : se faire passer pour Simone, le temps du
stage…
Quelle mouche a donc piqué la sémillante
sexagénaire, animatrice en EHPAD et trublion des manifs anti vax ?
Veut-elle rendre hommage à sa vieille compagne de maison de retraite ?
S’offrir un dernier grand rôle ? Se prouver qu’elle est capable d’imiter
parfaitement une morte, voire à la ressusciter, au point que son propre fils
pourrait s’y méprendre ? En bon romancier, Didier Van Cauwelaert ménage
ses effets et ne révèlera ses vraies motivations que lors d’un dénouement plein
de rebondissements. Il semble s’amuser tout autant que le lecteur des
situations cocasses dans lesquels il plonge des personnages bien
affirmés ; d’une plume alerte, élégante et drôle, il conduit avec le même
empressement et la même efficacité que Simone devait prendre les virages au
volant de sa Fuego. Et puis, il finit bien – un peu de lumière en ces temps de
crise sociale.
Catégorie :
Littérature française
mère
/ fils / famille / décès / maladie / secret / usurpation d’identité /
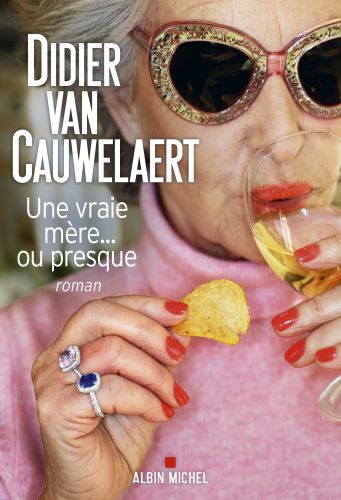
Posté le 29/03/2023 à 17:30
Rome, 1er siècle. Sous le règne de Néron,
Chloé, esclave affranchie, courtisane et musicienne, et Marcus Corvus, citoyen
romain et poète, se rencontrent, se fréquentent, et finissent par s'aimer. Au
point que, alors que Marcus expire, les deux amants jurent de se retrouver,
dans une autre vie, ainsi qu'ils en sont convaincus. Ils vont effectivement de
retrouver à travers différentes époques : dans la bibliothèque d’un couvent au 14ème
siècle, dans l’atelier de Rembrandt à Amsterdam au 17ème siècle, dans
la campagne russe à la toute fin du 18ème siècle, au royaume de
Wessex en Grande-Bretagne au milieu du 19ème siècle, enfin sur la
ligne de front pendant les derniers combats de la guerre 14-18. Amour
passionnel, amour fraternel, admiration, fascination… les deux âmes voyagent à
travers les époques et si leurs enveloppent corporelles ont tout oublié de
leurs vies antérieures, elles se retrouvent malgré tout…
« Quem diligis numquam perdes »,
qui tu aimes jamais ne perdras, voilà ce qu’a peint Rembrandt dans les plis du
manteau dont il a revêtu son modèle. La locution latine va être le fil rouge
qui unit ces deux êtres, dans une connivence qui prend consistance entre le
peintre et son modèle, au fil des jours. Cette même entente profonde se
retrouve dans les différentes réincarnations de ces âmes antiques, sans que
jamais plus les corps ne connaissent la communion des corps, mais une
complicité spirituelle évidente – comme si les besoins de la chair avaient cédé
place à un amour qui n’avait plus besoin de se dire pour exister, de façon
évidente. Jusqu’à la dernière réincarnation, qui prend une dimension
métaphorique. Il est donc dans ce roman question d’amour sous toutes ses
formes, mais aussi question de foi, qu’il s’agisse des premiers enseignements
du Christ, de l’engagement à Dieu des moines et moniales, de la pratique du
Judaïsme, de l’adoration des icônes orthodoxes ou du protestantisme. En plus
d’un solide travail historique, l’auteur épouse dans son style les conventions
de chaque époque et rédige chaque partie « à la manière de… » de
façon remarquablement efficace, nous proposant ici un roman d’une rare qualité,
avec une dimension épique et universelle.
Catégorie :
Littérature française
métempsychose
/ réincarnation / amour / communion / temps /
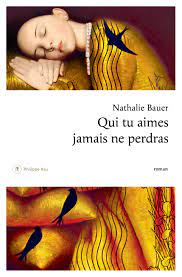
Posté le 29/03/2023 à 17:29
Un petit village de Saône-et-Loire, automne
1988. Les cours ont repris, les lycéens s'ennuient sur la place du village,
tandis que les adultes se préoccupent essentiellement de la météo qu'ils
espèrent favorable aux vendanges. Dans ce quotidien un peu morne, un événement
dramatique va faire sortir le village de sa torpeur : la grange des Berthelot
s'embrase, et le feu tue les chèvres qui y étaient parquées. Les soupçons se
portent sur Gildas, un jeune homme un peu marginal, qu’un gamin a aperçu près
de la grange, mais qu’il a peur de dénoncer. Le drame réveille des rancœurs
enfuies, et oppose deux générations : celle qui reste et peine à se faire aux
transformations du monde, et celle qui ne rêve que de quitter le village...
Peu importe finalement, que ce village se
situe en Saône-et-Loire, au fin fond des Vosges ou en plein cœur du bocage
normand. On s’y ennuie tout pareil, quand on a 16 ou 17 ans. A la fin des
années 80, les communes ne se sont pas encore fédérées en groupement et ne
peuvent offrir de quoi distraire ces jeunes générations qui hantent les places
du village autour de la cabine téléphonique et traversent les rues en faisant
vrombir les 50 cm3 de leurs mobylettes. Malgré quelques coquilles au début du
récit (un ver de terre en train d’agonir), l’auteur enclenche la bonne vitesse
et l’histoire se met en place, servie par des personnages bien campés, qu’il
s’agisse de Samuel et Delphine, les amoureux de dix ans, de Gildas et Sandra
tout aux émois de leurs corps en pleine poussée d’hormones, du vigneron
désemparé par la pluie, ou du maire qui ne dédaigne pas les pots-de-vin. Il y a
chez Emmanuel Flesh un peu de Nicolas Mathieu dans cette poisse rurale où se
questionnent le conflit des générations, les petits arrangements entre notables
et le déterminisme social.
Catégorie :
Littérature française
milieu
rural / village / générations / famille / adolescence / ennui / société /
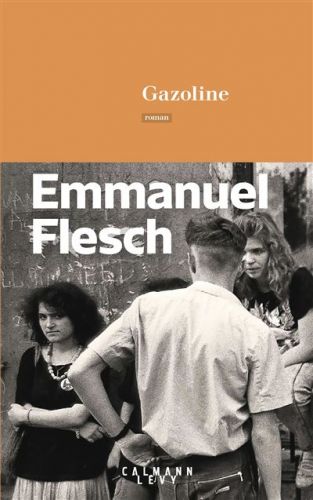
Posté le 29/03/2023 à 17:26
Un soir d'été, Juliette Conti, 17 ans, est
prise de violentes douleurs au ventre. On pense à une appendicite, mais les
médecins de la clinique sont formels : la jeune fille est en train d'accoucher.
Mais Juliette n'en démord pas : elle a continué d'avoir ses règles, son ventre
n'a pas grossi, elle n'a pas pris de poids. Et pourtant il est bien là, cet
"Autre" qui lutte pour sortir d'elle, et qui va lui voler sa jeunesse
ses projets d'intégrer une prépa parisienne. Malgré le soutien de ses parents,
elle ne parvient pas à se faire à l'idée d'être mère, et décide de se
débarrasser de l'enfant en le proposant à l'adoption...
Ici, point de bon sentiment, mais le rejet,
cru, de cet enfant issu d’une relation dont on ne connaîtra jamais que le
caractère délétère. Les mots sont précis et n’occultent pas la réalité
insupportable que découvre cette jeune fille. Cet intrus est un cancer qui
s’est nourri d’elle, et dont elle n’aspire qu’à se séparer. L’accouchement est
un traumatisme, le retour à la maison une fois l’enfant confié à un foyer d’accueil,
douloureux. Au point que la folie guette Juliette, malgré toute la patience et
tout l’amour que lui portent ses parents et sa jeune sœur. Le roman est
d’autant plus efficace que l’auteur évite habilement tout pathos en présentant
Juliette comme une adolescente difficile, agressive envers sa mère qu’elle ne
craint pas de malmener. Elle fait du corps le filigrane du récit, rappelé dans
les en-têtes des chapitres. Ce corps d’adolescente fin et musclé, sculpté par
la pratique sportive, qui dès lors que la jeune fille prend conscience de la
présence de cet « autre » au creux de son ventre, se met à enfler
soudainement, au point de devenir méconnaissable. Ce corps qu’ensuite Juliette
n’arrive plus à accepter, comme si, d’une certaine façon, il l’avait trahi.
Si ce roman sur le déni de grossesse a de
nombreuses qualités, je regrette cependant certaines longueurs dans la deuxième
partie du récit, après l’accouchement : certaines scènes semblent
s’étirer, notamment dans les réflexions de Juliette, d’autant plus que l’auteur
use de l’imparfait, qui donne une impression de longueur et de lourdeur, ce qui
dessert quelque peu le caractère percutant de ce récit.
Catégorie :
Littérature française
déni
de grossesse / adolescence / famille / accouchement /
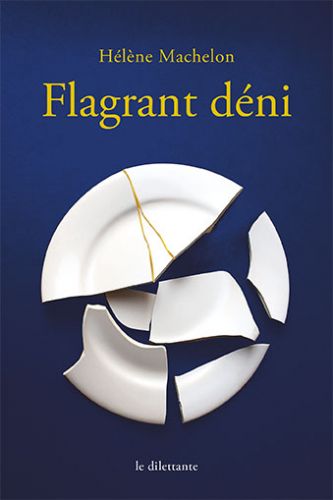
Posté le 29/03/2023 à 17:25
Après une soirée arrosée avec ses amis,
Emile se réveille dans une voiture de police. Direction le poste et la
garde-à-vue, soupçonné qu'il est d'avoir tué une jeune femme invitée à la fête.
Sauf qu'il ne se souvient de rien. Il écope de 13 ans de prison ferme.
Heureusement ses deux amis Paul et Manon, qui l’ont soutenu tout au long de sa
détention, l’aident à se réinsérer. Il rouvre son camion de glaces artisanales
et rencontre Jeanne, de dix ans sa cadette, dont il tombe fou amoureux, mais à
qui il cache son passé. Mais voilà qu'une journaliste le contacte pour évoquer
le meurtre de Louise, le fragile équilibre de la vie d'Emile et son couple se
trouve menacé par la révélation de son secret...
Des personnages bien campés, une
intrigue solide construite comme une sorte de puzzle dont les pièces, issues du
passé, du présent et de l’avenir, viennent peu-à-peu combler les vides, jusqu’à
un dénouement surprenant et cependant bien amené, avec plusieurs révélations
successives. Figurent par ailleurs dans ce récit les thématiques de la peur de
l’ennui au sein du couple, la Suze qu’Emile affectionne, servie avec des
glaçons qu’il touille du bout du doigt, les secrets de famille, des thématiques
que l’on retrouvera dans Cette nuit qui
m’a donné le jour, publié ensuite, dont le titre sonne comme en écho au
précédent. Un roman joliment écrit, recelant de nombreux détails concrets très
justes, tandis que dans Pour une heure
oubliée la plume m’a paru quelquefois lourde ou maladroite, de (trop)
nombreuses comparaisons, des métaphores un peu redondantes : « Son
existence aurait pu se terminer ainsi, le corps échoué sur le velours beige
d’un canapé, comme sur le sable d’une plage, après avoir dérivé pendant de
longues semaines sur une mer trop agitée… » (p.205), ou l’emploi simultané
du passé-simple et du passé composé. Ce sera le seul bémol de ce roman qui a
été une lecture bien agréable.
Catégorie :
Littérature française
famille
/ alcool / secret / amitié /
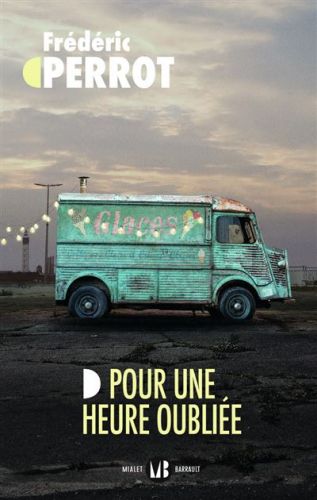
Posté le 29/03/2023 à 17:23
Le père d'Etienne, atteint de la maladie de
Charcot, vient de mourir. Pour sa veuve et son fils, c'est un bouleversement
terrible. Henri et Marlène formaient un couple parfait depuis trente ans,
solide, inaltérable. Etienne découvre dans l’ordinateur de son père deux
éléments qui vont chambouler sa perception de ses parents : d’abord un
historique des dialogues qu’Henri, incapable de parler, dictait avec les yeux
au logiciel, qui lui révèle une vérité inattendue, et une lettre écrite par
Henri, qu'il a dédiée à son fils. C’est un long récit où il raconte son secret
: celui de sa rencontre avec Jean dans un bar, et une relation qui a duré des
années sans que personne ne connaisse rien de l'identité ni de l'histoire de
cet être aimé.
Henri a passé avec Jean en tout et pour tout
28 jours, sur les seize années qu’aura duré leur relation. C’est peu,
évidemment, et peut-être une des raisons pour lesquelles Henri a choisi de ne
pas quitter Marlène, qu’il aimait tout autant que Jean, quoique différemment.
Ce roman réussit à sortir de la thématique rabattue de la liaison adultère en
questionnant sur le polyamour : l’auteur se garde bien d’émettre un
quelconque jugement sur la lâcheté d’Henri, préférant illustrer la possibilité
d’aimer deux êtres, et de ne vouloir en perdre aucun. C’est aussi la leçon
qu’en tirent Marlène et Etienne, qui ne considéreront pas Jean comme un ennemi.
Ecrit par un scénariste, le récit fourmille de détails très visuels ;
quand il est soumis à un stress, Henri est envahi par une foule de pensées qui
viennent parasiter son esprit mais qui nous semblent si familières – ne pas
avoir sorti le linge de la machine avant de partir, s’inquiéter de son
apparence, après avoir surgi de son bain pour répondre au téléphone au milieu
du salon. L’effet de réel se colore d’autodérision et de gravité, évitant avec
adresse le pathos, à l’exception peut-être des derniers chapitres, quand
Marlène prend la parole.
Un très beau roman donc, découvert dans un
contexte particulier, celui d’un trajet en voiture pour rentrer de vacances au
cours duquel une copilote insensible au mal des transports m’a lu le récit
d’Henri pendant sept heures et sans faillir, sorte de livre audio vivant qui
confirme qu’en voiture, prisonnier de l’habitacle, on a une qualité d’écoute
qui n’existe pas dans la vie quotidienne. On devrait lire plus souvent quand on
conduit.
Catégorie :
Littérature française
couple
/ polyamour / secret / adultère / famille /
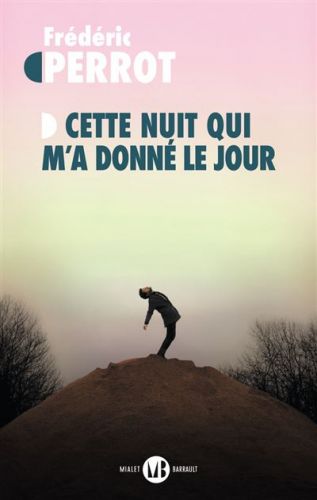
Posté le 29/03/2023 à 17:21
Aurélien est directeur du département des
peintures du Louvre. La nouvelle présidente du musée lance un audit pour
décider de la restauration éventuelle de la Joconde, dont les couches
successives de vernis ont estompé les couleurs originelles du tableau. Le projet
validé, Aurélien est chargé de trouver un restaurateur assez expérimenté et
audacieux pour s'attaquer au chef d'œuvre de Vinci. Il épluche les devis,
consulte des experts, et finit par dénicher la perle rare, en la présence d’un
maître italien qui se rend à Paris et entame le travail, sous l’œil des
spécialistes et des caméras du monde entier…
Pendant ce temps, Homero, un agent
d’entretien, assure l’entretien de la salle des Caryatides, aux commandes de
son autolaveuse. Au son des Quatre saisons de Vivaldi, il passe entre les
statues qu’il frôle du bout des doigts, en une chorégraphie savante et
dangereuse qui lui vaudra d’attirer l’attention d’Hélène, la responsable de la
statuaire antique. Avec la fin du contrat qui lie le Louvre à la Coprotec qui
l’embauche, Homero est affecté par Hélène à l’entretien de la Grande Galerie
des peintures, où est exposée la Joconde. S’il regrette son autolaveuse,
l’homme tombe amoureux du tableau, qu’il contemple à l’envi pendant ses nuits
de travail, jusqu’à ce que le projet de restauration l’en prive. Ce personnage
est loin d’être anecdotique, et va même jouer un rôle crucial dans le
dénouement du récit. Il a même une autre fonction, celle d’être en quelque
sorte le miroir inversé d’Aurélien, contemplatif lui aussi, et sensible à la
beauté des œuvres malgré son manque de culture ; alors que le couple
d’Aurélien se délite, Homero connait une aventure charnelle au sein du musée. A
travers le destin de ces deux personnages bien campés, trois si l’on ajoute l’Italien
Gaetano, c’est aussi celle d’un tableau restauré à plusieurs reprises au fil
des siècles, dont on se demande si en retirer des couches de vernis ce n’est
pas ôter de la valeur à l’œuvre, dont l’auteur comptait peut-être que le portrait
de Mona Lisa se patine avec le temps ? Le roman prend ainsi une dimension
didactique sans pour autant jamais perdre de son intérêt narratif, et aborde
par ailleurs la question de la rentabilité des musées et de la politique
marketing pour en assurer une fréquentation suffisante. La restauration du
tableau le plus célèbre du monde est-elle motivée par de réelles préoccupations
artistiques ou par une réalité bien plus mercantile ? On trouvera dans
l’ultime rebondissement, peut-être, un élément de réponse, comme un pied de nez
aux analyses et commentaires des spécialistes de l’art. Un régal.
Catégorie :
Littérature française
peinture
/ Vinci / Italie / Renaissance / restauration / art / musée /
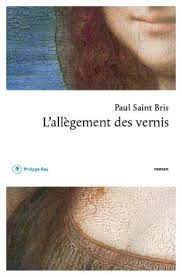
Posté le 29/03/2023 à 17:18
Etats-Unis, fin 1996. La narratrice,
enseignante de français dans le Minnesota, rencontre un jeune homme dans un
train. Il s'appelle Sasha, il est vêtu avec une élégance surannée et ambitionne
d'ouvrir un café à New York. Lorsque Cécile se rend dans la capitale, les deux
jeunes gens se revoient et nouent une relation. Ils profitent de la vie new-yorkaise
bouillonnante, avant que Cécile ne rentre en France et le perde de vue. Vingt
ans plus tard, elle apprend que Sasha est devenu un célèbre bar tender, réputé
pour respecter strictement les recettes originales du temps de la Prohibition. Un
roman autobiographique qui rend hommage à un amour de jeunesse.
Après s’être livrée dans son précédent roman
consacré à sa relation ambiguë avec le professeur et critique littéraire Serge
Doubrovsky, Cécile Balavoine continue d’exploiter la veine de l’autofiction
pour mettre en scène ce jeune homme particulier, un peu démodé, qui a confessé
son amour pour elle sans qu’elle n’y réponde. A l’heure où elle aime de façon
un peu vaine un chef d’orchestre marié qu’elle ne voit que deux fois l’an, et
qui certes l’aime en retour mais ne quittera jamais son épouse, elle comprend
qu’elle est passée à côté de Sasha et de ses sentiments. Un peu tard mais tant
pis, elle rend hommage à ce personnage décalé, dandy et gentleman, bien connu
des nuits new-yorkaises où il œuvrait dans des bars cachés, en même temps qu’elle
célèbre la « ville qui ne dort jamais », et l’art de réaliser des
cocktails – qu’on appelle désormais mixologie, un terme que Sacha n’aimait pas.
Revenir là, plus de vingt ans après, retrouver ceux qui l’ont fréquenté, c’est côtoyer
la nostalgie, constater que sa jeunesse s’est enfuie. Ce troisième roman
inspiré par la propre vie de l’auteur est sans doute plus mélancolique, avec le
regret de ce qui aurait pu être, et le deuil de la jeunesse.
Catégorie :
Littérature française
Etats-Unis / New York / bar
/ vie nocturne / nostalgie / deuil / solitude /
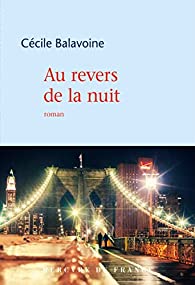
Posté le 15/03/2023 à 17:37
Xavier Bovary est dermatologue. Praticien
sans histoire, un peu terne, il vit sous la coupe de son épouse Anastasia, plus
jeune que lui et très belle, se dévouant à son métier et à ses enfants. Le jour
de ses 50 ans, il reçoit des mains du notaire un pli scellé, qui vient de son
grand-père décédé vingt ans plus tôt. Dans le paquet, un vieux pistolet chargé,
sans aucun document d'accompagnement. L'objet le propulse dans le passé, fait
remonter les souvenirs de cet aïeul qu'il aimait beaucoup, et l'amène à
reconsidérer toute sa vie, en particulier sa relation avec son épouse, devenue
de plus en plus distante au fil des années.
Dans les remerciements, l’auteur rend hommage
à ses grands-parents qui ne lui ont, écrit-il, jamais offert de cadeau
empoisonné. C’est effectivement ce que Xavier a hérité de son grand-père :
une arme, ancienne certes, mais toujours fonctionnelle, chargée de 5 balles. Où
est passée la sixième cartouche ? A-t-elle été utilisée, et à quelles
fins ? La question ne va pas tarauder longtemps notre dermatologue, qui va
convoquer le ban et l’arrière-ban de ses ancêtres, dont le propriétaire du
flingue, électricien de son état, son épouse entièrement vouée à la tenue de la
maison et sous le joug d’un mari irascible ; les arrière-grands-parents
maternels, et cætera. Nous avons déjà passé le premier tiers du récit, dont le
narrateur s’excuse envers ses lecteurs – ses enfants, comprend-t-on assez vite
– de ses « détours dilatoires ». On acquiesce : allez Xavier, au
fait. Mais non, le carton des grands-parents recèle encore de nombreux
souvenirs que Xavier n’en finit pas d’égrener. Nous voici rendus à la moitié,
le revolver est baptisé du prénom du grand-père, et il est enfin question
d’Anastasia, dont le mari est assez lucide que ce ne sont ni sa beauté ni son
charisme qui ont décidé la belle jeune femme à l’épouser. Un constat qui va
amener doucement notre praticien à commettre l’irréparable.
Malgré quelques pages assez drôles au début
du récit sur quelques patients de Xavier Bovary, et une judicieuse exploitation
de sa déformation professionnelle qui le fait analyser la personnalité de
chacun en examinant son grain de peau, le récit traîne en longueur, la faute à
ces « détours dilatoires » dont abuse le narrateur. Cependant, le
personnage est bien campé, en faux gentil qui se révèle férocement vengeur et
ne supporte pas l’indélicatesse.
Catégorie :
Littérature française
couple
/ adultère / jalousie / vengeance / dermatologie / peau /

Posté le 15/03/2023 à 17:35
Paris, février 1952. François Pelletier,
journaliste au Journal du soir, travaille sur l'affaire Mary Lampson, sans
savoir que c'est son frère Jean le meurtrier. Lequel en a des sueurs froides,
alors que son grand magasin doit bientôt ouvrir et que rien n'est prêt. Quant à
leur sœur Hélène, elle est envoyée par le rédacteur en chef sur le front d'une
bataille entre la compagnie d'électricité qui s'apprête à engloutir un village
sous les eaux d'un barrage et les habitants. En parallèle, Louis Pelletier, le
père, sponsorise à Beyrouth un boxeur outsider, et un inspecteur de police
traque les responsables d'avortements clandestins, auxquels Hélène et Nine, la
fiancée de François, vont être mêlées...
Conditions de travail des ouvriers
déplorables, hygiène insuffisante, répression contre les avorteurs et les
avortées, droits des femmes ignorés, les années glorieuses portent bien mal
leur nom. Ce deuxième tome de la quadrilogie a des allures de roman social, notamment
dans la création et l’ouverture de Dixie, sorte de Taty avant l’heure, qui fait
un clin d’œil au Bonheur des Dames de Zola. Mais, parce qu’il est aussi
question des histoires dans l’Histoire, sous la plume agile, parfois caustique
de Pierre Lemaître, le roman fait la part belle aux aventures de la famille
Pelletier, dans laquelle s’opposent notamment deux figures de femmes :
celle de Jean, Geneviève, enceinte jusqu’au cou, virago insupportable et mère
maltraitante, tyran domestique contre lequel son mari n’ose se rebeller –
quitte à, parfois, forcer un peu le trait - ; celle d’Hélène, à la fois douce
et indépendante, empathique et fière, qui suscite autant la sympathie que sa
belle-sœur la répulsion ou le ridicule.
Et comme il n’est pas d’histoire sans drame,
les aventures des Pelletiers se construisent sur les maux de l’existence. Il y
a le silence pour les cacher : Nine qui entend mal et a tu ses secrets à
François, les enfants dont on ne veut pas, les motivations de l’ingénieur
Destouche chargé de faire évacuer le village. Et la colère : celle des
ouvrières en grève, celle des habitants de Chevrigny qui refusent de voir
détruit tout leur cadre de vie, incarnés par Petit Louis au visage lunaire,
celle d’Hélène et de toutes les femmes qui devront encore attendre vingt ans
avant de pouvoir enfin disposer de leur corps.
Catégorie :
Littérature française
1950
/ France / journalisme / droit des femmes / avortement / famille / roman social
/
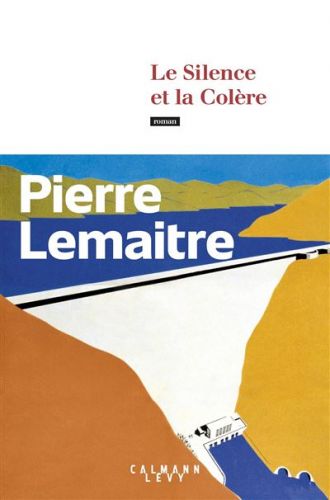
Posté le 15/03/2023 à 17:32
Dans le cadre du dispositif "Ma nuit au
musée" proposé par son éditeur, l'auteur décide de passer une nuit au
musée de la maison d'Anne Franck à Amsterdam. Elle va donc rester dans l'annexe
où la jeune fille a vécu avec toute sa famille pendant un peu plus de deux ans,
avant d'être arrêtée et envoyée dans le camp de concentration de Bergen Belsen où
elle mourra du typhus. Le roman s'intéresse au célèbre journal de la jeune
fille, mais aussi au destin de cet écrit qui a été adapté en pièce de théâtre
et en film. L'auteur s'interroge sur ce témoignage et sur les liens avec
l'histoire de sa propre famille dont certains membres sont décédés à Auschwitz.
Lola Lafon raconte la genèse de ce projet,
ses doutes, ses rencontres, puis fait part de ses réflexions au cours de cette
nuit singulière où elle déambule dans l’Annexe et les bureaux de l’entreprise
d’Otto Franck. Il ne reste rien dans l’appartement pillé par les nazis lors de
l’arrestation de la famille, le 4 août 1944, à part des cartes et des affiches
collées aux murs. Elle évoque ce que représente la figure d’Anne Franck,
s’interroge sur l’écriture, diariste ou pas, raconte la façon dont son Journal
a été accueilli, modifié – on a, apprend-on non sans un certain effarement,
supprimé dans certaines parutions des passages politiquement incorrects, qu’il
s’agisse de ses premiers émois sexuels ou de ses règles, ou de la dénonciation
des exactions nazies -, on l’a adapté en une pièce de théâtre édulcorée,
de peur de faire trop « dramatique ». A qui appartient Anne Franck ?
écrit-elle au début d’un chapitre, tant le destin de la jeune fille, que son
journal a permis de faire connaître, n’est plus seulement une jeune fille juive
assassinée par les nazis, mais une source d’inspiration pour les artistes, les
producteurs, et un objet d’étude pour les nombreuses recherches universitaires.
Au-delà du vibrant hommage rendu à Anne
Franck et aux siens, Lola Lafon se questionne aussi sur ses propres origines,
sa culture roumaine et juive, et raconte les membres de sa famille déportés.
Et puis, alors que la nuit s’achève et
qu’elle parvient enfin à pénétrer dans la chambre d’Anne Franck, qu’elle a
évitée jusqu’au dernier moment, elle narre l’histoire de ce lycéen vietnamien
rencontré alors qu’elle était petite fille, scolarisé à Paris et rappelé par
ses parents à Bucarest où son père était diplomate, avant d’être renvoyé avec
sa famille au Cambodge en pleine guerre civile. En entrant dans la chambre de
la jeune fille, elle prononce le nom du jeune homme qui lui avait écrit quelques
lettres et qu’elle n’a jamais revu, sans nul doute victime de la violence des
Khmers rouges. Cette histoire, qui vient achever un récit intimiste construit
au fil des réflexions et de l’émoi de son auteur, est absolument bouleversante.
Peut-être parce qu’il avait le même âge qu’Anne Franck, et que l’Histoire n’a
pas retenu son nom.
Catégorie :
Littérature française
seconde
guerre mondiale / camp de concentration / nazisme / antisémitisme / témoignage
/ écrivain /

Posté le 15/03/2023 à 17:27
Jeune ingénieure du son, Candice Louradour
est une mère célibataire sans histoire, ébranlée par le récent décès de son
père. Un soir, elle assiste à un accident de circulation, et porte secours à la
victime, une femme d'une cinquantaine d'années. Elle lui rend ensuite régulièrement
visite à l'hôpital. Des liens se créent entre les deux femmes, au point où
Dominique la charge de se rendre chez elle pour y récupérer quelques effets
personnels. Candice intriguée par le caractère énigmatique et fascinant de
Dominique, s’acquitte de sa mission, découvre des éléments étonnants, mais
continue de fréquenter cette femme, au grand dam de sa mère et de sa sœur qui
lui reprochent de se laisser influencer…
Drôle d’amitié que celle-là, dans laquelle
Candice oscille entre admiration et répulsion. Dominique est-elle sincèrement
gentille, et solitaire, ou une véritable manipulatrice ? Parce qu’il s’agit
bien d’une forme d’emprise, ainsi que le dénonce la famille de Candice. Laquelle
est trop perturbée par ses propres problèmes pour en avoir réellement
conscience. Elle souffre de boulimie, elle est terriblement complexée, malheureuse
dans sa relation sentimentale, et découvre que son père avait une double vie. Mais
bienveillante, gentille, passionnée par son travail. N’en jetez plus. Certes,
le récit est fluide, agréable à lire, d’autant qu’il fait la part belle à l’histoire
de Zola et notamment de son polyamour pour sa femme et sa jeune maîtresse avec
laquelle il aura deux enfants, mais les ficelles sont un peu grosses et le
dénouement flirte avec le « feel godd book ».
Catégorie :
Littérature française
Boulimie
/ polyamour / famille / amitié / manipulation /
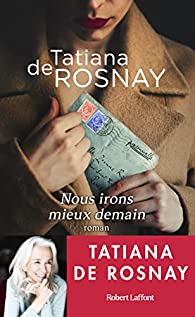
Posté le 28/10/2022 à 17:47
Le 6 juin 1944, la 29ème Division débarque
sur la Obama Beach, sous les balles allemandes. Parmi les soldats, Andrews, qui
échappe de peu au massacre. 75 ans plus tard, Magali, guide touristique
spécialisée dans le tourisme de mémoire, est chargée d'accueillir un groupe de
visiteurs américains, dont le vieux vétéran. Une mission d'importance, mais
dont elle essaie de se débarrasser. En effet, elle est en grande souffrance
morale depuis que son mari a mystérieusement disparu lors d'un jogging neuf
mois plus tôt, la laissant seule leurs deux enfants. Elle doit cependant faire
son travail, et fait alors la connaissance d'Andrew, venu seul du Connecticut...
Après des airs de faux roman historique,
avec une description très réaliste du D Day et les GIs tirés comme à la foire,
le récit fait un bond temporel pour se focaliser sur Magali et son métier mal
connu, l'accueil des hordes de touristes venus découvrir les plages du
Débarquement et des rares vétérans dont l'âge avancé leur permet encore de
venir en pèlerinage. La venue de l'un d'entre eux est un véritable événement,
mais Magali tente vainement de refiler sa mission à un collègue, ayant bien
d'autres chats à fouetter. Mais voilà que ce très vieil homme va la surprendre
et la toucher, ses blessures anciennes faisant écho aux siennes. L'auteur
semble nourrir une grande tendresse pour ses deux personnages, et nous offre là
un récit attendrissant, à la mélancolie élégante, servi
par une plume sobre et fluide.
Catégorie
: Littérature française
Première
guerre mondiale / Normandie / débarquement / vétéran / guide touristique /
deuil /
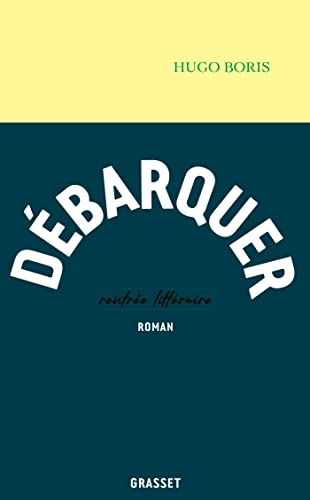
Posté le 28/10/2022 à 17:43
Le père de Claire, Paul et Antoine vient de
mourir. Ils retrouvent leur mère dans le pavillon familial pour les
funérailles. C'est le moment de régler ses comptes, notamment pour Paul,
cinéaste, qui a coupé les ponts avec sa famille. En effet, on lui reprochait de
s'inspirer d’événements vécus pour et de détourner la réalité pour en faire un
matériau exploitable dans ses films. Antoine nourrit de solides griefs contre
son frère, l’accusant d’égoïsme et d’insensibilité. Claire, elle, est plus
tolérante. Le frère et la sœur prennent la parole tour à tour pour relater ces
trois jours de huis clos familial où chacun règle ses comptes, entre
malentendus et tendresse.
A travers ce règlement de comptes
fraternel, c’est aussi l’histoire de chacun qui se dessine. Celle d’Antoine,
dont la compagne est enceinte, et qui ne sait pas s’il a envie de partager sa
vie avec elle, et jaloux de son frère aîné ; celle de Claire, cadre
infirmière dévouée à ses enfants, qui décide de quitter son mari, profondément
éprise d’un autre homme, lui aussi marié : celle de Paul enfin, le cadet,
le sensible, devenu dur dans un milieu de requins où la compétition fait rage
et la pression est immense, qui a subi l’ire d’un père qui n’acceptait pas son
homosexualité. Si ces trois-là sont réunis, c’est bien parce que le chef de
famille n’est plus là. Dans l’ombre d’une mère assez transparente, ils
échangent sur leurs conceptions de la vie, leurs visions de la société, et
semblent même parfois trouver temporairement un terrain d’entente, en buvant un
verre de vin ou en regardant les albums photo. A travers leurs échanges, c’est
toute la question de l’éducation reçue, forcément différente selon la place
qu’on a occupée dans la fratrie, celle des souvenirs réels ou fabriqués, et
celle du déterminisme social que dénonce Paul dans ses films, se vantant d’être
un « transfuge de classe » alors qu’il ne vient pas des banlieues
qu’il met en scène et n’a pas vécu l’enfant maltraitée qu’il prétend.
En corollaire, d’autres personnages
gravitent autour de la fratrie, l’aînée de Claire militante à la Greta Thunberg
mais incapable de se mêler des tâches domestiques, ou Stéphane, le mari de
Claire, cadre commercial incarnant la beaufitude absolue. Une tragicomédie en
trois actes au dénouement un peu factice – le roman aurait pu s’arrêter juste
avant, comme semblait l’indiquer « FIN ».
Catégorie :
Littérature française
famille
/ fratrie / jalousie / égocentrisme / souvenirs / éducation /
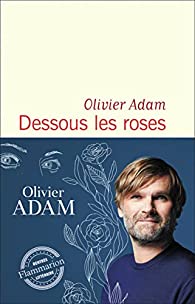
Posté le 19/10/2022 à 17:28
Gaspar, un artiste conceptuel, est parti à
Rome pour se ressourcer et pour préparer sa prochaine conférence sur un artiste.
Muni de son échiquier, il s'installe à une terrasse de café à Campo de' Fiori ,
prêt à disputer des parties avec les passants amateurs de jeu d’échecs. C'est
au cours de l'une d'elles qu’il fait la connaissance de Marya, une œnologue
hongroise. Elle s’avère extrêmement douée, sans doute meilleure que lui. Elle finit
par lui raconter l'histoire de son grand-père qui l'a initiée aux échecs, et la
véritable raison pour laquelle elle est venue à Rome.
Gaspar et Marya se séduisent, d’abord en
déplaçant des pièces, puis en déambulant dans le musée à ciel ouvert qu’est la
capitale italienne. Bien sûr, il y a l’histoire tragique que raconte Marya, et
ce pèlerinage qu’elle accomplit pour rendre hommage à Simon Papp, son
grand-père, et au très vieux séminariste qu’elle est venue visiter ; il y
a aussi celle de Giordano Bruno, brûlé vif par l’eglise Campo de’Fiori pour ses
théories sur le système solaire. Mais c’est aussi le roman de la séduction, de
ce couple qui se cherche, se frôle, se touche, se désire ; une relation
dans une ville qu’aucun des deux n’habite, qui risque, c’est ce que craint
Gaspar, de s’arrêter sitôt que chacun sera retourné chez lui. Antoine Choplin
dit avec ô combien de délicatesse et de poésie cette puissance du désir qui
submerge, cette peau que l’on touche, ces cheveux que l’on respire assis dans
l’herbe face au temple d’Esculape ; cet amour naissant qui risque de
s’achever sous la statue de Giordano Bruno, après la dernière partie d’échecs.
Catégorie :
Littérature française
Rome
/ amour / histoire / échecs / art /
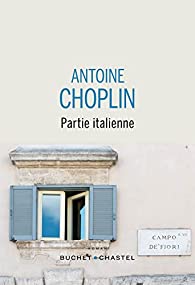
Posté le 19/10/2022 à 17:27
Désiré, l'oncle du narrateur, est mort du
sida il y a 40 ans. Héroïnomane, il a été contaminé après un échange de
seringue. Mais la version officielle est une mort par embolie pulmonaire,
donnée par la famille qui tenait plus que tout à sauvegarder les apparences et
sa respectabilité dans cette petite ville de la région niçoise où elle tient
commerce de boucherie. L’auteur n’a qu'un souvenir flou de Désiré, dont il
retrouve les photos, mais décide d’entreprendre une enquête familiale. Pour
rétablir la vérité, briser les tabous et, peut-être, faire disparaître les
préjugés et la honte. En parallèle, il raconte l’histoire de ce virus que l’on
a au début appelé le « cancer gay », l’impuissance de la médecine et
les morts par milliers, jusqu’à la découverte des premières trithérapies.
Replongée dans les toutes jeunes années 80.
Celles où tout semblait possible, où l’on pouvait jouir de la liberté que
n’avaient pas eu nos parents, où on écoutait Madness, Pink Floyd ou Police.
Celle aussi de « l’héro » qui circulait partout, y compris dans les
campagnes, qui faisait qu’au matin on découvrait ces « enfants
endormis » dans les toilettes des bars où ils étaient allés prendre leur
dose. Il en a fallu du temps pour qu’on comprenne le mode de transmission de ce
virus isolé, l’auteur le rappelle, par des chercheurs français opiniâtres comme
Willy Rozenbaum, Luc Montagnier ou Françoise Barré-Sinoussi – j’en oublie – et
qui ont su faire fi des préjugés de l’époque. En contrepoint à l’histoire de
Désiré que reconstitue son neveu, on découvre tous les tâtonnements, les
essais, les échecs de cette longue bataille contre le virus, ainsi que la
concurrence féroce entre les équipes françaises et américaines. Au-delà que
l’hommage rendu à ces scientifiques pour l’Histoire, et à Désiré pour ce qu’il
a traversé, ce roman rappelle que si la médecine a fait d’énormes progrès et
qu’être séropositif aujourd’hui n’empêche nullement d’avoir une espérance de
vie tout à fait satisfaisante, le sida, s’il n’est pas traité, reste mortel.
Catégorie :
Littérature française
sida
/ années 80 / drogue / famille / tabou / médecine / traitement /
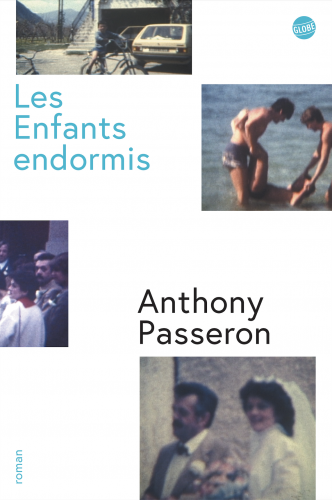
Posté le 19/10/2022 à 17:25
Un ancien combattant de la Grande Guerre
amputé d'une main se consacre, lors de son retour à la vie civile, à la
recherche des soldats disparus sur le front, à la demande des familles. Il part
sur les traces du soldat Joplain, missionné par sa mère. Son enquête, à
laquelle il va consacrer années, lui fait découvrir l’existence d’une jeune
fille dont Joplain, poète et romantique, était très épris, ainsi qu’un
personnage que les poilus surnommaient « la fille de la lune » et qui
les réconfortait sur la ligne de front, échappant comme par magie aux balles
allemandes… Une quête qui va emmener le narrateur loin, bien loin de l’ambiance
morose de l’époque et de la deuxième guerre qui se profile…
Que n’a-t-on écrit de cette « Grande
Guerre », des conditions atroces dans lesquelles se battaient les poilus,
des tentatives de désertion, de cette immense boucherie ? Le roman ne fait
pas l’impasse sur cette réalité-là, mais s’attache à un autre pan de l’histoire
de l’après-guerre. Celui des milliers de morts non identifiés, et des familles
qui n’ont pas pu faire leur deuil faute de corps reconnu. Voilà le métier
qu’exerce le narrateur, retrouver les disparus. Des enquêtes de longue haleine,
de véritables jeux de piste et un travail de fourmi consistant à accumuler des
miettes d’informations, à rencontrer différents acteurs des atrocités
militaires qui vont lui raconter de multiples anecdotes. Il pourrait se
décourager ; il persévère. C’est sans doute que la découverte de la
relation entre Lucie, la jeune Alsacienne devenue aide-infirmière sur le front,
et son fiancé, promu traducteur parce qu’il maîtrise quelques phrases
d’allemand, l’a renvoyé à son propre passé et lui a permis d’en faire le deuil.
Une histoire d’amour qui fait fi des balles perdues et des scharpnels, des gaz
et des tirs de mortier, et qui s’achève un peu facilement à mon goût par une
pirouette narrative dans le « son déchiré d’un accordéon rance ».
Catégorie :
Littérature française
première
guerre mondiale / poilu / amour / recherche / disparu /
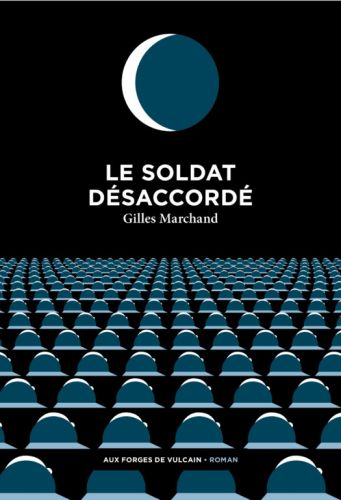
Posté le 19/10/2022 à 17:23
Paul Renoir, chef triplement étoilé du
restaurant gastronomique "Les promesses" à Annecy, reçoit la
consécration suprême : il est élu meilleur cuisinier du monde. Une équipe de
Netflix a filmé une longue interview du chef et s'apprête à faire un reportage
sur sa brigade. Alors que toute l'équipe l'attend, Renoir n'arrive pas. Et pour
cause : il vient de mettre fin à ses jours dans sa chambre avec son fusil de
chasse. Le roman alterne entre deux récits : d'un côté, le parcours de Renoir,
ses débuts auprès de sa grand-mère, ses classes auprès de Paul Bocuse, son
succès progressif prix d'une exigence et d'un stress constants, au sein d'une compétition
féroce où s'affrontent les égos démesurés ; en contrepoint, c'est le devenir du
restaurant dont il est question, alors que l'entreprise était au bord de la
faillite, et l'avenir de l'équipe, de son second, de sa cheffe pâtissière
japonaise, et de sa femme.
Gautier Battistella nous entraîne dans un
monde de la haute cuisine tout à fait plausible. C'est que, journaliste
gastronomique au guide Michelin, il connait son affaire et les travers de cet
univers où les élégances des dressages et l'harmonie des accords mets-vins
cachent une réalité parfois bien peu reluisante. Brimades des apprentis,
querelles au sein des brigades, ambition, jalousie, égocentrisme, conditions de
travail insupportables, harcèlement, épuisement, collusion pour faire tomber un
rival, sans parler de la pression médiatique et financière que subissent les
chefs étoilés. C'est justement l'événement déclencheur de ce récit, avec le
suicide de ce chef qui rappelle, de façon transparente, celui de Bernard
Loiseau en 2003, ou celui de Benoît Violier, chef suisse, en 2016, ou enfin, plus
récemment, celui du chef mosellan Marcel Keff.
A l'heure où l'on parle de texture et
d'umami, d'une cuisine réinventée et écoresponsable, du respect du produit, de
sans gluten ou sans lactose ou de produit d'origine animale ; à l'heure où un
œuf mollet ne se sert que revisité et un millefeuille forcément déstructuré, la
cuisine est devenue un jeu où tous les coups sont permis. Le menu gastronomique
n'a plus la même saveur... Et si on allait au bistro manger un bourguignon et
une île flottante ?
Catégorie
: Littérature française
gastronomie
/ chef / cuisine / compétition / trahison /
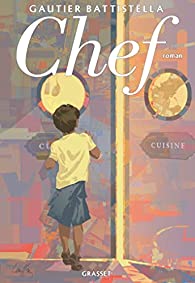
Posté le 19/10/2022 à 17:14
Mauvaise période pour Alan. Son premier
roman a été un échec commercial, sa compagne vient de le quitter en lui
conseillant d’écrire un « roman sérieux » et son meilleur ami s’est
suicidé. Ses voisins partent en vacances et lui demandent de s’occuper de la
piscine. Quelle meilleure opportunité pour Alan qui se promet de consacrer ses
journées à entrer dans ce projet de « roman sérieux » et d’écrire à
l’ombre de la terrasse dix mille signes par jour.
Il semble avoir trouvé un sujet. Son
prochain opus s’appellera Sol y sangre et racontera le périple de ses
grands-parents espagnols venus trouver asile en France pour fuir le régime
franquiste. Et puis non, une joggeuse des alentours disparaît, il décide d’ne
faire le sujet de son œuvre à venir. De tergiversations en atermoiements, Alan
n’avance pas, se remémore des moments de sa relation avec Lisa, s’invente des
interviews avec Claire Chazal ou François Busnel, tandis que l’eau de la
piscine blanchit puis verdit, et accueille de curieux insectes. Comme à son
habitude, Fabrice Caro truffe son récit de scènes hilarantes – la première
rencontre avec les parents de Lisa, la description du spectacle de bûto sont à
mourir de rire – mais au final, la grande question de son récit est bien le
manque d’inspiration et la tendance à la procrastination qui saisit l’écrivain.
Rien de drôle là-dedans, mais Alan l’écrivain un peu raté a la suprême élégance
de continuer à y croire – un peu – et de manier l’auto dérision avec un panache
certain.
Catégorie :
Littérature française
écriture
/ inspiration / procrastination / humour /
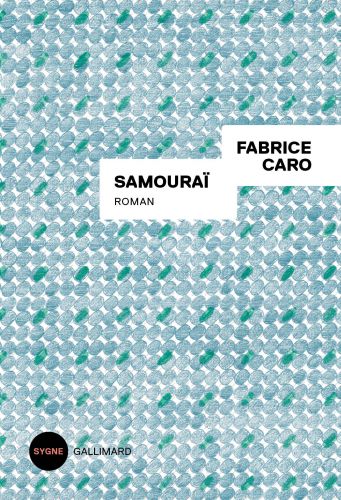
Posté le 19/10/2022 à 17:05
Sur l’île de Stomboli existe un hôtel
tenu par Guillaume, un Français quarantenaire père de Giulia, 15 ans.
L’adolescente porte le nom de sa mère, morte en la mettant au monde. Elle donne
un coup de main à l’hôtel et se lie avec quelques-uns des clients, notamment
Abigale, qui attend Eytan, son amant qu’elle retrouve épisodiquement lors de
ses séjours. Se croisent aussi Lior, qui va consoler Thomas de la perte de son
grand amour Emilio, dont on n’a jamais retrouvé le corps disparu au large de
l’île, la comtesse Elena, nostalgique d’un passé révolu, Ethel et son frère
Ezéchiel enfin retrouvés, Tom qui vit avec un fantôme qu’il a surnommé Gris,
Sevda, épouse d’Anton, un médecin russe infidèle.
On pourrait vite se perdre dans ce
roman choral, à passer ainsi d’un personnage à l’autre, mais au fil du récit
les propos de chacun se resserrent. Le volcan se réveille, l’expédition à
laquelle participent de nombreux clients se transforme en cauchemar. Le tempo
s’accélère, et le destin des uns se retrouve inextricablement lié à celui des
autres. Ce récit est bien construit, joliment écrit, et fait la part belle aux
amours et au désir, notamment celui de Lior pour Thomas, qui à vingt-cinq ans
fait l’amour pour la première fois.
Catégorie :
Littérature française
Sicile
/ île / amours / hôtel / destin /
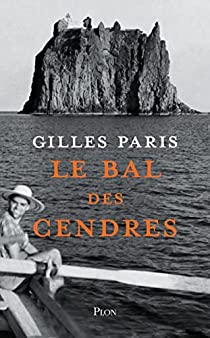
Posté le 19/10/2022 à 16:49
Attendre. Attendre quelqu’un sur un
quai de gare. Occuper l’attente à des riens, observer les de passagers en
transit, faire remonter des souvenirs… Quoi de plus banal ? Ce thème éculé
est cependant traité dans Jour bleu avec une sensibilité et une originalité – à
commencer par les circonstances qui ont mené Chloé à attendre au Train bleu garde de Lyon un passager
qu’elle connait à peine. Petit-à-petit, elle nous dévoile sa rencontre avec ce
photographe trois mois plus tôt, et cette promesse de se retrouver le 19
septembre à 13h17, sans savoir avec certitude si chacun sera au rendez-vous.
Elle en a tant pris, des trains, pour
passer d’une maison à l’autre avec son frère. Enfants de parents divorcés,
enfants en transit dans des voyages hebdomadaires où elle sortait ses carnets
pour faire ses devoirs. Histoire de passer le temps, et de ne pas avoir trop
mal. Mais c’est fois, ce n’est pas elle qui voyage. Elle attend. Le temps s’étire,
entre souvenirs d’enfance et interrogations sur ce pari des retrouvailles. Viendra-t-il,
cet homme dont elle sait si peu de choses ? Viendra-t-il, celui qu’elle
espère, celui qu’elle imagine, une main qui prendrait la sienne, un long baiser
dans le creux de sa nuque. Les minutes s’égrènent, l’émotion monte doucement, et
le désir aussi, retrouvé, impérieux. « Le désir est toujours tapi quelque
part, prêt à bondir. Quand il surgit, nous voilà de nouveau frais et brillants,
lavés de tout ce qui a pu nous abîmer, nous amoindrir, aptes à accueillir avec
avidité le chapitre qui se présente. C'est étonnant, cette capacité à se
renouveler. A faire table rase. » Aurélia Ringard a su, avec délicatesse,
d’une plume précise et belle, nous prendre par la main et nous emmener avec
Chloé, le souffle suspendu, après trois heures d’attente, jusqu’au quai numéro
7 où le train entre en gare. Une nouvelle histoire commence.
Un roman remarquable, qui mériterait
largement d’être davantage présent sur les étals des libraires.
Roman lu dans le cadre des
« 68 premières fois ».
Catégorie :
Littérature française
attente
/ gare / train / coup de foudre /
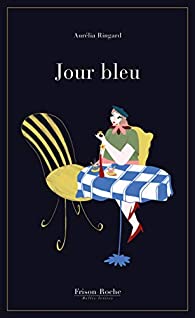
Posté le 27/07/2022 à 12:09
Isabelle suit son mari dans ses
mutations à l'étranger, avec leurs deux filles. Après l'Italie et la Suède,
cette fois la famille part pour Taiwan. Femme de, oisive, elle ne déborde pas vraiment
d'enthousiasme pour organiser un énième déménagement et recréer des liens
sociaux avec les autres expatriés. Les épouses notamment, celles qui occupent
leurs journées sans grands projets et inscrivent leurs enfants dans des lycées
français. Isabelle n'est pas tout à sa place dans ce monde-là. Le coma de sa
mère la contraint à revenir en France, où elle va profiter de l'occasion pour
participer à la rencontre des membres d'un atelier d'écriture auquel elle s'est
inscrite.
Au chevet de sa mère inconsciente,
Isabelle se rappelle son enfance avec ses deux frères, la mort de son père à 37
ans, sa mère courage qui a élevé seule ses enfants ; elle est davantage
bouleversée qu'elle ne s'y attendait et veille chaque jour à l'hôpital, où elle
sympathise avec le kiné qu'elle surnomme Kiki Baloo, où elle tente
d'apprivoiser un agité du bocal qu'elle appelle Au hasard Balthazar. Sa manie
des surnoms – dont elle a affublé non sans cruauté quelques-uns de ses
homologues de Taïwan (Blandine de la Chatte, Blanche Pubis ou Ludivine de la
Prostate) concourt à donner à ce récit introspectif une tonalité drôle qui
vient tempérer la gravité des questionnements de la narratrice qui manie
l'autodérision sans concession. Parce que sous l'apparente légèreté se tisse
l'histoire d'une presque cinquantenaire qui s'interroge sur ses choix de vie,
sur ce qui la lie encore ou non à son mari et à ses filles, sur ses origines
modestes qui détonnent dans le milieu que le salaire de son mari lui a ouvert.
Est-elle encore heureuse ? Elle imagine les grandes mains de Kiki Baloo, elle s'imagine tomber en amour avec Gaspard, l'animateur
de l'atelier d'écriture – un fantasme qui va tourner court et lui fera écrire
que "le meilleur moment, c'est toujours avant". La plume est alerte,
l'humour féroce, mais il manque au récit un je ne sais quoi qui aurait permis à
Isabelle de toucher autrement son lecteur qu'en le faisant sourire de ses
saillies corrosives.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie :
Littérature française
étranger
/ couple / expatrié / famille /
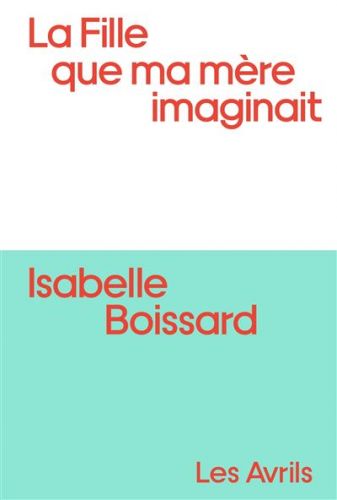
Posté le 27/07/2022 à 12:06
Bérénice, archéologue, est employée par
"Tonton" pour récupérer et vendre des œuvres d'art glanées sur des sites
archéologiques. Au cours d'une de ses expéditions à la frontière turco syrienne,
elle découvre la guerre syrienne et prend en charge une petite fille que lui
confie sa mère, réfugiée dans un camp. La petite est muette, traumatisée, et
Bérénice se sait que faire de cette enfant qu'elle ne peut abandonner. Les
voici en Turquie, sur la trace d'un ancien pompier syrien qui pourrait leur
fournir de faux papiers pour rentrer en Europe. Bérénice fait ainsi la
connaissance d'Asim, que la guerre et la douleur de la perte de sa sœur ont
conduit ici, et qui ressuscite la mémoire des morts en donnant leurs noms aux
opposants au régime d'El Assad.
Plongée au cœur d'une guerre dont les
Occidentaux que nous sommes ignorent tout, ou presque. Julie Ruocco nous
raconte les attentats, les bombardements, les camps de réfugiés, l'opposition
muselée, les femmes sous le joug d'une conception médiévale ; à travers le
combat de Taym, la sœur d'Asim, sont dénoncés la barbarie et les exactions du
régime djihadiste, les exécutions et les tortures que la jeune femme consigne
sur une clé USB que va découvrir Bérénice. Pour elle, c'est une prise de
conscience progressive de la réalité qui l'entoure, et d'une nouvelle mission
qu'elle va devoir remplir : "Eclairer les contours du monstre, délimiter
son empire mouvant pour le priver de l'ombre qui le nourrit", comme l'a
écrit Taym au-dessus des retranscriptions d'entretiens figurant sur la clé. Devenir
une Furie à son tour, et sans repos poursuivre les criminels et défendre les
siens. Face à elle, Asim, qui a fouillé des charniers, s'efforce de garder
intact le souvenir des morts étouffés dans les ruines pour les donner à ceux
qui fuient. Cette transmission qu'il fait, cet hommage qu'il rend, jusqu'au
dernier nom, le plus précieux, qu'il va donner à la petite fille, sont à mon
sens la partie la plus touchante de ce récit dont la plume très travaillée met
cependant le lecteur un peu à distance.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Littérature française
Syrie
/ guerre / deuil / résilience /
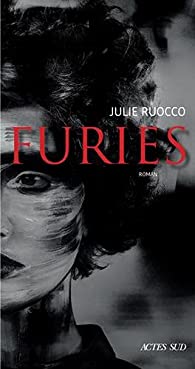
Posté le 27/07/2022 à 12:03
Deux filles se rencontrent un soir de
Noël et échangent ensuite par SMS. Arrive le printemps empêché de 2020. Les
échanges se multiplient, l'attirance réciproque devient évidente, au point de
rendre cet amour naissant à distance insupportable. La narratrice, dûment
équipée de six attestations différentes, traverse un Paris déserté pour aller
retrouver l'élue de son cœur, chez laquelle elle va s'installer. Pari risqué
mais pari réussi, l'amour en présentiel est à la hauteur des attentes des deux
partenaires.
C'est un récit d'amour, qui fait la
part belle au désir, à l'érotisme, à la tendresse. Un récit du quotidien aussi,
qui n'omet pas les listes de courses ou les textos bourrés d'émoticônes. Son
point fort, c'est donner à cette histoire entre deux femmes une portée
universelle ; ailleurs, les urgences sont débordées et l'on meurt loin de ses
proches, mais dans cet appartement de la rue Rampal on s'aime et on vit. Son point
faible, c'est une narration qui ne repose que sur ça justement, cet amour né à
distance et que la vie ne parvient pas à mettre à terre, dont la forme originale pourra plaire ou
agacer.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
amour
/ confinement / érotisme /
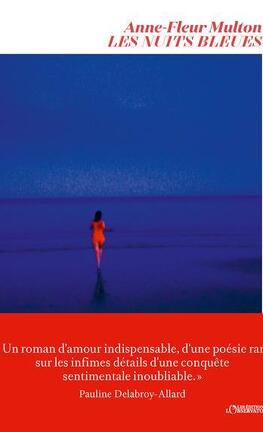
Posté le 27/07/2022 à 11:59
"Je m'appelle Mona, j'ai
quarante-six ans, je suis en couple avec Paul depuis douze ans, j'ai trois
enfants dont deux d'un précédent mariage, et il y a quelques mois j'ai
rencontré Vincent." Voilà l'incipit – ou presque – de ce roman qui traite
de l'adultère. Encore, pourrait-on penser à la lecture des premières pages du
roman, sauf que ce thème éculé est mis en lien avec la relation de Mona avec
son père, que l'on va découvrir au fil de ses conversations avec Vincent. Lui,
c'est son prof de yoga, marié et heureux en couple, qui vient depuis l'Ardèche trois
jours par semaine à Paris donner ses cours. Mais ce qui attire Mona, et ce qui
délie sa langue et lui permet de dire ce qu'elle a toujours tu, c'est cette
enfance cabossée qu'ils partagent. C'est d'abord Vincent qui s'épanche, raconte
la mort du père et l'abandon de ses rêves de compositeur. Alors, Mona peut se
libérer, poser "ce fardeau, cette fiction [d'elle-même qu'elle] traîne
comme un vieux chiffon d'enfance". Elle dit ce père dont le souvenir la
hante encore, qui "surgit comme un platane", dont elle sent encore
l'odeur de tabac froid. Un père que la pauvreté a conduit à utiliser sa fille
pour voler dans les supermarchés, à aller dans des restaurants pour se faire
établir de fausses notes de frais. Mona s'est appliquée, que n'aurait-elle pas
fait pour obtenir un peu d'amour de ce père maltraitant et abusif ? Jusqu'à ce
matin de la naissance de son petit frère, qui vient faire basculer le lien dans
l'horreur.
Malgré quelques maladresses dans un
style volontairement très imagé – le "cœur braqué comme un distributeur de
billets" m'a laissée pantoise -, ce récit fait mouche. Parce qu'il a
quelque chose de lumineux, à travers l'attirance et le partage de ces deux
êtres qui ne veulent ni ne peuvent bouleverser la vie qu'ils ont construite,
mais dont la rencontre a permis de panser les blessures.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
couple
/ adultère / traumatisme / deuil /
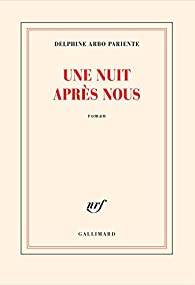
Posté le 24/06/2022 à 11:33
La mère de Paloma vient de mourir, lui
laissant en héritage une vieille maison au fin fond des Cévennes. Qu'en faire,
se demande Paloma qui n'a de douceur que pour sa fille Pimpon et a souffert du
désamour profond de celle qu'elle n'a jamais pu appeler autrement que par son
prénom, Camille. L'héritage s'accompagne d'un cahier que Paloma va lire quand
elle arrive au village. Elle découvre une ancienne magnanerie délabrée, mais une
vue superbe sur les montagnes. Contre toute attente, elle décide de s'y
installer et de la retaper tout en exerçant comme infirmière libérale. Un an
plus tard, un couvreur vient établir un devis : c'est Jacques, à qui très vite
Pimpon donne du "saint". Et voilà que Paloma sent son corps
s'échapper.
Après Suiza, Bénédicte Delpois s'attache à une femme mûre, indépendante,
que la vie n'a pas épargnée, et qui vit, au milieu des Cévennes, un deuxième
printemps. On y retrouve, comme dans son premier roman, la langue précise,
affûtée et vive, l'humour, notamment à travers les piques de Pimpon, et les
personnages parfaitement campés, pour lesquels on ne peut qu'éprouver de la
tendresse. Enfant mal aimée, maternité précoce, accident, le danger était grand
de sombrer dans le pathos mais sous son apparente simplicité ce récit se joue
des pièges romanesques et se clôt sur un dénouement parfaitement raccord.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
montagne
/ famille / maternité / deuil /
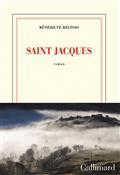
Posté le 24/06/2022 à 11:32
L'auteur rend hommage à sa mère, Maria
Nieves, dite Neige. Fuyant le régime de Franco, les parents de Neige arrivent
en France à la fin des années 30 et s'installent dans un bidonville à la
Plaine-Saint-Denis, au milieu d'immigrés de nationalités diverses. Maria est
scolarisée et s'avère être une excellente élève, mais elle subit une forte
discrimination à cause de ses origines espagnoles. Elle fait preuve cependant
d'une grande volonté, aidée par ses nombreuses lectures. Passionnée par les
mathématiques, elle va parvenir à poursuivre ses études. Elle va rencontrer
Gabriel, amoureux des fractales, et l'épouser. Le 27 mars 19987 naît Olivier.
Fin de la première partie et du récit des
origines. Place ensuite à la relation mère-fils, et à cet amour profond que
l'enfant voue à sa mère. Une mère qui ne devait pas être toujours facile à
vivre, investie dans son métier d'enseignante et son engagement écologique,
éternelle révoltée, farouche indépendante. Olivier Liron fait le portrait d'une
femme et d'une mère, et raconte aussi ses origines espagnoles à travers le
personnage de sa grand-mère Carmen. Il y a dans ce récit très personnel et
pourtant pudique une très grande tendresse à laquelle on est forcément
sensible.
Catégorie
: Littérature française
Espagne
/ migrants / misère / lecture / mère / famille /
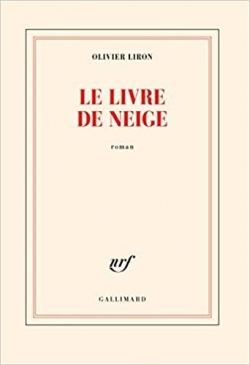
Posté le 06/06/2022 à 18:48
La narratrice a huit ans quand elle
arrive pour la première fois dans ce petit village des Pyrénées. Et puis elle
en repart, quelques années après. Entre temps, elle a découvert le village et
ses habitants, elle a parcouru les sentes et gravi des pentes, elle a vu passer
l'hiver, fondre la neige et refleurir les jonquilles. Elle raconte, par petites
touches, ce qu'elle apprend d'Aulus : sa splendeur passée d'ancienne station
thermale et le Grand Hôtel de Paris acheté par son père, mangé par la
pourriture et où il entasse une invraisemblable collection d'objets disparates
; ses habitants dont elle fait le portrait : Marie l'épicière revêche, Nicole
et ses chevaux, les manies de Perce-neige, Pierre le chanteur, les deux Paul,
René l'artiste de la nature ; ses montagnes qui enserrent le village et le
maintiennent l'hiver dans une pénombre quasi permanente. Petit-à-petit Aulus se
dessine et s'affirme, avec un peu d'humour, un peu de gravité, se crée une
place dans l'imaginaire du lecteur. En contrepoint, la description de photos de
l'époque des bains vient ancrer le village dans son histoire. Des raisons pour
lesquelles la narratrice et son père finissent par quitter le village, on n'en
saura rien ou presque. Mais quand le camion s'éloigne, reste la trace tangible
de ce séjour en montagne, comme une photo que l'on glissera dans les pages d'un
livre, en fidèle marque-page de ses prochaines lectures.
Lu dans le cadre des
"68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
montagne
/ village / peinture / père /

Posté le 06/06/2022 à 11:46
Alice rédige une thèse consacrée aux
thanatopracteurs. Elle observe le travail des professionnels, les interroge sur
leur pratique, ignorant encore où la mènera son travail. Cette fois, elle
accompagne Sylvain Bragonard, qui la désarçonne par son caractère taiseux et
ronchon. Elle ne se laisse cependant pas intimider, et s'étonne de sa capacité
à dépeindre le caractère des défunts grâce aux odeurs subtile qu'il perçoit
quand il leur prodigue les derniers soins.
Il a beau avoir un nez, il n'est décidément
pas d'un abord facile, Sylvain, et il n'y a bien que lorsqu'il décrit les
parfums qu'il devient un peu loquace. Alice a deviné, et nous aussi, que
l'homme cache derrière sa rudesse un traumatisme qu'il soigne à coups de
vinaigre qu'il boit par verres entiers et par une hygiène maniaque. Alice,
elle, ne connait rien aux odeurs, mais elle adore la musique. Dans le genre
éclectique, qui ne craint pas de passer de Janis Joplin à Aznavour, de Cloclo à
Léonard Cohen, elle se pose et s'impose, quitte à malmener cet homme renfermé
qui va bien finir par s'ouvrir. Ce roman, qui traite d'un sujet original et peu
exploré, à part dans la série Six Feet
Under, fait la part belle aux parfums dont l'auteur semble avoir une solide
connaissance. C'est le plus d'un roman auquel je reprocherai cependant des
parties psychologiques un peu trop explicatives, qui brident l'imagination du
lecteur.
Lu dans le cadre des
"68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
mort
/ deuil / parfum / odorat /

Posté le 06/06/2022 à 11:45
Jacky Toudic rentre dans sa région
d'origine, en Franche-Comté, pour s'occuper de sa mère atteinte d'Alzheimer,
dont il va falloir payer la pension en EHPAD. L'occasion aussi pour lui de se
mettre un peu au vert. En effet Jacky exerce un métier bien particulier : il
est le sosie parfait de Mathieu Kassovitz, et il profite de sa ressemblance
pour monter des arnaques qui lui ont fourni un joli pécule qu'il a placé sur
des comptes au Luxembourg. … Jacky retrouve ses anciens potes et rencontre Zoé,
une jeune avocate qui va le convaincre de monter une gigantesque escroquerie…
Les copains de Jacky le convient à leurs
apéro-morgue où officie Le Parrain, légiste de son état, qui conserve des
grands crus dans un tiroir mortuaire réglé à la température idéale de 12 degrés
; y participent également Yann, qui fait la statue de la liberté sur son skate dans
les rues et ne retire jamais son costume, et Elder, nouvelle recrue, mystique corse
et complotiste jusqu'à l'os. Tout le monde se retrouve pour boire dans des
gobelets en plastique en trinquant à la santé du dernier client du légiste, un
acteur de porno décédé d'une crise cardiaque. Pendant ce temps, la mère,
ancienne agrégée de philo, reste persuadée que Nagui est son fils et prend
Jacky pour son médecin à qui elle demande de lui prescrire du cannabis. Lui, il
peaufine son arnaque à La Haine 2. Un
récit désopilant, qui pique et tape sur tous les milieux sociaux, des bobos au
quidam de Besac, truffé de scènes loufoques et de personnages qu'un grand sens
moral n'étouffe guère, mais aussi, derrière l'humour, un œil acéré sur la société
contemporaine, l'inhumanité des EPHAD et les probables souvenirs d'un auteur
qui a donné son propre prénom à son protagoniste. C'est méchant, irrévérencieux
et drôle à souhait.
Catégorie
: Littérature française
Besançon
/ arnaque / cinéma / amitié /
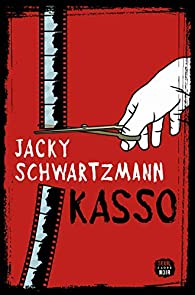
Posté le 06/06/2022 à 11:42
Palais de justice, mai 2016. Alma Revel est
juge antiterroriste. Elle doit se prononcer sur le jugement d'un homme de
retour de Syrie, suspecté de terrorisme d'islamisme radical. La tâche est
d'autant plus compliquée que, mariée, elle a pour amant l'avocat qui représente
le prévenu. Elle est en plein dilemme professionnel et personnel...
Alma doit décider : condamner Abdeljalil
Kacem à la réclusion préventive, au risque de réduire à néant sa vie, ou avoir
foi dans son repentir ? Finir par divorcer, et s'investir dans sa nouvelle
relation, ou y renoncer par déontologie ? Décider, c'est choisir, trancher,
donc écarter l'une des deux solutions. Sans que jamais on ne soit sûr d'avoir
fait le bon choix. C'est le fil conducteur de ce roman dont le titre, au
singulier, pointe exactement la problématique. Choisir, c'est prendre des
risques. Avec des conséquences qu'on est incapable de mesurer sur le moment.
Alma nous emmène dans ses doutes et ses interrogations face au discours du
supposé djihadiste, et nous fait découvrir le quotidien d'un juge
antiterroriste, les pressions, la surveillance policière, le poids des
responsabilités, le délicat équilibre à trouver entre méfiance et empathie face
au prévenu. Un hommage assumé à ces agents de la justice et un roman ancré dans
le réel, passionnant malgré un rebondissement final un peu attendu.
Catégorie
: Littérature française
justice
/ terrorisme / famille / couple /
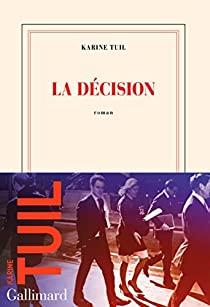
Posté le 06/06/2022 à 11:40
Un petit village, quelque part en Corse. Alors
qu'on vient tout juste d'enterrer le vieux Lenzani que tout le monde détestait,
le baron Delezio a organisé une grande fête en l'honneur de Raffaele,
l'héritier de la famille, pour célébrer la fin de ses études secondaires. Toute
la population est réunie pour l’occasion, dont Libero Solimane, amoureux de la
jeune femme du baron, et camarade de Raffaele. Mais les festivités sont
interrompues par un drame : le corps de la vieille Herminia est découvert dans
la chapelle du Palazzo. Le lendemain, Rafaele disparait, etLibero aperçoit des
cavaliers emportant un corps dans le massif de l'Argentu. Il décide de les
suivre. Les heures qui vont s'enchaîner vont bouleverser son existence et sa
vision du monde…
Roman d'apprentissage, ce récit est
remarquable à plusieurs titres : dans sa construction dramatique inspirée des
tragédies antiques, dont la montée en tension est remarquablement maîtrisée,
dans la dimension psychologique des personnages, et dans la présence d'une
nature aussi dure qu'elle est splendide. Le tout servi par une plume belle et
précise. En contrepoint du récit d'autres personnages prennent la parole, morts
ou vivants, dont la voix ajoute à la tension progressive, révélant des secrets
mortifères. Caché dans la grotte, Libero les découvre en même temps qu'il
s'éveille à l'amour et à la sexualité. A Ogliano, on se tait et on fait bonne
figure, et si comme Libero et Rafaele on essaie de briser des tabous, il faut
le faire en toute discrétion, sans que rien ne transpire jamais. Il est vain de
vouloir lutter contre eux et contre le déterminisme social, et Rafaele le sait
trop bien, qui a pour livre de chevet Antigone
de Sophocle. Mais on peut essayer.
Catégorie
: Littérature française
Corse
/ village / secret / famille / initiation / amour / vengeance /
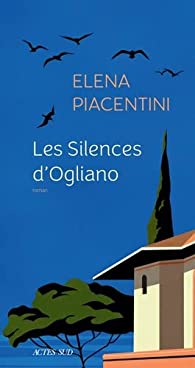
Posté le 06/06/2022 à 11:37
Louise est presque entièrement sourde. Elle
parvient à percevoir quelques sons de l'oreille droite, et à lire sur les
lèvres, grâce à son sonotone, mais elle s'épuise à fournir tant d'efforts pour
pouvoir encore communiquer. On lui propose de l'équiper d'un implant.
L'opération est lourde et les conséquences non négligeables...Adèle hésite.
Certes, elle pourra ainsi rejoindre le monde des entendants. Mais cela signifie
aussi qu'elle va abandonner un univers certes handicapant mais familier, et
verra son mode de vie profondément modifié. Le choix n'est pas simple...
Comment décrire un son, surtout quand on ne
veut pas l'oublier et qu'on n'entend plus ? Louise a fabriqué un herbier
sonore. Chaque bruit y est consigné, avec des comparaisons imagées et beaucoup
d'humour : ainsi les oignons frits dans l'huile sont-ils décrits comme un
"conciliable de lapins ivres" ; l'orage est une "calotte
glaciaire sur le feu", la grêle une "avalanche de dents de lait et
les feuilles mortes une "mâchoire qui mâche des mouches séchées".
Mais cette compilation est impuissante à enrayer l'inéluctable progression de
sa surdité, qui s'accompagne d'étranges compagnons qui viennent hanter son
quotidien : Cirrus d'abord, un chien parfois agressif, puis un poilu alcoolique
et cocaïnomane, et enfin une botaniste qui recense des plantes
"miraginaires", des êtres qu'elle est seule à voir, à l'exception d'un
spécialiste en hétérogenèse, qui identifie ces personnages comme des fantômes
traumatiques dont Louise doit se défaire.
Pour nous faire entrer dans l'univers des sourds, Adèle Rosenfeld a
choisi de faire un récit extrêmement imagé, presque poétique parfois. Cette
intention contraste d'ailleurs avec le prosaïsme du monde du travail que
découvre Louise, qui a décroché un job dans une mairie et affronte
l'incompréhension, la pitié puis le rejet des entendants. Un premier roman
original, déconcertant, qui possède d'indéniables qualités, mais dont la
construction narrative un peu confuse rend la lecture laborieuse.
Catégorie
: Littérature française
surdité
/ chirurgie / implant / peur /

Posté le 09/05/2022 à 18:02
C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé
Martin Hill, qui vit à Londres, de père anglais et de mère française, qui se
séparent. Nous sommes en 1999, le casting pour l'adaptation cinématographique
de Harry Potter démarre. Le père de Martin, accessoiriste sur le tournage d'un film
dirigé par le futur réalisateur d'Harry Potter, emmène son fils pour y faire de
la figuration. Martin, à cause de sa ressemblance avec le héros de la saga, est
remarqué par le réalisateur, qui lui fait passer des essais. Au final, il est
en compétition avec David Radcliffe, et c'est ce dernier qui sera finalement
retenu. Martin va ruminer son humiliation.
C'est donc l'histoire du numéro deux, celui
qui n'a pas été choisi. Celui à qui on a préféré un autre, et qui va devoir
vivre avec ce ratage. Quand on tombe de cheval, il faut aussitôt remonter.
Martin n'y parvient pas. Son échec est une véritable obsession dont il ne peut
se défaire tant tout le succès mondial de la saga lui rappelle sans cesse son
échec. Comment échapper aux affiches, aux campagnes de promotion, aux piles de
livres mis en avant dans les librairies ? La blessure reste si béante qu'un
seul tome de Harry Potter au pied du
lit de sa première petite amie le fait fuir à toutes jambes. Non sans un
certain humour, David Foenkinos nous raconte les tentatives désespérées de
Martin pour échapper à la pottermania et pour exister. Le récit nous fait
également découvrir les coulisses de la parution du premier tome des aventures
du sorcier le plus célèbre de la planète, et du tournage de son adaptation. Il
ravira les fans de la saga. Les autres apprécieront, ou non, le catalogue de
célébrités et le surf sur la vague du succès de J.K.Rowling.
Catégorie
: Littérature française
cinéma
/ acteur / échec / jalousie / succès / best seller /
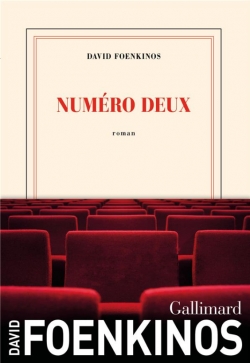
Posté le 09/05/2022 à 17:59
Elena et Cesare arrivent en région parisienne
dans les années 50 avec leurs enfants, sauf Tonino, qui naitra en France. "Porca
miseria, porco Dio !" crie le père quand il a bu, tandis que la mère se
désole de la "rouiiiina" dans laquelle elle se trouve depuis qu'elle
a changé de classe sociale en épousant un Benacquista. L'auteur raconte son
enfance au sein de cette famille où l'on parle un sabir fait du ciociaro,
dialecte parlé dans la région du Latium et de mots italiens francisés, auquel
ils mêlent des termes français ; il raconte son envie grandissante d'écrire, au
point de transformer ses devoirs de sciences en rédactions diversement
appréciées par ses professeurs. Pourtant, il ne parvient pas à lire, à
l'exception des Chroniques martiennes
et de Cyrano de Bergerac. Jusqu’à ce
qu'un jour, l'école lui impose Une vie
de Maupassant. "Je sens déjà poindre le devoir d'admiration, car tout ce
que je vais lire sera vrai, juste, brillant, panthéonisé, incontestable. Une
vie, c'est long. 448 pages. Une mort
aurait été un meilleur titre." La lecture est pour le moins fastidieuse,
le lecteur bien trop critique pour se laisser prendre par l'histoire. Et voici
soudain que le miracle opère, qu'un rebondissement emmène l'adolescent tout
juste là où Maupassant voulait le conduire. Ces quelques pages valent tous les Que sais-je et les corpus d'analyse,
tandis que cette lecture va faire de Tonino un lecteur, et bientôt un auteur.
D'une plume alerte, drôle, tendre aussi,
Benacquista nous livre un récit très personnel et sans fard dans lequel il
narre l'alcoolisme de son père et son agoraphobie dont il a eu tant de mal à se
défaire. On sent le plaisir que prend ce "fabricant de fictions"
comme il se nomme à raconter ses souvenirs familiaux ou d'école, à réinventer
la vie de ses parents en leur écrivant un autre destin. Et, aussi, à parler de
l'art d'écrire. "La fiction, c'est du rêve fait main. […] C'est un stylo
et un bloc-notes, une phrase qui en appelle une autre, à condition de tenir en
place et de n'avoir rien de mieux à faire. Ecrire n'autorise aucune exhibition
de l'égo ni ne procure de satisfaction immédiate ; on ne s'asperge pas de
peinture, on ne casse les oreilles de personne
avec des fausses notes, on ne franchit pas de ligne d'arrivée sous les
bravos". L'auteur de La Commedia des
ratés ou de Saga, pour ne citer
qu'eux, nous offre là un récit émouvant, et jubilatoire.
Catégorie
: Littérature française
autofiction
/ famille / Italie / écriture / lecture / cinéma /
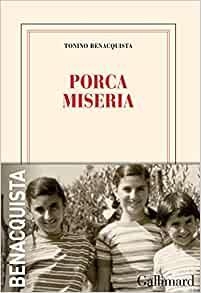
Posté le 09/05/2022 à 17:57
A presque quarante ans, mariée, deux
filles, un poste à responsabilités dans un cabinet d'audit et une belle maison
d'architecte, Hélène a rempli tout le cahier des charges de la réussite sociale
et professionnelle. Christophe est tout l'inverse : ancienne star de l'équipe spinalienne
de hockey et du lycée, en plein divorce, devenu représentant en nourriture pour
chiens, il vit avec son père et son fils dans un pavillon. Si Christophe semble
avoir raté sa vie à proportion qu'il prenait du ventre, Hélène n'aurait pas de
quoi se plaindre, mais elle sombre dans des questions existentielles
inconfortables. Et voilà que ces anciens camarades de lycée se croisent, l'une
suscitant l'envie de l'autre, l'autre lui faisant retrouver la nostalgie de son
adolescence...
En fréquentant Christophe, Hélène ne fait
pas que replonger dans le monde de son adolescence. Elle change aussi de milieu
social, et (re)découvre l'univers populaire où l'on s'enquille des bières et
des chips, et où on chante, debout, la main sur le cœur, "les nuages noirs
qui viennent du nord colorent la terre, les lacs les rivières, c'est le décor
du Connemara". Christophe tâche de faire une place à cette bourgeoise aux
longues jambes que ses amis peinent à adopter, jusqu'à ce qu'elle retrouve des
réflexes oubliés, et son ancienne appartenance à ce milieu économe aux fins de
mois difficiles, où on loue un appartement pour deux semaines à Grande Motte
parce que c'est moins cher. Entre l'ancien beau garçon et la cadre supérieure,
c'est une relation de chair, de désir, de corps retrouvés ; une relation qui
fait resurgir les vieux rêves et les ambitions, et la question de ce qu'ils en
ont fait.
Au-delà de la relation qui unit, pour une
courte période, les deux anciens lycéens, c'est un tableau social que nous
dresse Nicolas Mathieu, avec la même justesse que dans Aux animaux la guerre et Leurs
enfants après eux. Le monde de l'entreprise et du management d'un côté,
avec le vocabulaire abscons truffé d'anglicismes et un cynisme impitoyable ; le
monde rural et populaire de l'autre. Avec ce talent sans concession de planter
une scène – le mariage du copain de Christophe avec le jeu des mollets – ou un
personnage – le portrait du père Muller, maire d'une petite commune : "Il
lui semblait l'avoir toujours connu ainsi, âgé, chauve, potentat mal fagoté,
fortuné mais discret, acharné de prudence, de cette race des maquignons qui
font les héritiers aplatis et les succession mouvementées." qui donne à ce
roman sombre une portée universelle.
Catégorie
: Littérature française
Vosges
/ 2017 / classe sociale / adultère / entreprise /

Posté le 09/05/2022 à 17:55
Gabrielle, treize ans, court dans la nuit,
les paumes des mains brulées par les broderies d'un coussin, pour se réfugier
auprès de son arrière-grand-mère qui vient tout juste de mourir. Gabrielle est
née un soit de mai, trois mois trop tôt, et sa survie tient du miracle. D'un
côté, l'adolescence de la jeune fille ; de l'autre, son enfance. Les deux
récits convergent peu-à-peu, jusqu'au moment charnière de la mort de l'arrière-grand-mère,
celle qui a traversé la frontière il y a si longtemps pour fuir Franco et qui,
à la fin de sa vie, a perdu la tête. Et, comme des parenthèses, l'animation
faite par un duo de clowns dans le service de pédiatrie d'un hôpital, racontée
par un mystérieux narrateur dont on découvrira l'identité à la toute fin du
récit. La construction est habile, et si le style parait un peu emprunté au
début, il s'affirme et gagne en fluidité. La plume de Laurine Thizy devient
efficace, avec cette rare qualité de montrer plutôt que d'expliquer. En
filigrane dans ce joli récit est abordée la thématique du corps dans tous ses
états : celui du nourrisson né trop tôt, aux membres flétris pas plus épais
qu'un doigt ; celui qui, inflexible machine bien rodée, se plie aux exercices
de la GRS ; celui qui éructe des araignées venues du fond de la gorge et font
tousser Gabrielle à perdre haleine ; enfin c'est aussi le corps de la Mémé qui
vieillit, s'ankylose et se grippe. Un
premier roman très prometteur.
Roman
lu dans le cadre des "68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
sport
/ corps / famille / maladie /
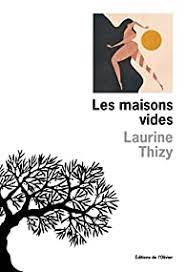
Posté le 09/05/2022 à 17:54
A 80 ans, Marie a décidé d'en finir.
Avant d'accomplir le geste ultime, accompagnée par une amie infirmière, elle
entreprend de raconter à sa fille Adèle l'histoire de son enfance qu'elle lui a
toujours tue. Elle lui raconte son enfance dans une ferme isolée, une enfance
pauvre où les seuls jouets étaient ceux que la nature voulait bien lui offrir ;
elle lui parle de son petit frère Jean, beau comme un ange mais "pas
fini" d'après le médecin de famille ; de sa mère, illettrée, qui ne
comprend pas l'attirance de sa fille pour la lecture ; de son père, métayer,
contraint de reverser la moitié de ses maigres revenus au propriétaire. Un père
dur au labeur, qui n'admet pas la différence de Jean et le frappe, de plus en
plus souvent, au moindre prétexte…
La vieille dame dit la dureté de cette
existence de quasi esclavage régie par la météo, la violence familiale, la peur
de ce père sec et noueux comme une trique. Elle dit ses choix, celui de ne pas
intervenir quand la folie du père devient évidente, et celui de partir, et de
se faire une autre vie. Quitte à laisser Jean là-bas. Elle n'a pas de regret,
et avance obstinément ; elle met dans sa vie loin du monde paysan la même
énergie qu'elle a à donner le jour à Adèle. De même décide-t-elle de mourir,
refusant de subir un choix qui ne sera pas le sien. Elle part sans regret, sans
se retourner. La question du droit à mourir dignement est bien traitée par le
prisme d'une femme indépendante, qui m'a semblé tout de même un peu froide et
distante.
Catégorie
: Littérature française
vieillesse
/ famille / violence / handicap / droit de mourir /
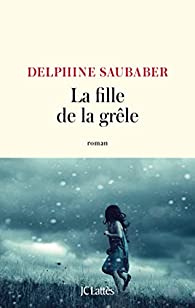
Posté le 09/05/2022 à 17:52
Jean Roscoff, professeur retraité
d'histoire à l'université, décide de se consacrer à la rédaction d'un essai sur
Robert Willow, un poète américain installé en France à l'époque de Sartre, du
Castor et de Saint-Germain-des-Prés.
Divorcé, alcoolique, nostalgique de ses années de militant à SOS
Racisme, il parvient tout de même au bout de son projet et à le faire éditer.
La soirée de lancement de l'ouvrage a lieu dans un obscur petit bar militant
parisien, où le public se limite à quelques personnes, dont un blogueur qui
poste le lendemain un article reprochant à Roscoff d'avoir sciemment occulté le
fait que Willow était noir.
Voilà notre universitaire plongé dans les
affres des réseaux sociaux, des hashtags et des commentaires d'autant plus
cruels qu'ils sont protégés par l'anonymat des pseudos. L'idée n'est pas
mauvaise, et Abel Quentin a un talent certain pour dénoncer les dérives du
fourre-tout d'internet, ainsi que les mouvements identitaires qui s'y
développent, notamment grâce au personnage de sa fille, homosexuelle militante
et probablement sous la coupe de sa compagne. Mais le récit traîne et se noie
dans les détails. Le diable s'y cache dans doute, à vouloir trop bien faire, à
aborder de multiples thèmes – outre ceux pré-cités, on y trouve aussi le fait
d'avoir plus ou moins raté sa vie, la réussite financière de son meilleur ami,
son mariage raté, sa fille qui le provoque… - dans une prose savante, cependant
émaillée par des fautes d'orthographe surprenantes : "son auteur fétiche,
dont le nom m'était vaguement familier, et qu'elle qualifia de
"compliquée"[sic] et "touchant" (p.92) ; deux pages plus
loin : "le récit d'une personne qui s'est faite amputer d'un bras" ;
p.160 Roscoff se relève à 3 heures du matin "pour aller chercher un 1664
dans le frigo" ; enfin un usage curieux de la répétition : "Arrivés à
la cinquantaine, la peau ravinée par les plaisirs, la peau creusée et
ravinée…" (p. 179). Certes, certaines scènes sont drôles et font mouche,
mais cela ne suffit pas à rendre le récit digeste, que j'ai trouvé nombriliste
et bavard, bien loin du regard juste et acéré de Sœur. La répétition maladroite de la page 179 a eu raison de ma
patience.
Roman
lu – partiellement – dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
poésie
/ édition / communautarisme /
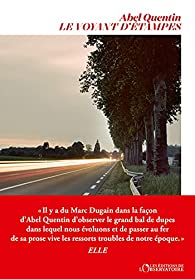
Posté le 09/05/2022 à 17:50
C'est l'été, dans la campagne flamande.
A 11 ans, la narratrice de l'histoire vit chez ses grands-parents sans avoir
revu sa mère depuis des années. Le grand-père s'éteint tout doucement à
l'étage, tandis qu'en bas, la grand-mère s'affaire dans la cuisine. La fillette
vaque à ses occupations de vacances, tient compagnie à l'un, fait la cuisine
avec l'autre, observe, raconte ses souvenirs et son quotidien. Les visites de
l'infirmière, les travaux agricoles menés par un jeune homme, l'autorité du
grand-père, les frasques des trois chiens, l'agonie des poissons à cause de la
sécheresse, et un jour, une baleine surgie dans l'étang. Le monde à hauteur des
yeux d'une enfant, qui découvre aussi les premières affres d'un désir tout neuf
et inconnu. Cet été-là, on joue encore les pieds dans la vase à se raconter des
histoires, mais les yeux commencent à regarder plus loin que les rives de
l'étang. Zoé Derleyn décrit joliment et très justement ce moment charnière où
l'on s'apprête à quitter le monde de l'enfance pour basculer dans l'adolescence,
où l'on goûte la saveur acidulée des groseilles à maquereau, où l'on part chercher
le chien enfui, où l'on déteste le garçon qui travaille torse nu au soleil tout
en attendant impatiemment qu'il revienne
Catégorie
: Littérature française
Belgique
/ été / campagne / enfance / famille /
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".Posté le 31/03/2022 à 16:40
Gravir la montagne à dos de fils pour
attendre la mort sous un grand rocher, c'est ce que souhaite Marie. Faire son
abasute, pour mourir seule, à l'abri des regards. Alors le fils va fabriquer
une chaise en osier munie de deux larges lanières et, chargé du poids de sa
mère, grimpera pendant deux jours jusqu'à déposer son précieux fardeau à bon
port. Les préparatifs et les deux jours de ce dernier voyage permettent à
chacun d'eux d'égrener leurs souvenirs : Marie se rappelle sa vie d'avant, la
rencontre avec celui qui allait devenir le père de ses trois enfants et qui a
été le grand amour de sa vie, avant de mourir en montagne ; Pierre se souvient
de ses 15 ans et de la mort du père qui a muré longtemps sa veuve dans le
silence. Marie était une mère aimante pourtant, malgré la peine dont elle a eu
tant de mal à se remettre, et elle aimait les livres et les histoires. Il y a
beaucoup d'amour là-dedans, et une obstination à avancer malgré les claques que
la vie s'ingénie à vous donner. De la cruauté aussi, à commencer par cette
dernière demande de Marie à Pierre, auquel il concède sans se révolter. On
pourra y voir le dernier acte d'amour d'un fils pour sa mère, et la possibilité
d'un chemin à l'envers où il devient "l'homme qui porte sa mère sur son
dos pour l'emmener s'éteindre sur la montagne". J'y ai vu, moi, une
mission fatale à laquelle il ne pouvait faillir, et quelque chose d'un peu
égoïste. Comment peut-on demander une telle chose à son fils, n'ai-je cessé de
me demander tout au long de la lecture de ce roman pourtant beau et ciselé ;
comment peut-on le charger d'un si lourd fardeau ? Heureusement, on l'attend en
bas.
Roman
lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
montagne
/ maladie / mort / famille / pèlerinage /
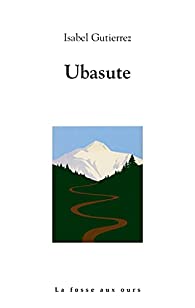
Posté le 28/03/2022 à 10:23
Un
matin du 4 février 1912, Franz Reicheld se jette du premier étage de la Tour
Eiffel, vêtu d'une combinaison parachute de son invention. Son saut – et son
échec – sont saisis par une caméra. L'histoire n'a retenu qu'une minute trente
d'images de cet homme à la moustache imposante, qui tourne devant la caméra
puis, debout sur une chaise, grimpe sur la rambarde, hésite, recule, puis se
s'avance encore, pour s'élancer dans le vide. Etienne Kern s'empare de ce fait
divers pour tisser l'histoire de ce tailleur d'origine hongroise établi à
Paris, qui va vouer toutes ses forces et ses économies dans la création de ce
prototype capable, l'espère-t-il, le croit-il, de faire voler l'homme et de
sauver les vies de nombreux aviateurs. Il mêle à la reconstitution fictionnelle
ses propres souvenirs, notamment ceux de deux êtres chers décédés par
défenestration, qu'il lie à sa propre peur du vide. En contrepoint du récit du
tailleur pour dames, il y a celui de son amie M., ses quelques photos qu'il
décrit, avec chagrin, tendresse et pudeur. C'est un très beau roman, qui dit
les parallèles étranges mais ô combien signifiants que fait l'esprit humain
quand il se questionne ; un roman qui, avec des mots choisis, sobres,
efficaces, rend hommage à ces envolés morts de n'avoir plus voulu toucher
terre. "Tu es tous ceux qui sont tombés. Tu es tous ceux qu'on a perdus.
Tu es cette évidence qui suffit à me rendre le jour un peu plus beau et le soir
un peu plus triste, cette évidence que mes mots ne font qu'attester, cette
évidence qui dit chacune des images où demeure quelque chose de leur présence
et se retrouve leur visage familier, aimé, envolé : ils ont été."
Une belle découverte faite
dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie
: Littérature française
défénestration
/ invention / suicide / accident / folie / hommage /
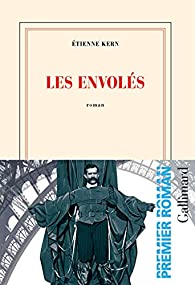
Posté le 28/03/2022 à 10:20
Jacques Bonhomme, agriculteur, a quitté sa
ferme et ses animaux. En pleine cavale, le jeune homme se cache des gendarmes.
On va découvrir progressivement la raison de sa fuite, à travers les paroles de
son entourage : la mère de son meilleur ami handicapé, sa sœur, un
fonctionnaire chargé du contrôle sanitaire, un vieux voisin, chacun raconte
l'enchaînement des événements qui ont conduit à la rébellion du jeune paysan,
et notamment la course au rendement, la production de masse et la
déshumanisation des pratiques qui touchent cruellement le monde de l'agriculture.
Un récit inspiré d'un fait divers dramatique.
Il faut du temps pour faire pousser des
plantes. De la patience aussi, et du savoir-faire. Des connaissances transmises
d'une génération à l'autre en même temps que la ferme et les terres. De même
Corinne Royer prend son temps pour poser son histoire et son personnage, caché
dans les bois qu'il connait bien. Pendant sa cavale, Jacques s'interroge, se
désespère, se révolte, pleure, crie, nourrit sa colère et ses regrets. A
travers ses larmes et sa désespérance, c'est toute la misère d'un monde paysan
étranglé par les normes sanitaires sans cesse changeantes, les aberrations
administratives, les objectifs impossibles à tenir, le cercle vicieux des
emprunts pour combler les dettes ; un monde où l'animal n'est plus qu'un produit,
et l'homme un exécutant. Un roman âpre et beau comme l'est la forêt qui
s'éveille dans la brume, inspiré d'un fait divers, et que le lecteur achève en
se demandant si, un jour, fermes, vaches et paysans ne seront pas une espèce
éteinte.
Catégorie
: Littérature française
agriculture
/ monde paysan / dettes / révolte /
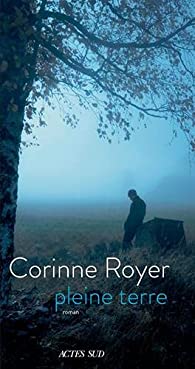
Posté le 28/03/2022 à 10:18
Roger Leroy a 10 ans quand son père revient
un soir accompagné un demi-frère, Nicolas Lempereur, le jour même de son
anniversaire. Il le déteste aussitôt, cet étranger né de la double vie de son
père. Des années plus tard, Roger, devenu Garde des Sceaux, est un farouche
militant de la réhabilitation de la peine de mort. Nicolas, lui, est une
véritable rock-star, pacifiste et opposé à toute discrimination. La
condamnation d'un pédophile récidiviste permet le rétablissement de la peine capitale.
Mais quand Nicolas est accusé du viol et du meurtre d'une jeune femme et que
tous les indices semblent prouver sa culpabilité, Roger se retrouve dans une
position délicate.
Nicolas va être condamné, cela ne fait aucun
pli. Roger pourrait être apaisé, voici l'occasion parfaite de se venger de ce
frère inopportun qui est venu lui voler sa fête et l'amour maternel. Il ne
l'est pas : le ministre a bien quelques scrupules, sachant bien que, une fois
la sentence prononcée, il n'y aura pas de retour en arrière, et qu'on n'est pas
à l'abri d'une erreur judiciaire. Mais la loi qu'il a défendue est passée, une
première exécution a eu lieu, le jugement a été rendu. Justice est faite. C'est
notamment la conviction de ses conseillers, de ceux qui ont travaillé pour en
arriver là, dont les dents rayent le parquet et qui ne raisonnent qu'en terme
d'image. Leroy a l'opinion publique pour lui, qui voit dans la peine capitale
un moyen sûr, efficace et imparable de rendre justice. Mais le ministre, lui,
en est moins certain. Et s'il s'était trompé ? Avec une plume précise, presque
chirurgicale, Céline Larpetot met en scène un homme persuadé d'œuvrer pour le
bien de la société, un élu politique que son parcours n'a pas affranchi des
jalousies de l'enfance, mais qui ne trouve, dans la possibilité d'une
vengeance, aucun exutoire. A travers le doute qui lentement se distille, ce
sont les questions que, sans doute, espérons-le, on devra se poser si un jour
des élus populistes se risquent à militer pour le rétablissement de la peine
capitale.
Catégorie
: Littérature française
guillotine
/ loi / justice / meurtre / exécution / frères / remords /
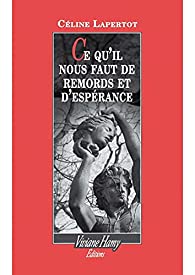
Posté le 28/03/2022 à 10:16
Il est des gens qui voyagent pour
découvrir le vaste monde et se frotter à d'autres cultures. Pour admirer les
paysages et les monuments. Pour arpenter les montagnes ou les mers. Et puis, il
y a Liouba et Talal. Elle fait des reportages qui illustrent les dégâts causés
par le changement climatique. Il est photographe, notamment des populations
réfugiées. Ils se rencontrent en Jordanie, sympathisent, se séparent puis se
retrouvent à la faveur d'un séjour de Liouba aux confins de la Guinée. Se
séparent encore, mais restent en contact, soudés par leur attirance réciproque
qu'ils retiennent. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, à Moscou où Liouba est née,
ils se laissent enfin aller.
A la fois roman d'apprentissage et roman
d'amour, ce récit s'attache aussi à dire les conséquences du bouleversement
climatique, avec la montée inexorable des eaux, la disparition d'îles tandis
qu'ailleurs, le désert engloutit la végétation et contraint les populations à
fuir. Il dit les tentatives des hommes à replanter, dans la mangrove ou le
désert, à tout faire pour empêcher la disparition d'un écosystème où la
dernière girafe va mourir. Et en filigrane, cet amour qu'on aimerait vivre tout
en l'empêchant, parce que le nomadisme ne peut que le contrarier – "il
leur manquait l'espace, le temps et, peut-être, la faveur du destin. Car il y a
des amours qui naissent du néant et qui n'ont d'existence que dans les limbes.
Des amours mort-nées. Ces amours-là ont la saveur exquise et douloureuse de ce
qui est impossible." Pourtant il arrive que les fleuves parfois se
rejoignent et deviennent confluents. Première lecture des 68 premières fois édition 2022 et jolie découverte.
Catégorie
: Littérature française
environnement
/ rencontre / amour /
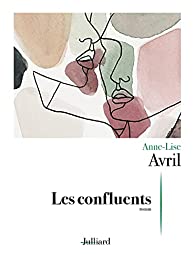
Posté le 14/03/2022 à 17:46
Beyrouth, 1948. Les Pelletier sont
propriétaires d'une savonnerie prospère. Leurs quatre enfants quittent
peu-à-peu le giron familial : Etienne part pour Saïgon où il a trouvé un emploi
à l'Agence indochinoise des monnaies, espérant retrouver son compagnon disparu lors
d'une opération militaire ; François travaille comme manutentionnaire et
parvient à se faire embaucher à la rubrique des faits divers du Journal du soir où il va suivre une enquête
sur une série de meurtres ; Jean, l'aîné, surnommé Bouboule, après une
expérience désastreuse à la tête de la savonnerie, vit chichement à Paris avec
sa femme d'un travail de représentant. Reste Hélène, la benjamine, qui n'a
qu'une envie, quitter ses parents et rallier la capitale où elle fera ce que le
vent lui dictera.
Cet ample roman nous emmène dans les
ruelles encombrées et les fumeries d'opium de Saïgon, dans le Paris tout juste
sorti de la guerre, qui vit encore au rythme des tickets de rationnement ; il
nous conduit aux côtés de quatre frères et sœurs bien différents, par leur
caractère, leur ambition, leur révolte aussi. On y retrouve le talent de
conteur hors pair de Pierre Lemaitre, à vous camper des ambiances, à sourire, à
pleurer, à s'agacer parfois des mésaventures de ces personnages. Le plus
réussi, le plus touchant d'entre eux, c'est sans doute Etienne, courageux,
entêté, désespéré, dans sa quête éperdue de retrouver Raymond et de venger sa
mémoire. Et autour des quatre enfants Pelletier, d'autres personnages gravitent
tout aussi remarquables : Geneviève, la femme de Jean, cruelle et machiavélique
à souhait, Diêm, le factotum indochinois qui va créer une secte influente, ou
encore les chefs de service du journal. A travers le destin de la famille
Pelletier et de ses acolytes, c'est tout le portrait d'une époque que
ressuscite avec brio Pierre Lemaitre, d'une plume alerte et vive, pleine
d'humour, les Trente pas encore glorieuses où l'on s'enrichit à l'étranger sur
le dos du gouvernement français tandis qu'à Paris, les communistes manifestent
et que l'on s'entasse dans des logements insalubres. Avec un rebondissement
ultime qu'apprécieront les lecteurs d'Au
revoir là-haut. Quelle saga !
Catégorie
: Littérature française
France
/ Trente Glorieuses / Saïgon / Beyrouth / famille /
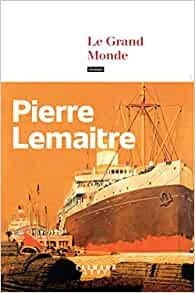
Posté le 14/03/2022 à 17:45
A bord de l'intercités de nuit n°5789 sont
montés une centaine de passagers. Parmi eux un médecin, une mère de famille et
ses deux enfants, un représentant en articles de sport, un joueur de hockey, un
couple de sexagénaires retraités, et cinq étudiants. Au cours du trajet, les voyageurs
font connaissance, se livrent aux à confidences que permet ce huis clos
nocturne... alors que certains d'entre eux, nous dit l'auteur dès le début du
roman, n'arriveront pas vivants à destination.
Quel drame menace ces quelques personnages
qui ignorent évidement tout du destin qui les attend ? Le lecteur n'en sait
rien encore, pris en otage par une information glaçante qui revient comme une
antienne au fil du récit. A bord de ce train qui file dans la nuit, il suit les
aveux, les prises de conscience, pressentant que, pour les survivants, rien ne
sera pareil – bien sûr, ils auront échappé à la mort, mais ils se seront
révélés à eux-mêmes. Et pour s'épancher, se découvrir et se trouver, quoi de mieux
qu'un inconnu qu'on ne reverra jamais, dont on se fiche qu'il nous juge ? Tout le
talent de Philippe Besson est là, dans la précision, la justesse, le détail,
dans ces situations si vraisemblables, si réelles qu'on a l'impression d'être
monté avec les passagers, d'entendre ces vies si différentes que le hasard, un
changement d'emploi du temps ou la destinée a réunies. On pourrait, si ce
n'était pas si galvaudé, songer à la mélancolie si poignante des personnages
peints par Hooper, qui vous saisit le cœur – les Noctambules avaient d'ailleurs inspiré à Besson L'arrière-saison, il y a quelques
années. Alors, à la lecture de ce roman, on les imagine, ces voyageurs,
auxquels on donne des teintes chaudes et le côté délicieusement suranné des
années 50, debout dans le couloir, leurs reflets dans les fenêtres, s'allongeant
sur leurs couchettes, jouant aux cartes, tandis que le train traverse les
campagnes et s'enfonce dans la nuit, vers Briançon et son destin.
Catégorie
: Littérature française
train
/ voyage / nuit / confidences / destin / fatalité /
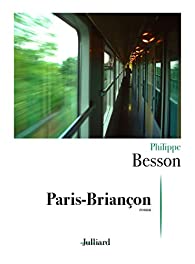
Posté le 07/03/2022 à 17:55
Une station-service au bord d'une autoroute
des Ardennes, par une nuit d'été. Quatorze personnages se croisent, sous la
lumière crue des néons. Il y a là Juliette, la caissière, et son collègue
Sébastien, une prof de pole dance, un mannequin qui voue aux dauphins une haine
tenace, un dépanneur, une bonne philippine, un couple et une mère devenue
démente, la rescapée d'un attentat, un représentant en acariens, un palefrenier
meurtrier, un cheval, une vieille dame richissime et son gigolo, et un cadavre.
Simple coup du hasard ou effet du destin aux lois mystérieuses, tous convergent
à 23h12, autour d'un café ou d'une pause pipi. Pour repartir après.
Dans ce récit inclassable, chaque chapitre
pourrait être une sorte de nouvelle, lue indépendamment des autres. Cependant,
un lien unit ces destins, cette halte sur l'autoroute un soir d'été. Qui n'a
pas essayé d'imaginer, lors d'une pause sur le trajet des vacances, ce que
pouvait être la vie de ces autres croisés que l'on croise aux toilettes, devant
la machine à café ou à la caisse de l'épicerie ? D'inventer une existence à
ceux-là qu'on ne reverra jamais ? Adeline Dieudonné nous propose ainsi des
portraits, pour certains bien gratinés, et très réussis, de ces étrangers de
passage. Avec le risque de faire catalogue, sans réelle logique. Mais son
propos n'est justement pas de trouver un lien – à part cette rencontre éphémère
et sans lendemain, à 23h12, mais d'illustrer cette brève connexion qui sauf
exception, ne mène à rien. C'est dans sa forme même que cet OLNI fait sens.
Comme un témoignage, une envie de laisser une trace de ces destins croisés. Une
courte pause, avant de repartir. "D'autres arriveront. Toutes repartiront.
Ici on ne fait que passer."
Catégorie
: Littérature française
autoroute
/ destin / rencontre / éphémère / impermanence /
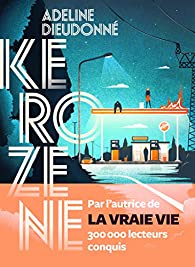
Posté le 10/02/2022 à 11:40
Le blizzard souffle sur l'Alaska. Bee est
sortie faire une promenade avec le fils de son compagnon Benedict. Elle lâche
sa main le temps de refaire ses lacets. L'enfant disparaît dans le blizzard.
Les membres de cette communauté réduite partent à sa recherche : Freeman,
ancien soldat qui a combattu au Viêt-Nam, Cole, habitant du coin et alcoolique
notoire, Bess et Benedict. Alors qu'ils patrouillent, chacun d'entre eux se
remémore son passé et les raisons pour lesquelles il est venu ici.
Quelle idée d'aller vivre dans ce coin
paumé où l'été n'est qu'un fantasme et l'hiver impitoyable ! Cependant, ces
quatre personnages a de bonnes raisons d'y être. C'est l'argument principal de
ce récit découpés en courts chapitres qui, après quelques phrases sur la neige et
le froid, le vent glacial et le manque de visibilité, révèlent par petites
touches le passé de chacun. Le procédé semble un peu artificiel, pourtant la
mécanique s'ébranle et l'histoire présente mêlée à celles du passé se dessine,
avec une tension grandissante et un drame à la logique implacable. D'autant que
le lecteur, lui, sait tout, et se laisse porter par la tension grandissante.
Pari risqué mais réussi.
Catégorie
: Littérature française
neige
/ tempête / enfant / famille / vengeance / violence /
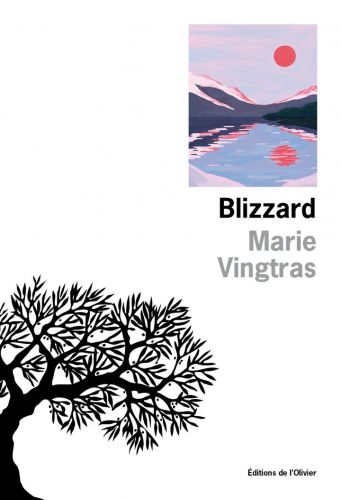
Posté le 10/02/2022 à 11:38
Eté 2056. Le monde, soumis aux aléas du
changement climatique, est désormais régi par de nombreuses lois restrictives.
Dans une vallée d’altitude, pendant l’été 2056, une sirène sonne : au-dessus du
village, dans le ventre du glacier, une poche d’eau sous pression menace de se
rompre. L'alerte réactive une peur ancestrale, qui chez Lucie se double d'une
autre crainte. En effet, elle vient de recueillir sa sœur, qui avait disparu
depuis 30 ans, et qui a la police et son ancien compagnon, un trafiquant de
drogues, à ses trousses. Une sœur toxique sous une menace écologique...
La peur de Lucie est un des fils conducteurs
de ce récit composé de va-et-vient entre la situation présente et l'évacuation
programmée du village situé sous le glacier, et le passé de Lucie.
Petit-à-petit, on découvre les liens qui unissent les sœurs jumelles issues
d'une fécondation in vitro, et la personnalité de la cadette, Clémence, dont le
prénom lui va si mal. Parce que Clémence est en colère, contre sa mère, qui ne
voulait pas d'elle et n'a sans doute pas su, pas pu l'aimer comme elle l'aurait
voulu – il y a d'ailleurs, vers la fin, une scène très révélatrice de l'abandon
ressenti par la petite fille -, contre son père, qui préférait ses bêtes à ses
enfants, contre sa sœur, Lucie la discrète, la gentille, contre elle-même
enfin, au point de se prostituer et de se livrer à des trafics que sa sœur
appelle du "matériel", au point de fuguer sans cesse, de se blesser.
Clémence la mal aimée, à la personnalité borderline et qui souffre d'hyper
sensibilité et d'autres pathologies psychiatriques dont on ne donne pas le nom,
rend folle sa famille, tyrannise sa mère, effraie sa sœur qui subit sans
révolte. Lucie est son exact opposé, capable d'une empathie qui confine à la
soumission.
Quand les jumelles se retrouvent, à cinquante
ans, le rapport de force n'a pas changé. Ce qui a changé en revanche, c'est le
regard de Lucie sur Clémence : devenue femme, elle est capable de comprendre
les raisons de sa colère. Mais pas de fuir son emprise. Le roman oscille donc
entre les réflexions et les souvenirs de Lucie, et la description des règles
draconiennes imposées par un gouvernement qui a mis en place une écologie
radicale : interdiction d'autres funérailles que l'humusation, interdiction
d'avoir des véhicules personnels sauf dérogation, suppression de l'avortement, interdiction
de se promener sans balisage, alimentation végétarienne, retour d'une agriculture
sans moteur ni engrais… Cette vision d'un futur écologique fait froid dans le
dos mais parait tout à fait plausible. C'est à mon sens ce qui fait l'intérêt
de ce roman qui met en lumière les dangers liés au réchauffement climatique et
révèle une grande connaissance du milieu montagnard, plus que la question du
rapport entre les deux sœurs qui m'a paru parfois traitée de façon répétitive
et un peu longue.
Catégorie
: Littérature française
climat
/ écologie / haute montagne / jumelles / famille /
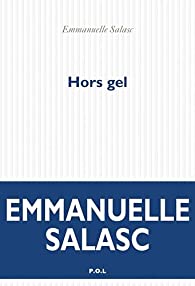
Posté le 13/01/2022 à 15:34
Brun
et son fils sont paysans depuis des générations. Brun a connu le développement
de l'agriculture dite intensive, l'utilisation des engrais et des pesticides,
qui lui ont coûté sa santé. Alors qu'il est en train de mourir, il accepte de
signer un contrat qui prévoit l'installation de trois gigantesques éoliennes
sur ses terres. Il espère ainsi pouvoir renflouer son exploitation et céder à
son fils de quoi vivre décemment. Mais Mo, lui, militant écologique et partisan
de la permaculture, est en désaccord profond avec la décision de son père et ne
supporte pas de voir défigurés les paysages de son enfance sous les coups des
bulldozers et des pelleteuses.
Il y a du David contre Goliath chez Mo,
qui lutte sur plusieurs fronts : contre la décision de son père, qui malgré la
maladie tient encore à régenter son domaine et se méfie des idées écologiques
de son fils, contre la productivité à outrance et la rentabilité, et contre les
responsables du projet, dont la puissance est incarnée par la largueur des pistes
d'accès destinées au passage des engins de chantier. Un combat perdu d'avance,
se dit-on au long du fil de ce roman, voyant avec le même sentiment d'horreur et
d'impuissance que Mo les engins abattre les arbres et défigurer les collines et
les champs. Mais outre l'illustration concrète des difficultés dans lequel se
débattent les agriculteurs conduits à de telles extrémités et le saccage des
paysages centenaires, Éric Fottorino nous convie à la table même de ces
paysans, tous deux solitaires, l'un parce que veuf inconsolable de Suzanne,
l'autre parce que trop engagé dans ses batailles pour avoir pu laisser place à
l'amour. Une histoire de transmission et d'amour de la terre et des bêtes au
sein des montagnes jurassiennes, mais aussi histoire d'une relation entre un
fils et son père où l'amour n'a jamais osé se dire.
Catégorie
: Littérature française
Jura
/ agriculture / faillite / écologie / famille / révolte /
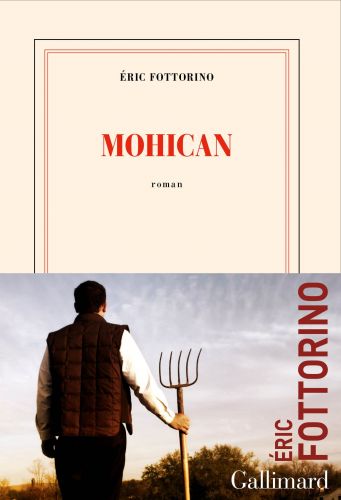
Posté le 13/01/2022 à 15:30
Un jour de janvier 2003, une étrange carte postale
arrive dans la boîte aux lettres de la mère de l'auteure : l’Opéra Garnier d’un
côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et
son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Pas de signature. Vingt ans plus tard, Anne
Berest décide de savoir qui en est l'expéditeur et se lance dans une enquête
avec l'aide de sa mère, d'un détective privé et d'un criminologue. Ses
recherches l'amènent dans le village où sa famille a été arrêtée, et cent ans
en arrière, sur les traces des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage
en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre
et son désastre.
Anna Berest veut comprendre. D'où elle vient,
qui elle est. Ces quatre prénoms sur la carte postale vont la plonger dans une
quête, à l'instar de sa propre mère, qui a mené ses recherches vingt ans plus
tôt. Parfois aidée par celel-ci, souvent seule, l'auteure découvre avec émotion
l'histoire de sa famille, ce que sont devenus les lieux de vie et les biens de
la famille Rabinovitch, mais aussi le terrible déni du gouvernement français
face aux horreurs du génocide, à commencer par le retour à Paris des rescapés
des camps, ombres hâves et malades qui hantaient les rues, et dont les
Parisiens trouvaient qu'ils sentaient bien mauvais et qu'ils ne savaient guère
se tenir. Anne Berest remplit les blancs, et se découvre elle-même. Enquêter
sur ce qu'a été la vie d'Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques, c'est bien
évidemment enquêter sur elle-même, sur ses rapports à mère, à sa sœur, sur
l'influence du passé dans sa personnalité. C'est aussi se questionner sur sa culture.
Avec la question qu'Anne se pose un soir où elle est invitée à dîner pour une
cérémonie traditionnelle juive, alors que, élevée dans une tradition laïque,
elle ne connaît rien au judaïsme. Qu'est-ce donc qu'être juif ? Avoir eu ses arrière-grands-parents,
son grand-oncle et sa grand-tante morts à Auschwitz fait-il d'elle une juive ? Cette
quête, dans ses hésitations, ses retours en arrière, ses fausses pistes, est
bouleversante d'authenticité et d'honnêteté.
Catégorie
: Littérature française
seconde
guerre mondiale / déportation / famille / secret / quête /
Posté le 13/01/2022 à 15:28
Nina, Adrien et Etienne se sont rencontrés en
CM2, en 1986. Une amitié à la vie à la mort, à l'épreuve de tout. L'année du
bac, ils se promettent d'aller tous les trois à Paris pour y faire leurs
études. Leurs destins finissent par diverger : malentendus, trahisons, les
inséparables se perdent de vue. Mais voilà que l'épave d'une voiture est
retrouvée dans le lac. Virginie, une journaliste pigiste, est chargé de couvrir
ce fait divers. Elle a bien connu les trois : sous sa plume se raconte une
amitié que le temps ne parvient pas à détruire…
Difficile de raconter efficacement ce roman
qui se joue de la chronologie et multiplie les aller-retour des années 90 à
2017, sans d'ailleurs que le lecteur s'y perde. Il joue aussi des points de
vue, et se focalise tour à tour sur chacun des quatre personnages. Car, comme
chez Dumas, les trois mousquetaires sont bien quatre, et c'est bien ce
quatrième qui a les clés d'une histoire qui se déroule sur une bonne trentaine
d'années et fait la part belle à une bande son qui sonnera très familièrement
aux lecteurs nés entre 1970 et 1980 – Indochine, U2, Depeche Mode, The Cure,
Mylène Farmer, Etienne Daho ou encore INXS. Une petite tendance à la nostalgie
peut-être, à la longueur aussi, mais largement contrebalancée par une construction
de l'intrigue fort habile – un de ces retournements de situation où le lecteur
se dit "Ca y est, j'ai compris !" avant de s'apercevoir que c'est
pile le moment que l'auteur a choisi pour mettre en œuvre le rebondissement
préparé depuis bien des chapitres. On s'est bien fait avoir, comme on se fait
avoir par ces mousquetaires insupportablement attachants et l'art de Valérie
Perrin de mettre en scène la vie qui va.
Catégorie
: Littérature française
amitié
/ trahison / passé / identité /
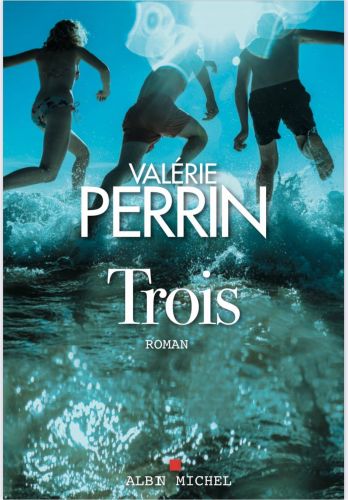
Posté le 01/12/2021 à 17:18
Abel Bac, flic solitaire et bourru, a été mis
à pied dans en connaître la raison. Insomniaque, victime d'un cauchemar
récurrent, il a coutume d'arpenter les rues parisiennes en espérant s'y perdre.
Une nuit, il est réveillé par sa voisine Elsa qui se tient ivre morte devant sa
porte. La jeune femme ne cesse ensuite d'essayer de se rapprocher de lui, en
vain. Abel, qui attend sa convocation devant IGPN, s'enferme chez lui en
compagnie de ses 93 orchidées, au grand dam de sa collègue Camille qui tente
vainement de le joindre. Abel, lui, est préoccupé par l'intrusion, au musée
Beaubourg, d'un grand cheval blanc. Une performance artistique à laquelle
l'artiste sulfureuse et très célèbre Mila pourrait être liée…
Contrairement à ce que ce résumé pourrait
laisser croire, ce roman n'est pas un polar. Un roman noir, certainement, à
tendance psychologique. Ce qui n'entache en rien ses qualités, à commencer par
la très bonne caractérisation du protagoniste. Abel, célibataire endurci, qui
donne du doliprane pilé à ses fleurs et tient Tinder pour un bar parisien, est
un modèle du genre. Pas tout net, ce flic suspendu pour une obscure raison de
délation, qui ne peut s'empêcher de mener une enquête officieuse sur ce grand
cheval blanc qui l'obsède. Autour de lui, trois femmes : sa voisine Elsa, un
peu envahissante, un peu insistante ; sa collègue Camille Pierrat, bien décidée
à sortir Abel de son trou ; enfin Mila, cette artiste contemporaine à
l'anonymat savamment protégé, dont les œuvres se chiffrent en centaines de
milliers d'euros. Trois femmes satellites dont l'épaisseur est bien moins
rendue que pour Abel, notamment Mila, malgré toute sa stature d'artiste
contemporaine célèbre et profondément marquée par les performances extrêmes de
Marina Abramovic. L'histoire quant à elle est plutôt bien menée en dépit de
quelques invraisemblances sur l'identité réelle de Mila ou le traumatisme
initial d'Abel.
Catégorie
: Littérature française
art
contemporain / traumatisme / famille / deuil / vengeance /
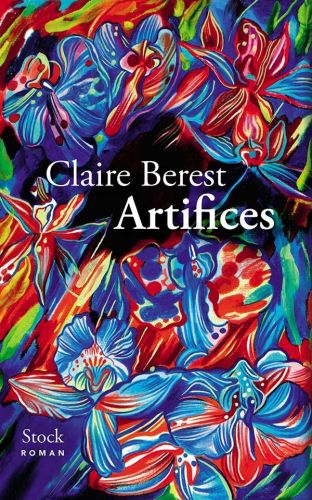
Posté le 01/12/2021 à 17:15
Algérie, années 60. Naja élève seule ses
trois filles pendant que son mari Saïd est parti en France pour travailler.
Enfin, toute la famille parvient à le rejoindre à Paris. Le quotidien s'avère
difficile, la famille est désargentée et Naja perd ses repères. Elle noue cependant
amitié avec quelques voisines et avec Eve, la femme de son beau-frère Kader,
une femme libérée et féministe. Naja tombe enceinte. Le couple n'a pas de
revenus suffisants pour élever l'enfant. Naja décide alors de confier l'enfant
à sa naissance à Eve et à Kader, qui n'en ont pas...
Naja est un peu perdue, écartelée entre les
traditions familiales – ainsi ne va-t-elle pas s'opposer à la décision de son
mari de renvoyer au pays leur fille aînée afin qu'elle s'y marie – et la
société française de l'époque, et les revendications féministes, qu'incarne sa
belle-sœur. C'est à travers elle et tous ses proches que se dessine l'histoire
de cette famille emblématique poussée, à l'instar de nombreuses autres, à
immigrer pour des raisons économiques. Les promesses d'embauche et d'abondance
ont conduit nombre de chefs de famille à venir ainsi travailler dans les usines
françaises, avant d'être rejoints par leurs femmes et enfants. Mais le rêve
fait long feu : Naja découvre un logement vétuste et étriqué, et un mari précocement
vieilli. Avec pour seul horizon les barres d'immeubles HLM, il faut continuer
cependant, malgré les fins de mois difficiles et le chômage, le racisme et l'hécatombe
du sida, le désenchantement et l'amertume.
Catégorie
: Littérature française
Algérie
/ immigration / années 70 / racisme / famille /
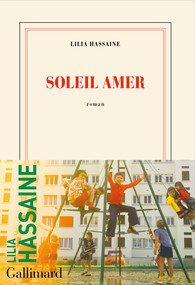
Posté le 26/11/2021 à 09:34
Dans son précédent opus, Il est juste que les forts soient frappés, Théo accompagne sa
femme mourante et s'occupe de leurs deux enfants, encore tout jeunes. Alors
qu'elle agonise à l'hôpital, il rencontre Cléo dont il tombe amoureux. Malgré
la perte et le chagrin. Ce nouveau roman met en scène Cléo et Théo, qui sont en
couple, les relations familiales, l'histoire de Cléo dont la mère actrice
n'était pas présente et le père toujours là, mais qui meurt dans un accident de
montagne. Le récit interroge sur les liens qu'on noue avec des enfants qui ne
sont pas les siens, et les difficultés à trouver sa place au sein d'une famille
recomposée, qu'on soit enfant ou parent.
L'histoire est attachante certes, centrée
autour du personnage de Cléo pour lequel on ne peut qu'éprouver une forte
empathie pour le personnage de Cléo, qui porte le deuil d'un père aimant et
dévoué disparu trop tôt, et les séquelles d'un désintérêt maternel – bien
qu'elle soit tellement humaine, Cléo, qu'elle n'en veuille pas à sa mère. Elle
parvient même à se faire aimer par les enfants de Théo sans prendre la place de
leur mère. Laquelle, tardivement, renonce à sa carrière pour s'occuper enfin de
ses enfants. Ce récit parle de maternité – ratée ou réussie -, de paternité
aussi, à travers la figure idéalisée du père et la façon dont Théo se
débrouille pour élever ses propres enfants dans le souvenir de leur mère tout
en menant sa vie d'homme amoureux. Si les thèmes sont graves, puisqu'il est
tout de même question de deuil et de désamour, Cléo et Théo semblent capables
d'un amour infini capable d'affronter tous les obstacles que la vie s'ingénie à
mettre en travers de leur route.
Cette jolie histoire a un côté un peu conte
de fées, pas toujours crédible, et malgré le caractère attachant des
personnages, le fil narratif est quelque peu décousu, et surtout, il comporte
de nombreuses parties explicatives, dont le lecteur n'a nul besoin – il est
assez grand pour comprendre tout seul : "Ce que je ne vois pas [c'est Cléo
qui parle], c'est la mort que Théo traîne toujours sous ses paupières quand il
met Louise au lit ; ce que je ne vois pas, c'est cette chose en lui qui le
maintient éloigné de notre bébé […]. Ce que je ne vois pas, c'est que Théo
reste à distance prudente de Luise tout simplement parce qu'elle est la vie même, à ses yeux […]." (p.228).
Ou encore : "A cette seconde je comprends qu'il est en train de faire la
même chose que moi, d'une manière différente : piquer là où ça fait mal. […] Je
ne sais pas pourquoi il fait ça, mais là aussi, ça marche." On a
l'impression que Thilbault Bérard a voulu bien faire, trop bien faire.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ deuil / enfant /
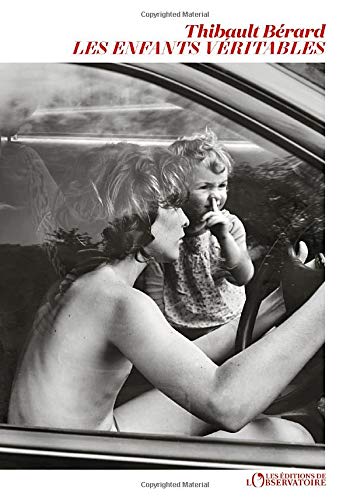
Posté le 26/11/2021 à 09:33
Shellawick, une petite ville perdue dans le désert,
au fin fond du Midwest. Les commerces, les restaurants et même le bowling ont
fermé leurs portes, la plupart des habitants sont partis à Cornado, à une
trentaine de miles. Ne reste que Tom, propriétaire d'une supérette, qui voit
encore défiler des clients qui prennent place sur le fauteuil de barbier qu'il
a hérité de son père. Ils livrent leurs petites histoires tandis que Tom,
ancien étudiant en littérature, les observe et écrit des haïkus.
Difficile de vivre dans ce Perrier où rien ne
pousse, à part les cailloux. Les gens travaillent à la chaîne à l'usine de
popcorn, et boivent de grands verres de Dry Corny, le tord-boyau local fabriqué
comme son nom l'indique à base de maïs fermenté. Autant dire que hors le
popcorn, l'horizon est réduit à pas grand-chose. Tom, lui, subit la concurrence
du gigantesque supermarché climatisé qui vient d'être construit sur les ruines
du bowling, juste en face de son petit commerce. Trop peu garni, "Le
bonheur" n'attire plus le client. Il faudra à Tom un étrange coup du sort
pour que l'on pousse à nouveau les portes de son magasin, et qu'on emporte des
articles bradés bien moins chers qu'en face. Ce récit un peu déjanté, au fil
narratif un peu décousu, aborde les thématiques de la société de consommation
et de la place des Indiens dans la société américaine. Il pose aussi la
question du bonheur, à travers l'histoire de Tom : être heureux, n'est-ce pas
se contenter de la simple joie d'écrire un haïku sur un vieil annuaire
téléphonique ?
Catégorie
: Littérature française
Etats-Unis
/ pauvreté / consommation / alcool / marginal / poésie /
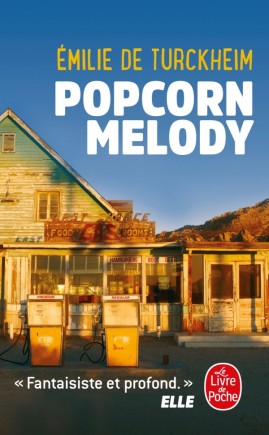
Posté le 26/11/2021 à 09:32
Marseille, 1942. Helen, une chanteuse
anglaise désargentée, vit seule avec ses deux enfants. Installée dans une
mansarde lors de la débâcle de 1940, elle doit être hospitalisée. Ses enfants
risquent d'être séparés et placés dans des familles d'accueil. Elle demande
alors à son fils de construire un abri secret sur les toits, où il pourra se
réfugier avec sa sœur. Les deux enfants sont livrés à eux-mêmes et doivent
survivre, confrontés à une population marginale et hostile...
Il s'en passe des choses sur les toits du
Panier ! Après avoir vécu seuls pendant quelques semaines, sans accès au petit
appartement désormais inaccessible, et sans nouvelles de leur mère, avec pour
seuls bagage un phono et Lielo, un oiseau chanteur en cage, les deux enfants
vont faire de surprenantes rencontres et trouver leur place dans cette
communauté de marginaux. Des enfants et des adolescents survivent de rapines et
d'expédients et prennent les surnoms que leur valent les sauts par dessus les
ruelles. Sales, puants, déguenillés, ils obéissent à quelques meneurs et
deviennent les rois des toits. Parmi eux, le narrateur tombe amoureux, fait la
promotion d'un joueur de billard, devient un as des glissades sur les tuiles,
tandis que sa benjamine, avantagée par sa petite taille, se glisse dans les
cheminées pour aller cambrioler les appartements désertés par leurs propriétaires,
et que les autorités détruisent petit à petit les immeubles du Panier… Ce roman
d'aventures et initiatique, qui présente une belle galerie de personnages, est
élégamment écrit et se lit avec plaisir malgré une action parfois répétitive et
certaines longueurs.
Catégorie
: Littérature française
Marseille
/ deuxième guerre mondiale / marginaux / famille /
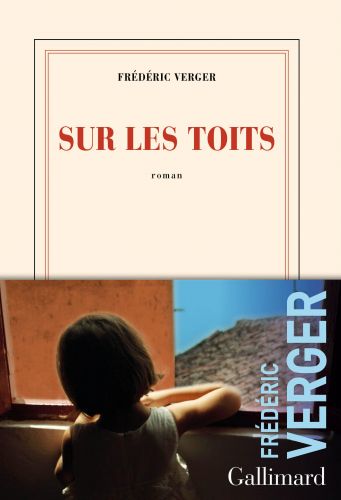
Posté le 26/11/2021 à 09:30
Anna Gauthier, pharmacienne, mène une
existence tranquille et idéale, qui lui permet d'oublier ses origines modestes
et son enfance malheureuse. Elle forme avec son mari Hughes un couple solide
dans sa maison en bord de mer. Tout bascule le jour où son fils Léo, 18 ans,
est arrêté puis incarcéré. Anna voit son monde s'écrouler et resurgir les
démons de son enfance...
Anna a construit sa vie dans le déni d'un
passé traumatique. Et elle y est parvenue : elle a appris à se contrôler, à
modifier ses attitudes, ses inflexions de voix, elle est désormais une femme
soignée et élégante – devenue une autre et pas celle qui a subi, jadis. Avec le
risque, évidemment, que rien n'ait été résolu ni guéri. L'arrestation de son
fils, accusé de violence délibérée contre les forces de l'ordre, va raviver les
blessures et menacer inexorablement le fragile édifice qu'elle a patiemment
construit. Comme si, malgré tous ses efforts, on ne pouvait jamais s'affranchir
complètement de son passé. Avec un soin méticuleux, sans pathos, d'une écriture
précise et avec une efficacité redoutable, Valérie Tong-Cuong raconte ce
progressif éboulement du monde d'Anna. Avec un dénouement qui vient clore implacablement
la ruine de cette vie qu'on croyait réussie.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ harcèlement / trauma / enfance / prison /
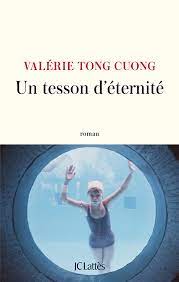
Posté le 25/11/2021 à 17:39
Laura, 20 ans, ancien mannequin, est face à
deux policiers auxquels elle raconte son histoire. Elle a décidé de revenir
vivre avec son père. Celui-ci, Max Le Corre, un ancien boxeur qui après une
passe difficile a repris les combats, est le chauffeur de Quentin Le Bars,
maire de la ville. Max se tourne alors vers son patron pour lui demander de recevoir
sa fille. C'est alors que les mâchoires du piège vont se refermer sur la jeune
femme et sur son père…
Dans ce roman aux thématiques sociales,
Tanguy Viel met en scène, de façon assez visuelle, les rapports de domination
qui s'exercent dans deux relations : entre Max et son patron, et entre Laura et
le Bars. Le Bars est un dominateur, un homme de pouvoir, qui use d'une
véritable emprise de laquelle la jeune femme ne parvient pas à se défaire. Elle
n'a pas envie, mais elle répond à l'impérieux désir du mâle dominant. C'est
toute la délicate question du consentement, cette fameuse zone grise entre
refus et résignation, où le refus n'est pas clairement dit. Le roman prend véritablement
un tour social avec l'apparition du personnage du directeur de casino,
véritable maffioso, qui recrute des serveuses dont on imagine très bien que
leur travail ne se limite pas au bar. Entre ces deux hommes d'influence, il y a
de ces petits arrangements avec la morale et la loi, au sein de réseaux
d'affaires qui se tissent à coups de renvois d'ascenseur et de
"services" réciproques. Des réseaux puissants, surtout quand se mêle
la politique : dans ce combat de David contre Goliath, on devine sans peine qui
va en sortir gagnant. Un dénouement un peu attendu d'un roman qui par ailleurs
aborde avec finesse la relation père-fille et surtout la question du corps, qui
vient en contrepoint du discours social : le corps du sportif, musclé,
surentraîné ; le corps des jeunes femmes dont on ne voit que ça justement, la
perfection ; et le corps de l'homo politicus, un peu empâté sous le costume, ni
beau ni moche, mais un corps de pouvoir et de représentation.
Catégorie
: Littérature française
abus
/ pouvoir / consentement / vengeance / politique / mœurs /
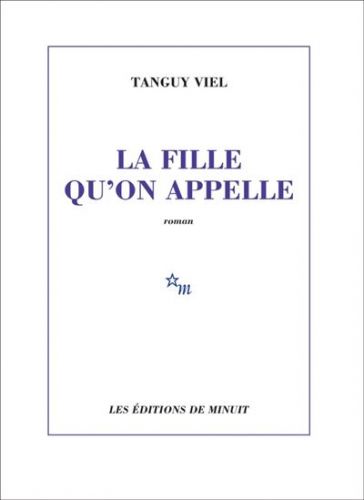
Posté le 21/10/2021 à 17:33
Quelque part dans le Jura, à la fin du
19ème siècle. Aimée épouse Candre Marchère, un riche propriétaire terrien, veuf
d'un précédent mariage. Candre est plutôt attentionné, mais distant. Elle se
sent seule, désœuvrée dans cette grande demeure environnée par la forêt d'Or et
régentée par la servante Henria. Sa mélancolie apitoie son mari, qui lui
propose de reprendre des cours de flûte qu'elle jouait enfant. Il fait appel à
Emeline Lhéritier, professeure au Conservatoire de Genève, qui se rend dans la
propriété une fois par semaine. Les deux femmes commencent à se lier, et Aimée
reprend un peu goût à la vie, jusqu'au jour où Angelin, le fils d'Henria,
provoque un accident.
Comme dans la plupart des romans de Cécile
Coulon, la nature est un personnage à part entière. Ici, elle est incarnée par
la forêt qui cerne la maison de toutes parts, foisonnante, sombre, impénétrable
et, ne peut-on s'empêcher de se demander, probablement hostile. D'ailleurs,
Aimée ne s'y aventure pas, et préfère restée cloîtrée dans une demeure où elle
peine à trouver ses marques. Tout dans ce récit, d'ailleurs, concourt à rendre
la vie difficile pour la jeune mariée, à commencer par son mari, personnage
impénétrable et ambigu. Aimée est une sorte d'oie blanche dont les yeux et le
corps vont s'ouvrir grâce à Emeline : il fallait bien ça, la complicité qui va
rapidement unir les deux femmes, et la liberté que donne la musique, pour que
le récit bascule et que tombent les masques… Si l'ambiance, gothique et sombre
à souhait, est parfaitement soignée et efficace, les conséquences de l'enquête
menée par Aimée puis par Emeline sur la mystérieuse première épouse sont
relativement prévisibles. Mais ne boudons pas notre plaisir, le roman est
prenant malgré tout et la plume de l'auteur toujours aussi juste, à la fois
efficace et poétique.
Catégorie
: Littérature française
forêt
/ 19ème siècle / famille / mariage /
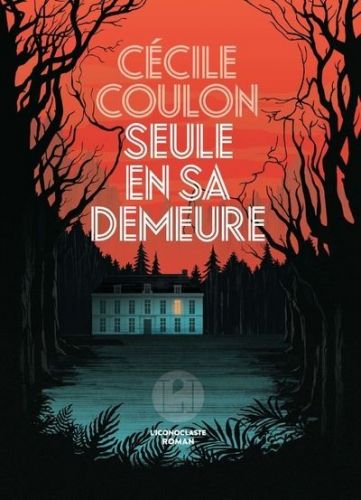
Posté le 11/10/2021 à 16:06
Dans les Corbières, non loin de
Carcassonne, la famille de Testasecca habite le château fort de Montrafet.
C'est un château extraordinaire, composé de multitudes de tourelles, de
coursives, mâchicoulis, chemins de ronde et passages dérobés. Le père, violent
et bagarreur, essaie de produire du vin de ses vignes, sa femme tente tant bien
que mal de gérer la propriété tandis que leurs deux enfants adolescents,
déscolarisés, se livrent aux activités de leur choix. Clémence, 17 ans, est une
bricoleuse hors pair et étaie, répare, maçonne les murs qui s'écroulent.
Pierre, de deux ans son cadet, bat la campagne où il pose des collets à lapins.
Le château est en très mauvais état, voilà ses propriétaires menacés
d'expulsion. La famille se lance alors dans la bataille pour sauver son bien,
tandis qu'autour d'eux, les chevreuils ravagent les cultures.
Quel lieu extraordinaire que ce château
fort, témoin de splendeurs passées, héritage d'une famille aux ancêtres
baroques et hauts en couleurs ! Coursives et chemins de ronde, salon du Cerf,
chambres décorées, pigeonnier et tours branlantes, Montrafet domine ses
hectares de terrain mais menace de s'écrouler de partout. Clémence, capable de
ressusciter Hyperélectryon, un antique tracteur impressionnant, achète une
bétonnière et fait ce qu'elle peut pour empêcher les murailles de verser,
tandis que Diane, tombée en amour pour Léon, négocie des prêts à la
consommation et réclame des impayés de bois de chauffage. Pendant ce temps, son
mari joue du coup de poing au conseil municipal et Pierre, que le village
soupçonne d'avoir des accointances avec Loghauss, une créature légendaire qui
l'aurait sauvé lors d'un incendie, erre dans la campagne et braconne. C'est
grâce aux femmes que le lieu tient encore debout, et c'est sous l'égide du père,
qui répète à l'envi qu'après tout qu'est-ce qui n'est pas impossible ? que la
famille décide de se révolter et de refuser l'arrêt de mise en péril de la
demeure. Haro et sus à l'envahisseur ! Les de Testasecca montent au créneau et
luttent, à coups de cartouches de germes de blé, contre la gendarmerie mandatée
pour les déloger. C'est drôle parfois, dramatique souvent. A travers le combat
de la famille pour sauver son patrimoine, c'est toute l'histoire d'un pays et
de ses légendes que présente avec talent l'auteur toulousain, qui donne à voir la
splendeur de ces châteaux témoins d'un passé mouvementé, que les années
n'épargnent pas.
Catégorie
: Littérature française
Ariège
/ Toulouse / château fort / famille / expulsion / révolte /
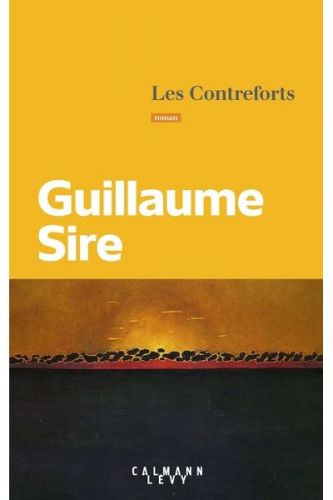
Posté le 04/10/2021 à 18:23
Depuis la mort de son père dans un accident
de voiture, le narrateur, collégien de 14 ans, vit seul avec sa mère. Atteinte
du syndrome de Diogène, elle développe des manies, ne jette rien et accumule de
multiples objets dans la maison. Elle se replie dans un monde imaginaire où son
premier enfant, décédé tout petit, revient à la vie. Son fils, lui, grandit et
essaie de vivre malgré la folie progressive de sa mère. Celle-ci doit être
hospitalisée, tandis le jeune garçon est placé chez son oncle et sa tante. Vingt
ans plus tard, marié, père de deux enfants, il retourne dans la maison
maternelle…
Comment composer avec l'inéluctable, avec cette
lente et fatale progression de la maladie mentale qui vient nier l'existence du
fils au profit d'un fantôme ? Le narrateur assiste impuissant à cette
inexorable déliquescence, tandis que s'amoncellent cartons, bouteilles vides,
boîtes de Nesquick dans une maison où il n'a plus sa place. Il porte en lui
cette blessure terrible, cet abandon, qui le conduit à revenir vers elle. Pour
la mère, c'est son Jean qui est de retour, son bébé grandi, devenu homme. Aussi
ne s'étonne-t-elle pas de ce qu'il s'installe chez elle, parmi l'amoncellement
d'objets entassés, parmi la crasse, la poussière et la puanteur. Et lui, il jette,
trie, casse, fouille, et se fait une place, enfin. Et puis, il se laisse peu à
peu contaminer par la folie maternelle. Christophe Perruchas ne nous épargne
rien, ni les questions du narrateur sur son couple, ses brusques envies
sexuelles, ses cuites et ses épisodes masturbatoires ; il y a là dedans quelque
chose de pervers, à ne rien nous cacher, quelque chose qui s'expose sans fard, et
la revanche du fils. C'est parfois drôle, dérangeant, souvent cru, sans que
l'on sente une once de compassion, ni du narrateur pour la vieille femme
dépenaillée, ni de l'auteur pour son protagoniste. Après le harcèlement au sein
de l'entreprise, Christophe Perruchas s'attaque à la thématique de la
maltraitance familiale, et si l'écriture est ciselée et percutante, j'ai été
gênée par la crudité des propos et le manque d'empathie pour les personnages.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ folie / maltraitance / vengeance /
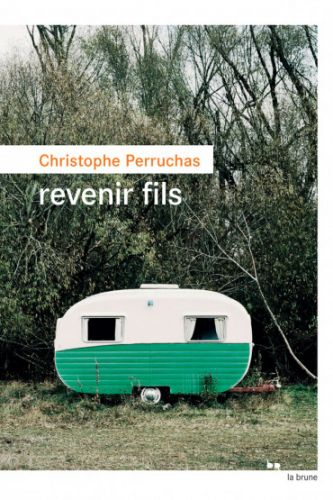
"C'est quand le silence est devenu
long qu'on a regardé à nouveau à la fenêtre. Le fils avec le sécateur, Marc,
une grande faucille à la main et Abdel qui tirait une rallonge pour brancher le
taille-haie.
Déjà les deux autres avaient commencé leur
bataille, petits cris guerriers, contre la haie, l'ennemi ultime.
La faucille comme une machette, combat
d'épée, fer contre vois, le sécateur, un gros, solide, qu'on tenait de papi,
s'occupait des grosses branches. Menaces théâtrales, exécution sommaire.
Et l'appareil électrique entrait à son tour
dans la danse, au bout de son fil, qui portait dans son grincement l'effrayante
promesse des destructions à venir.
Sombre gigue." (p.70)
Posté le 04/10/2021 à 18:21
A la toute fin du 19ème siècle, dans le
Sud-Ouest, Eléonore vit chichement avec ses parents dans la ferme familiale.
Ils y élèvent notamment des cochons et se tuent au travail, sans grands égards
pour leurs animaux destinés à la boucherie. Il n'y a pas de place pour les
sentiments ou l'amour quand il s'agit simplement de survivre, les deux pieds
dans la puanteur et la saleté. La première guerre mondiale rend les choses
encore plus difficiles. Soixante ans plus tard, la porcherie existe toujours,
transformée en entreprise moderne où les porcs vivent entassés dans des boxes,
où les femelles allaitantes sont coincées dans des arceaux métalliques. Malgré
la modernité, la pestilence, la crasse et la maltraitance animale sont toujours
là.
Les mâles sont castrés sans aucune
anesthésie, les animaux bourrés de pesticides et d'antibiotiques, on exécute
sans état d'âme les prématurés ou les mal formés pour les jeter dans la fosse à
purin. Et la merde qu'il faut nettoyer et qui revient sans cesse. Récit sordide
où l'animal n'est qu'une denrée parmi d'autres, qu'on est libre d'exploiter
tant qu'on le peut, l'important étant que ce soit rentable. Parce que les
charges à payer excluent toute pitié. Ce roman âpre et sans concession renvoie,
dans la violence qu'il raconte, aux vidéos d'abattage publiées par le collectif
L214. On est loin des images bucoliques de jolis porcs folâtrant dans des
enclos. On en prenait plus soin au début du siècle, où un gros verrat était
synonyme de richesse. La rudesse des relations humaines de l'époque s'est
cachée sous un vernis de sociabilité, qui ne fait pas illusion longtemps : la
folie de Catherine, épouvantée par la réalité de ce qu'elle a découvert en
épousant Serge, l'aîné des deux frères qui ont repris la ferme ; la trouble progressif
de Joël, toujours le deuxième, toujours le mal aimé ; la colère sourde du père,
impitoyable et tyrannique. Les hommes deviennent fous, contraints à surproduire
dans un système qui les dépasse et les écrase. Jusqu'au drame.
Catégorie
: Littérature française
agriculture
/ élevage intensif / maltraitance animale / famille /
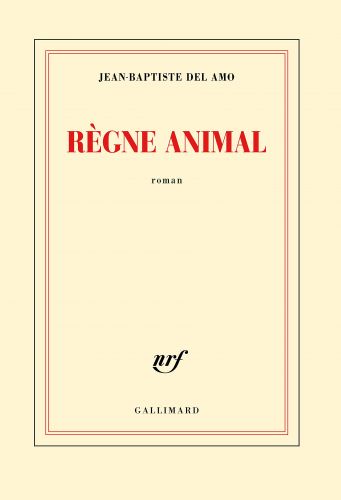
Posté le 04/10/2021 à 18:19
Une petite ville de France, dans les
années 90. Au sein de la famille Tapiro la télé règne en maître absolu et
gouverne la vie des parents de Johanna qui rêve d'ailleurs. Pour s'occuper,
elle chante sur Ophélie Winter (Dieu m'a donné la foi…), auditionne pour Graines de star et aime les garçons,
sans doute un peu trop, un peu mal, acceptant tout ce qu'ils demandent. Et tant
pis si le tombeur du lycée lui impose des retrouvailles dégradantes dans les
toilettes. Au moins, elle existe. Elle enchaîne ensuite les petits boulots et
s'apprête à mener une existence sans envergure, quand elle est recrutée par le
producteur d'une émission de télé réalité pour intégrer l'équipe du Loft. La voilà plongée dans une aventure
médiatique et une histoire d'amour naissante…
Peut-on survivre après une telle expérience
? Après avoir vécu des semaines sans intimité aucune, dans une compétition
permanente, sous le feu des projecteurs, on doute que le retour à une vie
normale ne sera pas simple. Derrière les paillettes d'une célébrité facile à
laquelle on n'accède sans avoir rien fait d'autre qu'être télégénique, Guillaume
Sire dresse le portrait d'une industrie sans pitié où tout est bon tant qu'on
fait de l'audience. C'était les années 90 et l'époque préhistorique d'avant les
réseaux sociaux, celle de Loanna qui d'ailleurs n'est pas sortie indemne de
cette notoriété artificielle. Johanna, elle, s'en sortira un peu mieux. Un
récit bien mené sur les coulisses pas très reluisantes de la télé réalité.
Catégorie
: Littérature française
télévision
/ célébrité / téléréalité / médiatisation / milieu populaire /
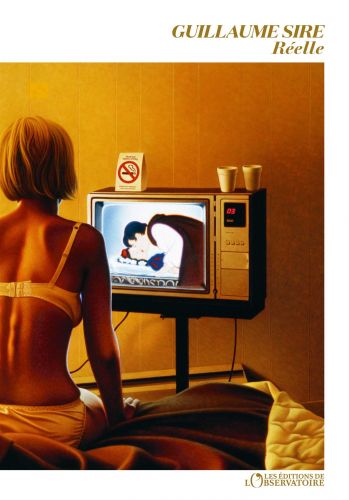
Posté le 04/10/2021 à 18:16
Léna a quitté la France pour passer
quelques mois en Inde, dans le golfe du Bengale, loin du drame dont elle peine
à se remettre. Alors qu'elle manque se noyer, elle est sauvée par
l'intervention d'une petite fille et d'une troupe de jeunes femmes qui
pratiquent l'autodéfense et luttent contre les violences faites aux femmes,
dans un pays où l'égalité est un concept que les traditions ignorent. Grâce Preeti,
la cheffe de la troupe, elle parvient à retrouver la petite fille qui travaille
dans le restaurant où son oncle et sa tante l'exploitent comme main d'œuvre gratuite.
Latifa est analphabète, comme la plupart des filles. Léna sent sa vocation
d'enseignante, mise à mal par la mort de son compagnon, refaire surface. Elle
décide alors de se lancer dans un projet fou : créer une école, ici, pour
apprendre à lire et à écrire aux enfants du village.
Parce que l'éducation, c'est la
première arme contre la violence. C'est ce dont elle parvient à convaincre
Preeti et ses compagnes, qui ont fait de la lutte pour les droits des femmes le
combat de toute leur vie. Dans ce pays où l'on marie les jeunes filles à douze
ans pour les envoyer dans leur belle-famille dont elles seront les esclaves,
dans un pays où l'on n'hésite pas à asperger d'acide le visage de celles qui
refusent de se plier à un mariage arrangé, savoir lire, connaître l'anglais,
les mathématiques ou l'histoire, c'est au mieux une perte de temps et de main
d'œuvre, et un début d'émancipation qui n'a aucune valeur face à la famine et à
la pauvreté. Léna se heurte à la méfiance des habitants, et à une bureaucratie
qui la paralyse. Mais elle est pugnace et entêtée, malgré l'abattement et le
découragement qui la menacent. Ce récit, qui nous fait découvrir de l'intérieur
les conditions de vie terribles de la population rurale indienne, le système
des castes, et le sort misérable qui attend celles qui ont le double handicap
d'être née femmes et intouchables, est aussi un beau portrait de femme qui
retrouve peu-à-peu, dans son combat pour l'éducation, le goût de vivre.
Catégorie
: Littérature française
Inde
/ femme / éducation / école / droits / égalité /
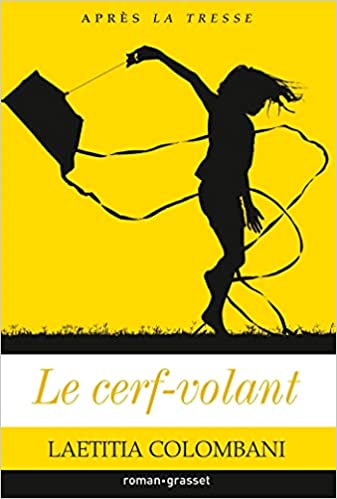
Posté le 30/08/2021 à 19:24
Un soir de Nouvel An, un incendie
ravage la maison où vivent Nine et Gaspard, avec leur mère l'Amazone et la pie
apprivoisée Nouchka. L'Amazone dépose les enfants et la pie chez son frère, un
homme peu amène surnommé le Lord, tandis qu'elle va restaurer, quelque part
dans le Sud, la maison où elle les accueillera. Le frère et la sœur grandissent
et lient amitié avec Quentin, le fils du Lord, tandis que leur mère leur
raconte les longs travaux de la maison. Les années passent…
Quelle est donc cette mère, qui écrit
régulièrement à ses enfants, pendant si longtemps, sans que jamais elle ne
propose de date de retrouvailles ? Malgré le manque qu'ils ont d'elle, la
question ne semble pas hanter Nine et Gaspard – contrairement au lecteur -, qui
veillent surtout, avec leur cousin, à contrer la malveillance du Lord. De lui,
on saura peu de choses, si ce n'est qu'il incarne le mal. Face à lui, la
candeur de l'enfance, puis la révolte de l'adolescence, et la présence
tutélaire d'un oiseau capable de communiquer avec Gaspard. Servi par une belle
plume, ce récit distille quelques éléments de merveilleux et fait la part belle
à la musique, comme pour illustrer l'absence de cette mère fantasque que Nine
espère tant retrouver. Un très beau roman initiatique qui traite avec
délicatesse de la perte et des relations fraternelles.
Roman lu dans le cadre d'une
"Masse critique" de Babelio.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ abandon / relations frère-sœur /
"Le
père crispait les poings. Obsédé par la conduite de son fils, il oubliait la
posture qu'il adoptait d'habitude pour montrer patte blanche, celle où son
corps se repliait sur lui-même pour donner une sensation de fragilité qui
sonnait faux. C'était comme si, assis devant un chiot, on entendait résonner
une quarte augmentée, le triton,
l'accord du diable qui frotte dans l'ouverture de Don Giovanni, et le chiot se transformait alors en chien, en
cheval, en hyène, en homme blessé et violent. Le père et le fils, aux traits
apparemment semblables, étaient mus par des cours si différents que l'un me
coupait le souffle que l'autre l'élargissait." (p.111).
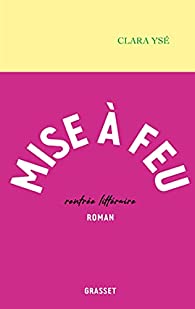
Posté le 30/08/2021 à 19:21
Anna Liakhovic, journaliste, a rejoint une
équipe de scientifiques et de marins chargés de relever les conséquences du
réchauffement climatique sur la banquise de l'Arctique. Russophone, elle est chargée
de relater le quotidien de l'équipe et prend place sur le Yupik avec toute
l'équipe surveillée par un militaire russe. Suite à une tempête, le bateau doit
amarrer et se retrouve prisonnier des glaces à Tiksi, au nord-est de la
Sibérie. L'ambiance devient oppressante, la tension monte parmi les membres du
groupe, Anna est envahie par les souvenirs qu'elle croyait avoir laissés
derrière elle de la mort de sa fille et de sa compagne. A la mort de deux de
ses membres l'équipe se scinde en deux. Anna doit quitter le bateau et se
retrouve coincée à Tiksi. Son aventure est lue deux ans plus tard par Dom
Joseph, moine chartreux qui a reçu le carnet de notes d'Anna, et qui n'est
autre que son frère Sacha.
Les deux intrigues montent en tension
en parallèle : plus Anna se trouve prise dans les gangues glacées et aux mains
des autorités russes, plus Dom Joseph vit un calvaire silencieux au sein du
monastère. La construction de ces deux récits est habile, qui fait la part
belle aux ambiances délétères. Le frère et la sœur sont le jouet d'intérêts qui
les dépassent, au sein d'une nature féroce et glaciale ou dans le cadre
silencieusement hostile du monastère. On retrouve dans ce roman le talent de Patrice
Gain à camper des ambiances et des décors parlants, en lien avec les sentiments
de ses personnages. Lesquels poursuivent une quête de pureté que leur
environnement s'acharne à les empêcher d'atteindre. J'ai été plus sensible à la
beauté et à la grandeur des paysages américains de Dinali qu'au silence glacial de l'hiver sibérien, mais ce nouveau
roman est parfaitement réussi.
Merci à Babelio et aux éditions Albin
Michel pour cette découverte lue dans le cadre de "Masse critique".
"C'est
dans le fracas de l'absence que l'on mesure les bonheurs de nos vies. C'est
dans le silence des photographies que l'on puise nos plus beaux sourires."
(p.71).
Littérature
française
banquise
/ Russie / solitude / pardon / famille /
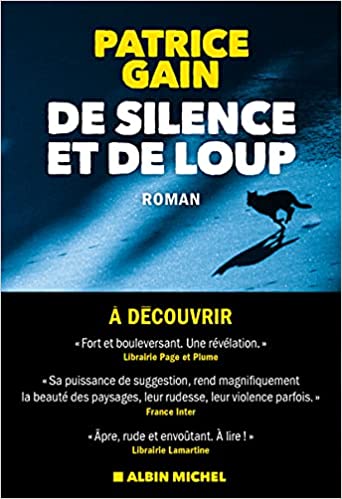
Posté le 26/08/2021 à 17:30
Liv Maria grandit sur une île bretonne entre
son père Norvégien artiste et sa mère tenancière de café. Victime d'une
agression sexuelle, elle est envoyée chez une tante à Berlin où elle fait la
connaissance d'un professeur d'anglais d'origine irlandaise avec lequel elle a
une liaison, le temps de l'été. A l'automne, Fergus repart dans son pays, les
parents de Liv Maria meurent dans un accident. Elle s'envole pour l'Amérique du
Sud où elle vend des chevaux et collectionne les amants. Enfin, elle rencontre
Flynn qu'elle épouse et avec lequel elle s'installe en Irlande. Devenue mère et
femme mariée, elle peine à trouver son identité.
Liv Maria se cherche. Elle a une vie
d'héroïne de roman, endosse plusieurs costumes ; tour à tour tenancière de bar,
étudiante, femme d'affaires, amante fatale, mère au foyer, libraire, épouse
aimante, elle est chaque fois à sa place sans jamais l'être vraiment. Avec les
non dits et les mensonges qui s'accumulent. Quand ceux-ci deviennent trop
lourds, elle n'a d'autre choix que de partir. Julia Kerninon dresse le portrait
d'une femme libre, pleine de contradictions, qui tâche d'assumer son besoin
d'indépendance et la nécessité d'aimer et d'être aimée. Et qui garde tout son
mystère. Un beau roman malgré quelques invraisemblances.
Catégorie
: Littérature française
femme
/ liberté / mensonge / famille /
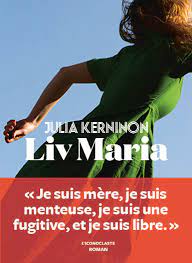
Posté le 20/08/2021 à 09:54
Franck Debert, glacionaute et
généticien, découvre dans une faille de glace un minuscule animal préhistorique
âgé de 130000 ans. Il fait appel à Wendy Lane, biologiste britannique
spécialisée dans l'étude du tardigrade. Un animal d'une résistance à toute
épreuve, doté d'une protéine capable de réparer les cellules humaines. Un enjeu
de taille qui va lui permettre de concourir dans une compétition internationale
avec à la clé une donation somptuaire. Franck, lui, travaille à récréer le
mammouth pour éviter la fonte du permafrost et la propagation de gaz délétères
et de virus anciens. Le voilà également invité dans la compétition. Les deux
chercheurs vont devoir concilier leur attirance réciproque et leur rivalité
pour obtenir le prix…
Et si l'animal était l'avenir de
l'homme ? La survie de la Terre dépend d'une bestiole mesurant à peine un
millimètre et d'un pachyderme de six tonnes qu'il faut ressusciter. Dans un
roman court et enlevé, Didier Van Cauwelaert nous emmène dans un monde où les
manipulations génétiques et la reproduction d'espèces éteintes sont un moyen de
contrer la menace du changement climatique. Entre prélèvement d'ADN de mammouth
fossilisé et ponte d'œufs de tardigrade, les deux jeunes gens s'affrontent, se
désirent et se détestent. Il est aussi question d'un perroquet jaloux, d'un
cheval empathique, d'une chatte télépathe, d'une vieille chienne qui rêve
d'avalanche, d'un mari nobellisé et de son fils opportuniste. Une comédie un
peu déjantée où la romance et le devenir de l'humanité se mêlent pour offrir un
bon moment de lecture dont on pourra peut-être regretter qu'il ne soit pas un
peu plus long.
Catégorie
: Littérature française
recherche
scientifique / génétique / climat / animal /
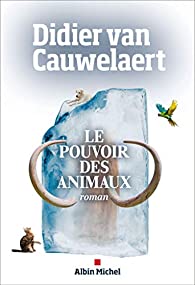
Posté le 03/08/2021 à 18:25
Hugo, 16 ans, se fait renvoyer de son
lycée. Ses parents, désespérés par son comportement, l'inscrivent dans un lycée
privé. Il y fait la connaissance de Freddy Cereseto, un bad boy des quartiers
pauvres de la petite ville de Providence, et de ses deux compères, Oscar
surnommé le Chinois, et Alex, surnommé la Fouine. Il finit par être intronisé
dans la bande qui va le baptiser Bohem, en référence à la caravane dans
laquelle il vit, et se rapproche beaucoup de Freddy, qui l'initie à la
mécanique. Les deux garçons parviennent à se fabriquer des motos. Un avant-goût
de la liberté qui fascine Hugo, loin de Providence. Il parvient à convaincre la
bande de partir sur la route, sans Freddy qui refuse de les suivre… Se crée la
bande des Spitfires…
Après Le Mystère de la Main rouge du même auteur, je me suis retrouvée plongée
dans l'univers radicalement différent des motos clubs, de la route qu'on
taille, des bières et des joints, et des nuits à la belle étoile. On est loin,
dans ce road trip, des phrases longues à la syntaxe irréprochable de la saga de
Gabriel Joly. C'est un tout jeune homme qui s'exprime, sans instruction, un peu
roublard, mauvais élève malgré une intelligence vive, un bad boy qui ne veut
qu'une chose, rouler sur sa moto et vivre de liberté, au jour au jour. Henri
Loevenbruck prend son temps pour poser son personnage, l'ancrer dans un
comportement parfois excessif, mais avec une empathie contagieuse. Comment ne
pas s'attacher à Bohem qui profite du plaisir de s'affranchir des contraintes,
mais qui fait aussi des expériences plus amères et découvre la trahison et la
lâcheté ? A trop chercher la liberté, il va finir par se brûler les ailes. Ce
roman s'achève sur un dénouement qui laisse le lecteur stupéfait, avec une
grosse boule dans la gorge.
"Pourquoi t'es parti, mec ? il m'a demandé
comme ça un soir avec une voix vachement plus triste que d'habitude.
- Parti ?
- De Fremont. Pourquoi t'as laissé tes
frangins ?
- Je pourrais très bien te répondre que
ce sont eux qui m'ont laissé…
- Trop facile.
- Je suis parti, parce que j'aime pas
trop les maisons.
- Pourquoi ?
- Parce qu'elles sont pleines de
portes.
Il a souri, et puis il m'a demandé
encore :
- Qu'est-ce que tu cherches, ici ?
- Rien de spécial !
- Mon œil !
- Tu m'emmerdes, avec tes questions.
- En prenant la route comme ça, c'est toi
qui la poses, la question. Tu nous la poses à tous, mec, tu vois ?
- Je cherche la paix. La vraie. Faut être
tout seul pour avoir la paix. Dès qu'on est deux, c'est déjà la guerre.
[…]
- Pourquoi tu pense tout le temps à Freddy
?
J'ai réfléchi un peu, pour lui donner une
réponse définitive et qu'il arrête.
- Parce que Freddy, c'est le seul type avec
lequel, même ensemble, j'avais l'impression d'être seul."
Catégorie
: Littérature française
Etats-Unis
/ moto / aventure / liberté / amitié /
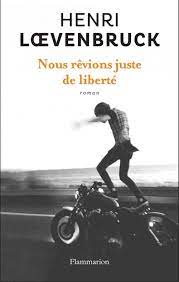
Posté le 16/07/2021 à 18:16
Le vieux Germain vit seul dans une ferme au
cœur des Vosges. A 80 ans passés, il commence
à être mal en point mais refuse d'aller en EPHAD, si bien que sa fille
lui impose de passer l’hiver avec Basile, son neveu qui vient faire sa saison
de conducteur d’engin de damage dans la station voisine. L'équipe d'ouvriers est
rejointe par Emmanuelle, une jeune femme solitaire qui conduit les engins des
neiges mieux que tous ses collègues masculins. Elle s'est installée dans la
ferme voisine où quarante ans plus tôt vivaient ses parents venus de Slovaquie pour
y élever une meute de chiens de traîneaux. Tandis qu'Emmanuelle et Basile
sympathisent, le village est isolé par une terrible tempête de neige qui, de
jours en semaines puis en mois, semble ne pas vouloir s’achever. Alors l’ombre
des Malamutes ressurgit dans la petite communauté coupée du monde…
La neige tant désirée s'amoncelle jusqu'à
dépasser le premier étage des maisons et que les touristes fuient la station, le
ciel reste uniformément gris et les ouvriers de la station se retrouvent au
chômage technique. Dans cette ambiance crépusculaire se révèlent les
traumatismes des uns et des autres, Basile qui ne parvient pas à oublier
l'accident de dameuse qui a coûté la vie à une petite fille, Germain qui n'est
bien que dans la compagnie des arbres centenaires dont il conserve
précieusement des tranches dans la sylvathèque qu'il a installée dans sa cave, tandis
que se révèle le passé dramatique des parents d'Emmanuelle et que surgit le
spectre de la Bête, accusée de dévorer des moutons. Le récit habilement
construit est servi par une atmosphère angoissante à souhait, dans un endroit
reculé où les superstitions et la peur de l'étranger sont encore prégnantes.
Catégorie
: Littérature française
montagne
/ hiver / neige / huis clos / intolérance /
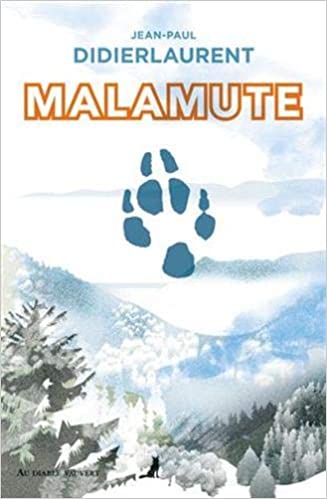
Posté le 16/07/2021 à 18:11
Chaque été, la narratrice, âgée de 14
ans au début de l'histoire, va passer ses vacances avec ses parents dans leur
résidence secondaire du petit bourg de L., dans le Morvan. Elle lie amitié avec
la bande de jeunes du village, malgré leur différence. Elle est d'un milieu
social plutôt aisé, et se fait surnommer la Bourge par José, Franz, Buddy,
Phil, Chuck, Reno, Mallow et Jimmy. On s'ennuie un peu, dans cette petite
ville, on fume de l'herbe, on boit des bières, on fait des tours de mobylette,
on va se baigner dans la rivière. On n'a pas grand-chose à se dire, c'est juste
le fait d'être ensemble, de partager le temps qui s'écoule un peu lentement
dans la chaleur de l'été. La jeune fille tombe amoureuse de Jimmy, leur
relation dure plusieurs années. Et puis tous grandissent, les mobylettes sont
remplacées par des motos, on abandonne le nid familial, la narratrice entame
des études littéraires mais continue de fréquenter la bande, malgré le fossé
qui se creuse progressivement entre eux et les destins qui les sépare.
Il y a quelque chose de Nicolas Mathieu
dans ce récit : on y retrouve l'adolescence au début des années 90, la question
du déterminisme social, et l'ennui abyssal dans ces milieux ruraux, qu'ils
soient lorrains ou bourguignons. Un ennui qui pousse à boire en écoutant les
Doors où à s'amuser avec les moyens dont on dispose, comme dévaler la pente du
village sur des caddies pour défoncer la vitrine du fleuriste. C'est lent
parfois, aussi long qu'une journée d'été où l'on n'a pas grand-chose à faire ;
l'intrigue coule sans rebondissement notoire, mais au fond, c'est un récit
initiatique qui se déroule sur le rythme dolent des grandes vacances. On
partage avec la narratrice cette fascination mêlée de lassitude parfois à
suivre les aventures de ce petit groupe avec lequel elle va partager toutes les
étapes de l'adolescence, amitié, déceptions, transgression, premiers émois
amoureux. Dans une langue fluide et élégante, et très imagée, presque
cinématographique, Vinca Van Eecke dresse le portrait d'une jeunesse rurale
désœuvrée qui, contrairement à elle, va rester dans le coin pour suivre le
chemin tout tracé des parents. Un premier roman très prometteur.
Catégorie
: Littérature française
milieu
rural / adolescence / été / ennui /
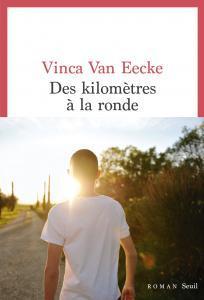
Posté le 16/07/2021 à 18:05
Léni répare des bateaux sur un petit
chantier naval et s'occupe de sa petite fille Agathe, quand sa mère accepte de
la lui confier. Le soir, il retrouve ses copains pour jouer à la coinche au
café de Christine. Le principal sujet de conversation, c'est le pont. Celui
qu'on est en train de construire, gigantesque infrastructure de câbles et de
métal qui reliera l'île au continent, rendant obsolètes les liaisons par ferry.
Un immense progrès affirment les partisans du maire, une source de rentabilité
et d'attrait touristique en plus d'être pratique. Mais les joueurs de cartes ne
sont pas de cet avis, et envisagent de monter un mouvement de protestation :
faire construire le pont, c'est tuer l'identité de leur île. Léni, lui, ne
prend guère part aux débats. C'est qu'il a d'autres préoccupations : la
méfiance de Maëlis, la mère d'Agathe, et les difficultés économiques du
chantier naval. Il semble un peu désabusé, ce Léni si taiseux, et peu enclin à
s'investir dans un combat qu'il pense perdu d'avance, ou dans une nouvelle
relation amoureuse. Un peu attentiste, aussi. Incapable de prendre de vraies
décisions, de se battre, qu'il s'agisse de l'identité insulaire ou de sa fille,
il pourrait être agaçant s'il n'était pas si touchant. Mais au fur et à mesure
de la construction du pont, que les fondations accueillent les piles, que le
tablier va être posé, et tandis que l'équipe du petit chantier naval tâche de
répondre à une commande difficile, il devient de plus en plus difficile de ne
pas agir. Et quand une convergence d'événements l'amène enfin à agir, c'est
toute sa vie qui va s'en trouver modifiée.
Dans cette histoire on se dispute en
jouant aux cartes, on fait griller des sardines, on va pêcher, la patronne du
bar chante du Brassens en s'accompagnant à l'accordéon, c'est un récit écrit à
hauteur d'hommes où perce beaucoup de tendresse. La plume de Martin Dumont y
est très juste, avec ce qu'il faut de poésie désabusée ; il campe en quelques
phrases l'ambiance d'un bar ou l'adrénaline d'une sortie dans une mer agitée.
Alors, pris sous le charme, on se dit que malgré le pont, une île sera toujours
une île et qu'on irait bien y faire un tour.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Littérature française
île
/ mer / pont / manifestation /

Posté le 02/06/2021 à 15:27
Théo, le fils d'Anne-Marie et de Patrick, le
petit dernier, s'apprête à quitter le nid familial, pour aller faire ses études
dans la grande ville située à une trentaine de kilomètres de leur pavillon.
Pour sa mère, c'est un véritable déchirement, bien plus que lors du départ des
deux aînés, un bouleversement complet de sa vie. Le temps d'un déménagement et
d'un emménagement, nous suivons les émotions contradictoires et la mélancolie
de cette mère, et le deuil qu'elle va avoir à faire.
Il y a le dernier matin, au petit déjeuner ;
les cartons que Théo n'a pas fini d'emballer ; le trajet dans le Kangoo bourré
jusqu'à la gueule où, faute de place, la mère et le fils sont contraints de
partager le siège passager, offrant à Anne-Marie le plaisir si rare de se
blottir contre son petit – qui n'apprécie guère le contact - ; il y a la
découverte du studio, et le déballage d'une partie des effets de Théo ; le
déjeuner au diner. Enfin le retour, sans le fils. A chaque étape, Anne-Marie se
remémore des instants de vie avec son fils, comme pour retenir celui qui s'en
va, comme pour meubler le vide à venir, dont elle pressent l'immensité. Comment
faire, quand le dernier enfant a fini par grandir et par prendre son envol ?
Comment parvenir à se contenter des seuls week-ends où le fils viendra manger
des repas équilibrés et laver son linge ? Quoi faire de ces heures devenues
vacance, qu'il faudra apprendre à remplir ? Comment, de mère, redevient-on une
femme ? Philippe Besson a su se glisser dans la peau d'une mère, avec
sensibilité et justesse, sans avoir la prétention de répondre à ces questions.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ mère / enfant / émancipation / deuil /
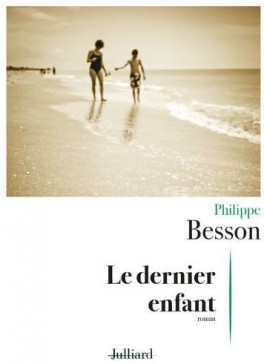
Posté le 02/06/2021 à 13:36
Catherine Burgod, employée de la Poste à
Montréal-la-Cluse, a été assassinée de 28 coups de couteau sur son lieu de
travail. On a soupçonné son ancien compagnon, avant de se tourner vers Gérald
Thomassin, un acteur découvert par Jacques Doillon qui en a fait le héros de
son film "Le petit criminel". Thomassin était un marginal qui vivait
plus ou moins à la rue en dehors des tournages. Il disparaît lors de la
dernière comparution des trois derniers suspects. La journaliste Florence
Aubenas se livre à une enquête approfondie et minutieuse pour reconstituer
toute l'affaire et en rencontrer tous les acteurs, sans prétendre trouver le
coupable que la police n'a jamais réussi à identifier. Et qui reste l'inconnu
de la poste.
C'est un travail de fond que nous propose
l'auteur, une enquête journalistique fouillée, dont le résultat se lit comme un
roman. C'est sans doute là la grande qualité de ce récit, qui donne corps à des
personnages modestes, dont la figure centrale est celui qui va devenir au fil
des ans et des témoignages le principal suspect, Gérald Thomassin. Drôle de
type que celui-là, acteur césarisé très jeune, brut de décoffrage, une pierre
brute dont la qualité transparaît parfois, capable de dépenser en quelques
semaines le cachet d'un tournage pour vivre ensuite d'expédients. Autour de
lui, la figure du père de la victime, secrétaire de mairie, homme influent,
désespéré par la mort de sa fille adorée, qui se livre de son côté à une
enquête minutieuse – car il lui faut un coupable, Thomassin ou un autre. Et
puis, les copines de la poste, les copains de déboire de Thomassin, les
habitants du village, les avocats, tout un monde parfaitement campé avec
humanité, justesse et sans aucun jugement. Les faits, rien que les faits.
Catégorie
: Littérature française
crime
/ village / acteur / drogue /
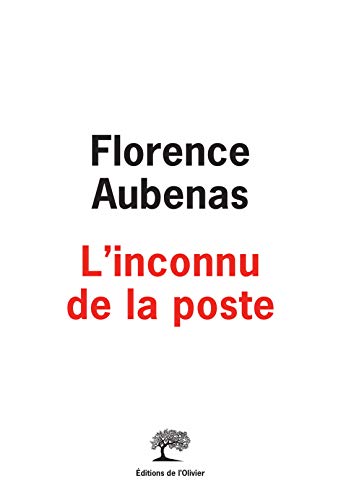
Posté le 02/06/2021 à 13:34
Une
jeune femme quitte le Sud de la France pour s'installer à Montreal, rejointe
quelques mois plus tard par son compagnon Samuel. Elle fait la connaissance de
Noah, un artiste dont elle tombe amoureuse, et cache à Samuel sa relation avec
lui. Elle raconte les deux ans passés là-bas, le lent délitement de sa vie de
couple, les heures passées les après-midi d'hiver dans les bras de son amant
avec lequel, elle le sait, rien d'officiel ou de durable ne se fera. Au-delà de
la thématique somme toute assez banale de l'adultère se tisse la figure de la mère
décédée juste avant son départ pour le Québec, et dont elle n'a pas encore fait
le deuil.
Le
récit à la chronologie bouleversée par des épisodes du retour en France de la
narratrice est empreint de poésie et de sensations remarquablement bien racontées.
Mais l'indécision de l'héroïne, son égocentrisme et sa passivité m'ont agacée. Elle
attend, souvent, longtemps. Elle semble laisser passer sa vie comme on regarde
la neige tomber et blanchir les trottoirs, comme on regarde les traces des
passants bientôt recouvertes par de nouveaux flocons, encore et encore, sans
qu'on ait bougé de sa fenêtre.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois.
Catégorie : Littérature française
Canada / hiver / adultère / attente / passion
/
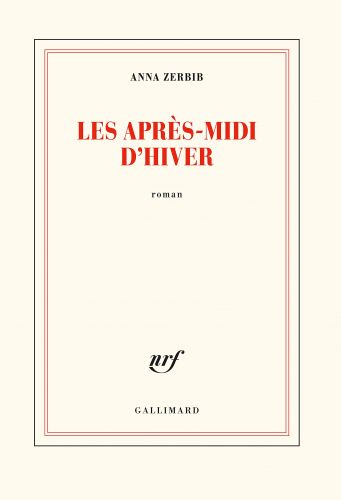
Posté le 21/05/2021 à 14:34
Un beau matin, Thierry
assiste à l'arrestation de son voisin par une escouade de forces de l'ordre
digne d'une série policière. On ne lui dit d'ailleurs pas grand-chose sur le
moment, mais l'importance des moyens déployés lui font soupçonner quelque chose
de grave. Il apprend que Guy est suspecté d’avoir enlevé, violé et tué
plusieurs jeunes filles, notamment dans sa maison. Thierry n’a rien vu. Et Guy
était si sympathique... Un voisin avec lequel il bricolait et partageait
régulièrement apéros et barbecues. C'était son seul ami aussi…
Alors il voudrait que cela
change, qu'on puisse rembobiner le fil des événements pour que Guy ne soit pas
le monstre que les corps découverts dans le jardin de la maison accusent
formellement ; il voudrait pouvoir à nouveau l'aider à réparer une fenêtre ou à
bricoler dans sa cabane au fin fond de la forêt. Conseillé par le responsable
de l'enquête il se met à relire son journal, cherchant et craignant tout à la
fois d'y trouver des indices qui révèleraient la véritable nature de Guy. Pourquoi
n'a-t-il rien vu, rien senti ? Etait-il à ce point aveuglé par son amitié ?
A travers l'introspection à
laquelle se livre Thierry, c'est un homme introverti, solitaire, peu liant qui
se révèle. Au point que son assistant à l'usine démissionne. Au point que sa
femme s'en va. Alors Thierry comprend qu'il faut aller chercher plus loin, dans
le monde perdu de son enfance, dans les souvenirs de ces étés passés dans la
ferme de son grand-père. Ce terrible fait divers est le déclic qui amène ce
taiseux, d'apparence si froide, qui ne sait pas exprimer les sentiments qui
l'animent, à mener une quête à la recherche de lui-même. Ce voyage à l'intérieur
de soi est bien mené et touchant ; il aurait été particulièrement réussi sans
l'intervention, à la toute fin du récit, d'un personnage venu de nulle part
qui, tel un deus ex machina, provoque la seule décision que Thierry devait
prendre. C'est dommage, sa quête touchait à sa fin et il n'était à mon sens pas
besoin de faire intervenir ce fantôme surgi du passé. Voilà le seul bémol à un
récit intelligent dans lequel l'auteur déploie avec talent l'art de planter un
décor, une atmosphère dans ce coin perdu de campagne.
Littérature française
voisinage / amitié / trahison / silence /
déni /
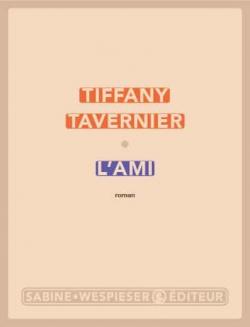
Posté le 19/05/2021 à 16:49
Kimmy Diore a disparu. Agée de 6 ans,
la petite fille et son frère aîné sont les héros d'Happy Récré, une chaîne You
Tube suivi par plusieurs millions d'abonnés. Clara Roussel fait partie de
l'équipe chargée de l'enquête. Elle se plonge dans l'univers des chaînes
familiales où les parents partagent avec les spectateurs les multiples
aventures de leurs rejetons, à coup de défis divers et parfois absurdes, dans
des mises en scène artificielles financées par des marques. Happy Récré
n'échappe pas à la règle, menée par Mélanie Claux, candidate malheureuse à un
jeu de téléréalité diffusé dans les années 2010. Nul doute que Mélanie trouve
là un parfait exutoire pour ses ambitions déçues, persuadée qu'elle fait du
même coup le bonheur de ses enfants. Mais Clara n'en est pas aussi sûre : sur
les vidéos, Kimmy paraît de moins en moins coopérative.
Delphine de Vigan nous entraîne dans un
monde de paillettes, de bisous d'étoiles et de trucs de fou, où les enfants
déballent de multiples cadeaux, où pendant 24 heures les parents disent oui à
tout. Les enfants sont rois, jusqu'à l'écœurement, dans une surenchère permanente
dont l'enjeu rapporte de juteux bénéfices pour les parents. C'est ce qui saute
aux yeux de l'enquêtrice, de certains internautes et du lecteur. Aux profits
dégagés par ces vidéos se pose le double problème de l'exploitation de ces
enfants, plus ou moins complices de ce système qui bénéficie encore d'un
certain vide juridique, et de l'ambition des parents qui comme Mélanie y
trouvent là un moyen d'accéder à la célébrité. Après une première partie un peu
longuette, le récit prend sa vitesse de croisière pour nous faire découvrir, de
façon assez réussie, l'envers du décor. J'ai envie de faire le parallèle avec Florida, le dernier roman d'Olivier Bourdeaut
où il est question des concours de mini miss. Dans les deux cas, il y a cette
mère abusive et avide de gloire, qui n'hésite pas pour les réaliser à user de
ses enfants sans aucune vergogne ; qu'on participe à des concours de beauté ou
qu'on soit filmé du matin au soir, il y a cette terrible pression du regard de
l'autre sans lequel on croit n'être rien, au prix de dégâts terribles quand ces
enfants rois sont devenus adultes.
Catégorie
: Littérature française
réseaux
sociaux / enfance / famille /
maltraitance / estime de soi /
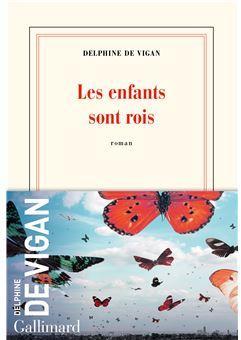
Posté le 10/05/2021 à 15:56
Il marche. Raymond est originaire
d'Oran qu'il a quitté au moment des "événements" comme on nommait
alors la guerre d'indépendance de l'Algérie. Il est devenu Ray depuis son
arrivée aux Etats-Unis, et il marche donc, tous les jours ou presque, et
parcourt sans relâche les rues de New-York, d'abord accompagné par son ami
Salah, puis seul, après le départ de celui-ci. D'abord employé au marché aux
poissons, il a obtenu un poste de portier dans une résidence de luxe au 10,
Park Avenue. Tout en restant professionnel dans son uniforme aux galons dorés,
il a noué des liens avec quelques-uns des occupants de l'immeuble qui semblent
avoir une grande estime pour cet homme discret et efficace. Sous ses yeux se
déroulent quarante ans de vie urbaine, dans le microcosme de la résidence, ou
dans les menus incidents de son existence, avec ses relations amoureuses, ou
dans le macrocosme de la ville, où Ray note les changements dans les comportements
et les modes vestimentaires, ou les quartiers qui se transforment. Et puis, alors
que s'approche la retraite, il y a l'attentat du 11 septembre 2001, qui n'est
pas nommé, les personnages familiers qui disparaissent, c'est l'heure de
quitter New-York.
Cette fresque new-yorkaise aurait pu
être longuette et sans surprise, il n'en est rien. A travers ce long voyage
dans l'espace et dans le temps que nous fait faire l'auteur, qui semble
connaître la ville comme Ray la liste des occupants du 10, Park Avenue, sont
abordées les thématiques de l'exil, de l'amitié, de l'urbanisme, et aussi une
belle galerie de personnages, à commencer par le protagoniste, observateur discret
et plein de résilience, et guide merveilleux de cette ville qui, dit-on, ne
dort jamais.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois.
Catégorie
: Littérature française
Etats-Unis
/ New-York / exil / urbanisme / ville /

Posté le 01/05/2021 à 11:46
Une agence de com dans le Paris de
2019. Un cadre dirigeant quadragénaire, marié et père de deux enfants, qui
poste de jolies photos de sa famille sur les réseaux sociaux et récolte
commentaires élogieux et nombreux likes. Sauf que. Antoine est un prédateur,
l'un de ceux qui se servent de leur pouvoir et de leur réussite pour aller
pêcher sans vergogne parmi le cheptel féminin que leur offre leur entreprise. La
femme est objet de désir et semble jouer le jeu, se dit Antoine, s'il en croit les
échanges de SMS avec sa dernière conquête en date, Sarah, jeune stagiaire
investie dans son travail.
Le gingembre, nous explique-t-on en exergue
du roman, permet de se nettoyer le palais entre les plats de la cuisine
traditionnelle japonaise. Les gingembres d'Antoine, ce sont ses posts
idylliques, qui viennent couper ponctuellement une réalité tout autre : celle
du milieu professionnel où officient RH et DG, un milieu de requins où la
compétitivité est aussi naturelle que la tendance à abuser du café de chez
Starbucks ; celle de la séduction et du pouvoir de l'homme en rut,
littéralement, que l'idée d'un sexe épilé fait bander en réunion. Des scrupules
? Antoine n'en a aucun, qu'il s'agisse du fait de tromper sa femme ou de
considérer ses conquêtes comme des objets. La réification de l'autre est le
cadet de ses soucis. Alors évidemment, le jour où la chance tourne, il a du mal
à comprendre. Sa lente mais inexorable descente aux enfers a sans doute de quoi
réjouir : depuis MeToo, les salopards de son genre n'ont plus d'impunité et
doivent rendre des comptes. Cependant, il y a dans la forme de ce roman quelque
chose de dérangeant : le choix d'ancrer les faits dans une réalité très
factuelle, sans analyse, donne l'impression au lecteur d'être une sorte de
témoin parfaitement impuissant des méfaits de ce mâle dominant dans des
relations hypersexualisées dont les partenaires sont plus ou moins consentantes
– jusqu'à ne plus l'être du tout. L'auteur s'abstient volontairement de tout
jugement, nous présente l'histoire d'un homme malade, incapable de réfréner ses
pulsions, un peu à la manière du documentaire belge Striptease dont les réalisateurs avaient fait le choix de laisser
la parole aux seuls protagonistes. Sur la forme, le récit est volontairement déstructuré,
raconté par un "je" dont on se rend compte tardivement que c'est bien
le même à chaque fois, tandis que l'ordre des chapitres ne respecte pas l'ordre
chronologique ; les seuls repères sont ces posts qui appellent, alors que
s'entame la dégringolade de leur auteur, de moins en moins de commentaires.
C'est donc une œuvre déroutante, sur la forme et sur le fond, et un roman dont
l'analyse a posteriori m'a fait davantage apprécier la profondeur qu'à la première
lecture.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois.
Catégorie
: Littérature française
harcèlement
/ viol / emprise / entreprise / pervers /
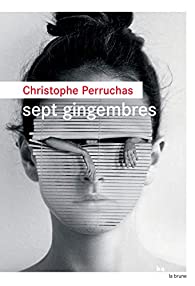
Posté le 01/05/2021 à 11:43
Pour ses sept ans, la mère d'Elizabeth
lui offre une surprise : participer à un concours de mini miss. Chance de
débutante, la petite fille gagne le premier prix. C'est la première étape d'un
marathon de la beauté et de la rivalité qui va durer cinq ans. Cinq ans durant
lesquels Elizabeth va participer chaque week-end à des compétitions, dont elle
ne finira plus jamais la première. Cinq ans d'obéissance, à faire "ce
qu'on a dit", à subir sans broncher séances interminables d'épilation – à son
âge ! -, de maquillage et de coiffure, et à respecter les chorégraphies
imposées par celle qu'elle surnomme la Reine Mère. Un singe savant. Jusqu'au
jour où Elizabeth se révolte…
Ainsi l'enfant passe-t-elle de
"très belle et pas trop bête" à une adolescente bouffie dont le
distributeur de boissons et autres consolations sucrées devient le meilleur ami.
Dans la détestation de soi, il y a ensuite la période où Elizabeth sert de
sésame aux garçons pour entrer dans la sexualité. Jusqu'à ce qu'elle tombe
amoureuse. Alors pour l'amour, le vrai, elle va se transformer à nouveau : la
grasse chenille quitte sa chrysalide pour devenir un papillon fin et élégant dont
la beauté attire les hommes, y compris ceux que l'on ne voudrait pas. Retour
des montagnes russes, voilà Elizabeth éjectée du monde où tout n'est qu'ordre
et beauté, luxe, calme et volupté pour se retrouver à la rue. Une autre
rencontre va l'amener à opérer une nouvelle transformation, et voilà le
papillon qui se met à faire de la musculation de façon acharnée…
Il y a quelque chose de terrible à lire ce
qui est présenté comme une sorte de confession : Elizabeth voue à ses parents
une haine féroce, à sa mère d'abord qui l'a utilisée comme un objet, mais aussi
à son père qu'elle a fini par appeler le Valet de la Reine Mère, lâche et
heureux finalement que les concours de beauté lui permettent de passer des
week-ends bien tranquille, et parfaitement aveugle face au malaise grandissant
de sa fille. Mais la haine, elle la nourrit aussi envers elle-même, pratiquant
la boulimie, puis les régimes, et enfin la musculation à outrance. Le corps,
cet objet que l'on peut maltraiter tant qu'on veut, pour se venger de
l'ambition maternelle dissimulée sous le fard et les fanfreluches de ces
petites filles savamment dressées pour la compétition. Le corps, objet de désir
et de haine, victime d'une sorte de narcissisme expiatoire. Elizabeth est
partagée entre soumission et révolte, passivité et pugnacité ; elle est animée d'un
désir d'indépendance qu'elle ne réalise pas – chaque changement chez elle est
provoqué par la rencontre d'un homme. Le personnage pourrait être touchant, mais
on peine à avoir de la sympathie pour elle. Peut-être le style très direct,
parfois cru, choisi par Olivier Bourdeaut, ainsi que certains jeux de mots un
peu faciles, y sont pour quelque chose. Je n'ai en tout cas pas retrouvé dans
son troisième roman la magie et le brin de folie qui m'avaient tant touchée à
la lecture de En attendant Bojangles.
Catégorie
: Littérature française
beauté
/ famille / maltraitance / estime de soi / corps /

Posté le 27/04/2021 à 09:33
La pluie ne cesse de tomber depuis des
jours, entraînant des inondations sans précédent dans toute la région. Un ado atteint
de leucémie regarde, de sa chambre à l'hôpital, la pluie ruisseler sur la
vitre. Un jeune couple bientôt parent est profondément affecté par la
disparition progressive des dernières baleines noires qui viennent s'échouer,
blessées par les filets des pêcheurs. Un homme ivre rôde autour de la maison de
son ex compagne et tombe nez-à-nez avec un coyote venu fouiller les poubelles.
Il s'appelle Samuel Légaré. Le petit dernier d'une grande famille, surdoué,
s'affranchit de toute richesse pour aller parcourir le monde, engagé dans une
démarche écologique militante, au grand dam de son frère aîné qui se demande ce
que le benjamin a trouvé qu'il n'a pas compris. Des gamins s'approprient un
terrain vague bientôt remplacé par un chantier qui, une fois achevé, signera la
fin de leur enfance. Des oiseaux quittent un jour toute une région pour s'en
revenir inexplicablement quelques mois plus tard. Un vieil homme soigne un orme
centenaire pour le protéger de la graphiose, avant de succomber à un cancer. Le
fil conducteur de ces sept nouvelles, c'est le Québec, et aussi les rapports
qu'entretiennent les hommes avec le monde qui les entoure. Celui-ci change, et
par forcément pour le mieux : certains des personnages en ont conscience et
agissent, trouvent des solutions, tandis que d'autres assistent à ce
bouleversement avec une sorte de passivité résignée. Chacun de ces micro-récits
est là pour le rappeler, sans jamais cependant être moralisateur : la maison
brûle et nous regardons ailleurs, comme l'a dit un jour un ancien président.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Divers
écologie
/ climat / Canada /
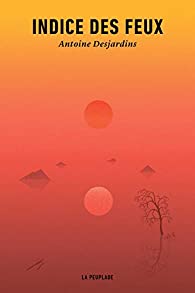
Posté le 19/04/2021 à 17:40
Romain, le meilleur ami de Sandra,
souhaite avoir un enfant avec son compagnon Marc. Le couple fait appel à des
mères porteuses aux Etats-Unis, mais les tentatives se soldent par un échec. Le
désir d'enfant est si fort que Romain finit par demander à Sandra de porter son
enfant. Elle n'a jamais voulu être mère, et c'est que qui va l'amener à
accepter : elle n'aura ensuite aucun état d'âme à se séparer de l'enfant. Du
moins le croit-elle.
Dans cinq mois, vous serez maman, lui écrit
la CAF. Dégage, dit Sandra à l'enfant à venir, regrettant déjà cette décision
prise par amitié. Rien ne lui est plus étranger que la maternité, rien ne la
rebute davantage que cette idée de porter la vie, de faire corps avec un
étranger. Mais ce courrier, dont Romain regrette de ne l'avoir pas reçu, lui
qui au contraire est si prêt à devenir père, va lentement basculer les choses.
Voilà que l'attachement commence à se faire, entre la femme pas encore mère et
l'enfant à venir. Il faut dire que Sandra a beaucoup à réparer, la mort de son
petit frère, celle de sa mère, et que ces deuils inachevés contribuent pour
beaucoup à ce qui se passe en elle. Charlotte Pons aborde avec délicatesse les
sujets délicats de la GPA artisanale et de la maternité - à partir de quand
devient-on mère ? L'est-on automatiquement dès que l'on se sait enceinte ?
Peut-on porter un enfant sans s'attacher à lui ? Peut-on n'être qu'un ventre ? -,
sans prendre parti, racontant les émotions qui saisissent les différents
acteurs de la grossesse, les contradictions de Sandra, l'enthousiasme de Romain
et de Marc, et la lente construction de la parentalité.
Catégorie
: Littérature française
grossesse
/ GPA / mère porteuse / maternité /
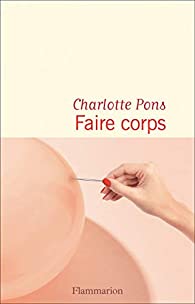
Posté le 19/04/2021 à 17:38
Ils sont sept. Quatre Français, trois
Italiens, qui s'allient pour entamer la montée du Mont-Blanc via le pilier
central du Fréney, un beau jour de juillet 1969. Nulle compétition entre eux,
ils vont œuvrer ensemble pour parcourir cette voie encore intacte. Ils partent
donc confiants, la météo est bonne, ils seront au sommet en trois jours. Mais
c'est sans compter avec un orage imprévu, une véritable tempête qui va durer
plusieurs jours et mettre à mal l'expédition dont ne reviendront que Pierre
Mazeaud, Walter Bonatti et Roberto Gallieni.
Ces sept hommes ne sont pas des
débutants. Certains sont même des alpinistes reconnus internationalement, et
tous sont chevronnés, avec une grande expérience de la haute montagne. Aux
premières salves de l'orage, ils vont ce qu'ils savent faire, éloignent toutes
les pièces métalliques et attendent l'accalmie. Mais elle ne vient pas :
l'orage frappe, encore et encore, interminablement, fait chuter les
températures d'un gel habituel à cette altitude de 4500 mètres à un froid
descendant sous les -20°. Et c'est un véritable enfer qui va durer sept jours,
conduisant la cordée à prendre la douloureuse décision de redescendre, dans des
conditions dantesques, avec, au fur et à mesure de leur progression aveugle et
trébuchante, ceux qui tombent, d'épuisement, de faim et de froid. Le récit,
relaté avec une précision glaçante par l'écrivain et journaliste Virginie
Troussier, nous mène au cœur même du drame, reconstituant pas à pas, rappel
après rappel – il en faudra 50 au total pour revenir au refuge du départ – les circonstances
de cet événement tragique pour lequel les survivants ont dû rendre des comptes.
Les rescapés sont ceux que leurs compagnes attendaient, c'est sur cette note,
et l'idée que les morts restent encore un peu là, au côté des vivants, pour
alléger le poids de la culpabilité de s'en être sorti, qui clôt un récit
magnifique malgré la tragédie. Un récit qu'on lit comme une sorte de thriller
avec le décompte des jours et des nuits dans la tempête, servi par une langue
magnifique qui sait restituer la poésie effrayante et grandiose de la haute
montagne.
Catégorie
: Littérature française
alpinisme
/ mort / orage / tempête / Mont-Blanc /
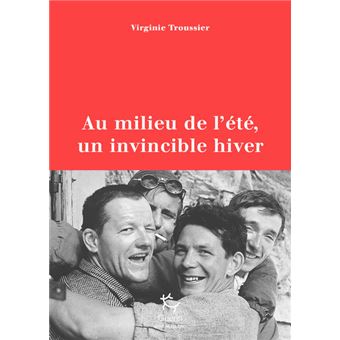
Posté le 10/04/2021 à 19:36
Mary vient de subir une rupture
amoureuse. Elle décide de partir en vacances sur l'île de Ven avec son fils
Célian, son petit garçon de 10 ans à haut potentiel qui souffre à l'école. L'île
de Ven, sur la mer Baltique entre Copenhague et Elseneur, c'est l'endroit où a
vécu Tycho Brahe, astrologue du 16ème siècle. Célian est féru
d'astrologie, et se passionne pour la faune et la flore locale, trouvant là de
quoi rassasier son insatiable curiosité, tandis que sa mère trouve un peu
d'apaisement à échanger avec un professeur de littérature britannique avant de
rencontrer un natif de l'île qui parvient à épancher ses blessures.
Mary se raconte, raconte son fils, raconte
son père qui lui a fait découvrir Tycho Brahe ; elle parle aussi du travail du
Professeur, qui défend la thèse selon laquelle Hamlet serait l'illustration de la dispute ayant opposé
l'astrologue à ses confrères. Dans son récit se mêlent Shakespeare, les
constellations, les oiseaux de l'île, les cheveux blancs de Björn et ses
caresses, le corps qui renaît doucement au désir de vivre. De cette parenthèse
de deux mois passés sur cette île enchantée, mère et fils repartent apaisés, et
prêts à revenir dans la vie. Il y a beaucoup d'érudition là-dedans, mais jamais
de forfanterie, et surtout, beaucoup de douceur. Cette histoire est la
sensation d'une main apaisante sur un front brûlant, un plaid posé sur l'enfant
endormi, rêvant d'un voyage entre mer et
étoiles, au milieu des oiseaux marins.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
île / guérison / voyage /
astronomie /

Posté le 10/04/2021 à 19:33
2031. La majeure partie des espèces
animales sont en voie d'extinction. Alors qu'un sommet mondial réunit les chefs
d'état des principaux pays, et qu'un généticien tente vainement de les
convaincre d'adopter un traité pour sauver la diversité animale, Dieu, ou
plutôt Déesse, car c'est une femme, charge Noé d'envoyer sur Terre un quatuor
d'animaux déguisés en humains. Ils devront plaider leur cause et s'assurer que
tous les pays signent le traité de protection des animaux. Ainsi sont choisis
un gorille, une truie, un chien et une chatte pour défendre leur cause. Mais
rien n'est simple pour ces missionnaires qui sont certes doués de parole mais
peinent à réfréner leurs instincts et se défaire de leurs habitudes.
On pourrait s'attendre à une comédie
déjantée sur fond de plaidoyer pour la sauvegarde des espèces animales, et
uniquement à cela. Mais l'histoire proposée par Sophie Hénaff est plus que cela
: certes, il ne fait pas l'impasse sur certains gags, comme l'irruption de la
truie en plein débat final, qui sème la panique parmi les participants, ou la
chasse au chasseur menée par les animaux ; mais il y a une belle profondeur
dans ce récit, à travers le personnage de Martin, le généticien qui s'obstine à
féconder les dernières girafes, ou à travers les interrogations de Kombo le
gorille, dernier mâle alpha de son espère, ou de Rose la truie, qui n'a connu
de la vie que la mise au monde de 63 petits élevés dans une cage où elle ne
pouvait se retourner. A travers les aventures de ces quatre mousquetaires qui
n'oublient pas leur nature profonde, se tissent la thématique des conséquences
désastreuses du changement climatique et celle des rapports que nous humains
entretenons avec les animaux. Des rapports complexes, qui nous font fermer les
yeux sur les conditions d'élevage ou d'abattage de ceux qui nous nourrissent,
ou la disparition bien entamée des abeilles ou d'autres espèces animales, et
des questions qui ont le mérite d'être posées sans être moralisatrices,
contrairement à certains romans sur la thématique de l'écologie qui fleurissent
actuellement sur les présentoirs des libraires. Un roman plaisant donc, et
pédagogique.
Catégorie
: Littérature française
cause
animale / écologie / climat /
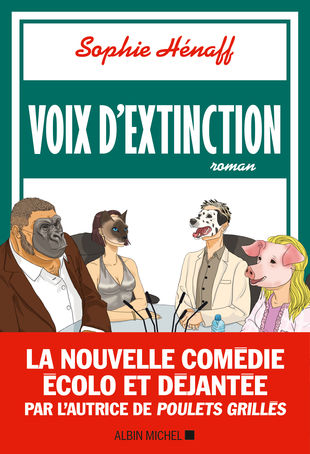
Posté le 10/04/2021 à 19:31
La table est mise sur la terrasse de
l'appartement d'Esther et de Reza, le parasol installé comme dérisoire
protection contre le soleil accablant, les chaises vides n'attendent que les
convives. Qui n'arrivent pas et se désistent tour à tour. C'est l'occasion pour
Esther de se souvenir de sa rencontre avec son mari, et de la venue de leurs
enfants. Des enfants mal aimés, se dit-on à la lecture de ses souvenirs. Il y a
Alexandre, l'aîné, que son père a tenté de dresser en singe savant et qui
aurait tant aimé faire du piano plutôt que de se plier aux numéros de calcul
mental paternels ; Vanessa la benjamine, que sa mère n'a pas supporté de voir
partir pour l'Australie et qui la bat froid ; Bruno qui a vécu dans l'ombre de
son grand-frère et noue envers lui une rancune tenace suite à une dispute lors
de son mariage ; enfin Carole, médecin elle aussi, qui ne cesse de parler par
peur du vide.
Aucun d'entre eux n'a envie de participer à
ce repas auquel la mère a tant tenu, espérant avoir autour d'elle sa famille
réunie, alors que c'est devenu si rare. Dans la cuisine les poulets rôtis
réchauffent doucement, la salade de tomates est bien au frais dans le réfrigérateur,
Reza est parvenu à fixer le parasol, et Esther attend en se souvenant. Une
heure, deux peut-être, d'attente, comme suspendues, et des années de vie revues
à l'aune d'Esther, qui semble ne manifester aucun regret de ce qu'elle a vécu
ou fait vivre à ses enfants. Drôle de personnage que cette mère de famille,
tour à tour mère abusive ou satisfaite, que ne semble jamais effleurer le
moindre remords ; drôle de père que ce Reza, que ses origines iraniennes
semblent avoir transformé en patriarche égocentrique. Pas étonnant, alors, que
les enfants répugnent à venir. Sans aucun jugement ni prise de parti, Alexandra
Matine nous dresse le portrait d'une famille où l'on ne parle pas, où l'on
n'exprime pas ses sentiments. Il faut le malaise d'Esther pour qu'enfin, les langues
se délient quelque peu et que les sentiments affleurent – à peine. La voilà, la
grande occasion qu'attendait Esther, de voir enfin les siens réunis, et tant
pis si c'est un peu tard.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Littérature française
famille
/ maladie / non dits /

Posté le 10/04/2021 à 19:28
Gil, 18 ans, prépare activement le
concours d'entrée au Conservatoire comme pianiste. Reçu brillamment, il
continue à travailler son instrument, jusqu'au jour on sur le chemin des
vacances, il se met à fredonner sur une chanson diffusée par l'autoradio. Lui
qui n'a jamais eu qu'une voix fluette, à peine audible, découvre qu'il a une
voix. Encouragé par ses professeurs au Conservatoire et guidé par son
intuition, Gil quitte son instrument pour se consacrer au chant lyrique, et
suit une formation de ténor. Il devient choriste, puis interprète différents
petits rôles à travers la France avant de parfaire sa formation à Londres. Il
va finir par décrocher un rôle principal : sa carrière internationale est
lancée.
Avec Gil, on pénètre dans les coulisses
du monde de l'opéra, des répétitions, des enregistrements au fur et à mesure qu'il
devient célèbre. On mesure le travail acharné et la discipline de fer que
demande la maîtrise de la voix, des partitions, des nuances si subtiles.
Construit de façon très linéaire en chapitres très courts, ce récit initiatique
raconte l'ascension d'un instrumentiste devenu chanteur, sans réels obstacles à
part la maladie mentale de sa mère qui ne freine pas sa carrière. Le dénouement
un peu étrange semble avoir été mis là pour donner un peu de corps à une
histoire sans grandes surprises, mais qui a le mérite de nous faire découvrir
de l'intérieur l'univers méconnu du chant lyrique.
Catégorie
: Littérature française
musique
/ opéra / initiation /
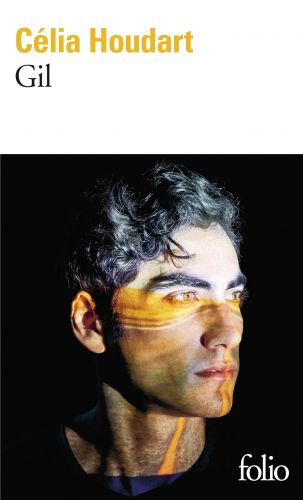
Posté le 10/04/2021 à 19:24
Nathan a divorcé de Jun, une céramiste
japonaise qui s'était installée en Bretagne. Un jour qu'il passe chez elle
récupérer leur fils Léo, il trouve un appartement vide. Jun est repartie dans
son pays natal, sans l'en informer. Il se rend alors au Japon malgré les
nombreuses mises en garde de ses amis : la loi japonaise stipule qu'en cas de
séparation, la garde de l'enfant d'un couple mixte est automatiquement
attribuée au parent nippon et ne reconnaît ni droit de visite ni garde
alternée…
En parallèle à la quête de Nathan se
déroule celle de deux frères à la recherche de leur sœur disparue elle aussi au
Japon, qui sont parvenus à attirer l'attention des médias, sans pour autant que
leurs recherches avancent beaucoup. Nathan les croise à plusieurs reprises, et
échange avec eux sur le peu d'enthousiasme de la police nippone à aider les
Français, dans un cadre qui frise l'incident diplomatique. Le système
judiciaire japonais semble avoir des pratiques d'un autre âge et ne sort pas
grandi de ce récit. On a la sensation, malgré toute l'admiration que le
protagoniste – et comme souvent chez Olivier Adam, le narrateur-auteur – semble
vouer au Japon, qu'il se heurte à un mur impénétrable, bâti sur des conceptions
à l'opposé des nôtres et, par moment, anti françaises. Au pays du matin calme,
il ne fait pas bon s'immiscer dans des traditions séculaires et se montrer
insistant, Nathan l'apprend à ses dépens. D'ailleurs, il paraît un peu falot,
ce personnage, qui subit coup sur coup deux ruptures amoureuses, face à des femmes
dotées d'une forte personnalité ; sa détermination à essayer de retrouver coûte
que coûte son fils est un peu contradictoire avec son mode de vie solitaire et
peu avenant, son caractère désabusé et passif, raison sans doute de l'animosité
féroce que nourrit son ex-femme à son égard.
Olivier Adam a pour habitude de mettre en scène son double littéraire,
et le fait cette fois sans trop de concessions, comme un miroir en négatif. Ce
Nathan ne paraît guère attachant, sauf dans son affection pour son fils. Il n'a
pas l'autodérision de Paul Lerner, cet écrivain en manque d'inspiration d'Une partie de badminton, et les
intrusions de l'auteur en rajoutent encore à la froideur d'un récit somme toute
assez glaçant, malgré la beauté des paysages bretons et japonais.
Catégorie
: Littérature française
Japon
/ couple / rupture / famille / enfant / loi /
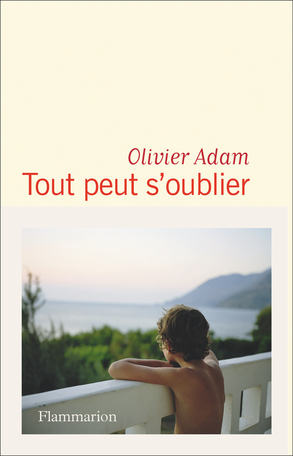
Posté le 10/04/2021 à 19:22
Un couple bancal s'installe à la
campagne en espérant s'y faire une nouvelle vie, malgré le désaccord de la
fille adolescente qui supporte mal de quitter ses amis parisiens. Oubliée
l'aventure extraconjugale de Stéphane, place à la vie au grand air, à l'atelier
de peinture pour Elisabeth. Mais rien n'est simple : Maëva peine à se faire des
amis, déteste un de ses camarades atteint du syndrome de Gilles de la Tourette
et se met à fréquenter un garçon plus âgé qu'elle ; Elisabeth souffre toujours
de terribles maux de ventre et d'anorexie, tandis que Stéphane se plaint des
trajets en RER pour aller travailler. Une histoire de vie somme toute assez
banale, avec sa dose d'émois adolescents, de désir conjugal qui s'est fait la
malle, et d'adultère. Mais c'est sans compter avec le corps, celui qui
découvre, ou redécouvre l'amour et le désir ; celui qui fait mal, vous plie en
deux et vous fait vomir ; celui qui grossit et vieillit ; celui qui vous fait
hurler, jurer et grimacer ; celui qui a vécu la perte et l'exil. Le corps
devenu étranger qu'on aimerait maîtriser, ou celui de l'autre qui suscite le
dégoût. Car il peut être objet de désir tout autant que désir de rejet, c'est
bien là la question centrale de ce récit, - qui pâtit à mon sens d'un trop
grand nombre de thématiques sociales -, pour basculer dans le drame sordide et
terrifiant.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
couple
/ infidélité / migrant / déni /
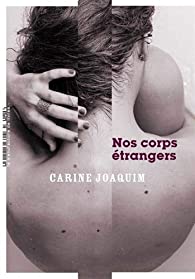
Posté le 21/03/2021 à 10:21
Monsieur de Sainte-Colombe, grand violiste
du 17ème siècle et veuf inconsolable, se produit en concert avec ses
deux filles, Madeleine et Toinette. Mais l'homme est un loup solitaire, qui
refuse d'aller jouer à la Cour. Arrive un jour un jeune homme de 17 ans, Marin
Marais, ancien chanteur à la Maîtrise du Roi et déterminé à perfectionner son
jeu de viole de gambe auprès du maître. Lequel finit, non sans réticence, à le
prendre pour élève. Le jeune homme commet l'imprudence de jouer devant el Roi
et se fait congédier par Monsieur de Sainte Colombe, mais continue de revenir
en secret visiter Madeleine dont il est amoureux, bénéficiant alors des
conseils avisés de la jeune fille… Roman adapté en film par Alain Corneau en
1991, avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet.
En à peine plus d'une centaine de pages,
d'une plume délicate et ciselée, Pascal Quignard nous offre le récit de
plusieurs vies : celle de Monsieur de Sainte Colombe, qui reçoit régulièrement
les visites du fantôme de sa femme et compose pour elle ses plus beaux airs,
tout en refusant jamais de les coucher sur le papier ; celle de Marin Marais,
ambitieux – il va assurer la direction de l'orchestre royal aux côtés de Lully
-, égoïste – ne dédaigne-t-il pas Madeline au profit de Toinette, aux formes
bien plus appétissantes ? - ; celle enfin des deux sœurs, dont l'aînée va
connaitre un destin bien tragique quand sa cadette se marie et vit, peut-on
supposer, heureuse. Le récit se tisse selon un tempo très musical, largo quand
feu Mme de Sainte Colombe vient visiter son mari, adagio ou moderato pendant
les leçons, presto et un bond d'une dizaine d'années pour revenir au largo du
veuf inconsolable. Et une tonalité mineure exprimant à chaque page la
mélancolie qui doit sourdre des rives de la Bièvre, à côté de laquelle le
maître a fait construire la cabane dans laquelle il compose tandis que Marin
Marais s'installe en dessous pour l'écouter et tâcher de percer le secret de la
musique. Une mélancolie que restitue la musique de Monsieur de Sainte Colombe,
qui améliore l'instrument et sa technique de jeu pour donner à la viole de
gambe toutes les intonations de l'âme humaine, et faire entendre la douleur,
car c'est elle seule qui permet à la musique de n'être pas seulement instrument
de divertissement mais un art véritable. "Quand je tire mon archet, c'est
un petit morceau de mon cœur vivant que je déchire.", explique-t-il à son
élève. Cela, il faudra des années à l'ambitieux Marin Marais pour le comprendre,
jusqu'à la dernière leçon qu'il recevra durant laquelle, enfin, les larmes
viennent.
Catégorie
: Littérature française
17ème
siècle / musique / ambition / don /

Posté le 21/03/2021 à 10:17
Compositeur talentueux, mondialement et
universellement connu pour son "Boléro", Maurice Ravel est décédé en
1937 de troubles cérébraux. Jean Echenoz raconte les dix dernières années du
musicien, de façon romancée, et dresse le portrait d'un personnage public qui
fait des tournées, de nombreux concerts, fraie avec de nombreuses personnalités,
mais aussi d'un solitaire à qui on ne connait aucune vie sentimentale, qui va
perdre petit à petit toutes ses facultés cognitives. Un personnage mystérieux,
qui n'a laissé pour seules traces que son immense oeuvre musicale mais très peu
de photos et aucun enregistrement de sa voix.
Ce récit commence lorsque Ravel s'apprête à
partir pour une tournée de quatre mois aux les Etats-Unis. Ce sont les fastes
des premières classes à bord du transatlantique le France, du pont duquel le
compositeur contemple la mer, "dans l'idée d'en extraire une ligne
mélodique, un rythme, un leitmotiv, pourquoi pas." On peut être un grand
compositeur sans pour autant être un grand musicien : la veille de son arrivée,
il donne un petit concert et exécute son Prélude
en La mineur : "il ne possède pas une grande technique, on voit bien
qu'il n'est pas exercé, il joue rapidement en accrochant tout le temps. […]
Bref il joue mal mais enfin bon, il joue. Il est, il sait qu'il est le
contraire d'un virtuose mais, comme personne n'y entend rien, il s'en sort tout
à fait bien." C'est donc un étrange personnage que ce Ravel présenté par
Echenoz, avec élégance et un humour parfois ravageur, qui voyage avec un
escadron de valises contenant une soixantaine de chemises, vingt paires de
chaussures, soixante-quinze cravates et vingt-cinq pyjamas,
n'a jamais vraiment travaillé le piano qui demandait trop d'efforts physiques,
ou s'énerve quand Paul Wittgenstein enjolive la partition de son Concerto pour la main gauche ; de son
Boléro, inspiré du travail à la chaîne, il s'étonnait de son succès, et a dit
d'une spectatrice criant au fou à la fin du concert qu'elle au moins avait tout
compris. C'est un personnage touchant aussi que ce petit homme à la carrure de
jockey, à qui l'on ne connaît aucune relation amoureuse et qui a toujours vécu
seul, qui assiste impuissant à sa lente et inexorable déchéance, incapable de
reconnaître ses œuvres en concert, qui dit à sa fidèle pianiste Marguerite Long
que c'est quand même terrible ce qui lui arrive.
Catégorie
: Littérature française
musique
/ 20ème siècle / compositeur / maladie /
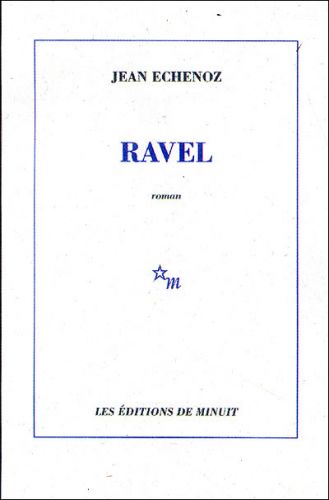
Posté le 15/03/2021 à 18:44
Le père de Louise vient de mourir, lui
léguant, ainsi qu'à son frère, le soin de s'occuper de sa collection de carpes
koï d'exception disséminées dans les bassins parisiens. Elle a bien d'autres
choses en tête, Louise, entre ses missions de conseillère en communication,
dont l'une consiste à s'occuper de son principal client, un designer égocentrique
incapable de mener un projet à bien, sa relation avec son amant obsessionnel et
son frère sociopathe atteint de misophonie (l'incapacité à supporter certains
sons, les bruits de mastication ou les raclements de gorge, par exemple).
Lorsqu'elle apprend que le jardinier chargé du soin des carpes a revendu l'un
des spécimens les plus précieux, elle n'hésite plus : il faut réunir toutes les
koï, quitte à les voler. C'est peut-être l'aspect le moins crédible de
l'histoire, d'imaginer cette jeune cadre brillante troquer ses escarpins contre
bottes en caoutchouc et épuisette pour écumer en pleine nuit les plans d'eau de
Paris, aidée par les comparses de son père. Mais faisons fi de ce détail, les
portraits sont truculents – le Maire qui monopolise le hammam de la Grande
Mosquée ou Ernesto, montalbanais qui doit son surnom à sa propension à fumer le
cigare – et la langue fort belle, qui touche presque au lyrique dans la très
belle scène du tremblement de terre au Japon, lequel a inauguré la mise en
place de la collection paternelle.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Littérature française
collection
/ famille / hommage /
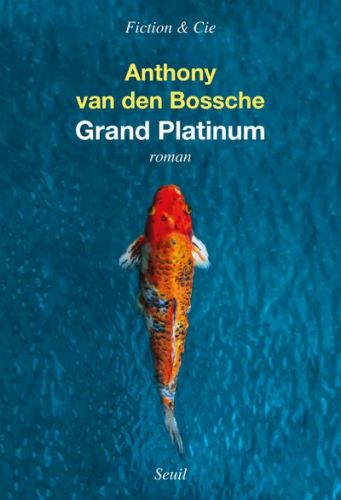
Posté le 15/03/2021 à 18:42
Viol et humiliation, voilà ce qu'a subi
cette bande de filles. Mia, Inès, Louise, Leo, Lila, Nina et Lucie en ont assez
d'être passives, d'entendre des discours sur la réparation sur l'importance de
"vivre avec" ; elles ne veulent plus de psychothérapie "pendant
que l'autre continue sa vie sans accroc, sans choc, toujours plus
puissant." Ce qu'elles veulent, ce qui va les guérir, c'est la vengeance.
Alors elles s'organisent, et font faire justice elles-mêmes. L'idée, c'est de
faire peur, de décourager le coupable de récidiver. Pas de le frapper ou le
blesser, non, elles se contentent de dévaster l'appartement du sale type, de
détruire ses objets de valeur sans le toucher. C'est Mia, qui assiste
régulièrement à des audiences au Palais de Justice, qui est la plus
vindicative, c'est elle qui a eu l'idée de ces expéditions punitives qui les
ont soulagées. C'est elle enfin qui propose à Lucie, victime elle aussi d'un
viol, de se joindre à elles. Voilà Lucie vengée, qui se sent moins seule,
vivante, enfin capable de retrouver le sommeil.
Alors bien sûr, elles n'ont pas tort,
ces filles, de se faire justice quand la Justice peine à faire son travail,
quand les violeurs écopent de peines bien inférieures aux dealers et aux
trafiquants de toutes sortes. Peut-être peut-on aussi les envier, car quelle
femme inquiète, à rentrer le soir tard les rues, à subir des mains pressantes
dans un bus bondé, n'a pas eu envie un jour de se venger d'être considérée
comme l'objet d'un désir malsain et humiliant ? De rabaisser l'homme qui l'a
rabaissée ? De lui faire comprendre qu'elle n'est pas une chose dont on dispose
à sa guise pour assouvir une pulsion ? De se sentir, enfin, toute puissante ? Oui,
évidemment. Mais de là à passer à l'acte, c'est autre chose. On peut dénoncer
les manquements de la Justice, le manque de soutien des femmes victimes de
violences – bien que les choses commencent enfin à changer -, sans pour autant
chercher à se faire justice soi-même. D'autant plus que les expéditions
punitives n'excluent pas une sorte de jouissance délétère qui m'a gênée. Le
discours féministe à ce titre me semble avoir des limites que ma morale
m'interdirait de franchir. Cela dit, ce roman pose également la délicate
question du consentement, et de la zone grise entre un refus et une acceptation
forcée devant l'insistance du partenaire. Combien de femmes, épouses,
compagnes, maîtresses d'un jour, un peu saoules, un peu perdues, ont-elles fini
par abdiquer et accepter un rapport qu'elles auraient préféré ne pas avoir ?
L'homme est-il alors un violeur, ou simplement un type trop pressé par son
désir ? Le refus était-il audible, visible ? Où se situe la limite ? C'est la
question que se pose Flo, le meilleur ami de Lucie, qui va faire lui aussi
l'objet de la vengeance du gang de filles. Une question que le mouvement #MeToo
n'a pas résolue.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
viol / vengeance /
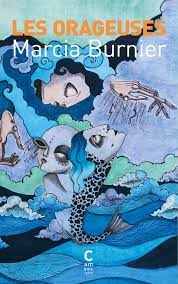
Posté le 15/03/2021 à 18:27
La maîtresse d'un homme marié se rend
seule à Turin où le couple illicite devait aller passer quelques jours. Voilà
un pitch bien maigre et un livre qui l'est tout autant. Est-ce à dire qu'il n'y
aurait pas d'histoire ? La narratrice fait ses bagages, prend le train et passe
deux nuits dans la capitale piémontaise, seule, et se livre à une introspection
sans fard et sans rancœur. Elle s'interroge sur ses liens avec Pierre, ce
Pierre qui a renoncé au séjour italien pour épauler sa femme qui vient de
perdre son père : l'aime-t-elle encore, depuis quatre ans que dure leur liaison
? Peut-elle se contenter de quelques heures de temps à autre, sans jamais de
nuits à partager, de baisers en public ? Ses doutes sont aussi ceux d'une mère
qui n'a jamais fait de crêpes à son fils, ceux d'une femme que l'âge grignote
petit-à-petit, ceux d'une solitaire partagée entre l'envie de faire couple et
l'assurance d'en être devenue incapable. Elle a fait ses bagages en se
résignant à rompre ; son séjour piémontais lui fait entrevoir d'autres horizons
que celui du regret et de la complainte. Nulle amertume dans ce récit, la
colère et la déception du départ cèdent finalement place à la tendresse. C'est
bien une histoire que nous conte Madeline Roth avec précision et une grande
élégance.
Au-delà de l'histoire de cette femme, il y
a ces passages, d'une finesse et d'une justesse qui m'ont frappée ; j'en
citerai un seul, qui justifie à mon sens les heures que l'on passe plongé dans
un livre : "A quel moment est-ce que j'ai compris ça, qu'il me faudrait
lire, beaucoup, pour toutes ces vies que je n'aurai pas ?"
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
adultère
/ solitude / déception / introspection / Italie /
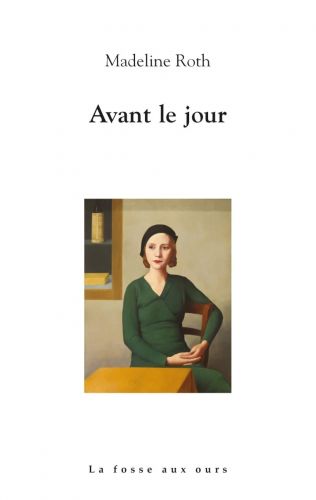
Posté le 06/03/2021 à 17:51
Un simple coup de fil, et c'est la vie
qui bascule. Carmen, fille de réfugiés argentins, apprend que son père décédé louait
un box dans un garde-meuble. Elle y découvre des témoins du passé de son père –
des photos, des articles de presse, et surtout son journal intime – et découvre
surtout qu'elle en ignorait tout. Elle se plonge alors dans une histoire qui
prend ses racines en 1936, dans la région de Buenos Aires, et traite de
l'histoire de cet homme sur fond de coup d'état et de dictature.
Carmen est fragile, avec son obsidienne
dans le ventre. Elle a été hospitalisée en psychiatrie pour troubles
borderline, souffre d'alcoolisme, et peine à garder un équilibre précaire dans
sa vie de femme et de mère. La lecture du journal d'Ernesto Gomez va rompre
toutes les digues qu'elle a tâché d'ériger. Les mots de son père ont de quoi
susciter l'horreur, à commencer par le meurtre épouvantable de sa mère alors
qu'il n'a que dix ans et qu'il s'appelle encore Juan. C'est ce drame fondateur,
ainsi que l'absence du père, violent et dangereux, qui a fini par quitter la
maison, qui vont déclencher toute la suite. On peut ainsi lire toute la vie de
Juan Moreau à la lumière de ces traumas initiaux, dans une approche
psychologique, pour comprendre comment, de victime, il est devenu bourreau, et
pas des moindres. Sa fille, qui découvre pétrifiée d'horreur – tout comme nous,
car certaines scènes sont absolument insoutenables – le rôle qu'a joué son père
dans les geôles péronistes, ne parvient pas à lui trouver d'excuses. La vérité
fait mal mais, passé le choc de toutes ces révélations, permet à Carmen de
redonner le coup de pied pour remonter à la surface et, enfin, pouvoir vivre.
Un roman à la lecture éprouvante certes, remarquablement maîtrisé dans sa
construction et l'évolution de ses deux personnages.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
Argentine
/ dictature / famille / secret / mensonge / dépression / traumatisme /
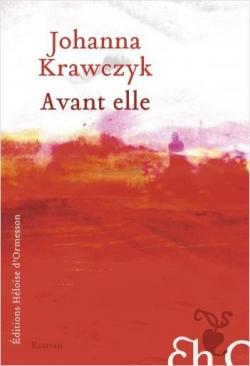
Posté le 19/02/2021 à 14:17
Un matin avant d'aller au travail, comme un
autre. Mais voilà que la voiture ne démarre pas. Une banale panne, facile à
résoudre, mais Clara ne parvient pas à téléphoner pour obtenir un dépannage.
Elle ne peut plus, elle n'en peut plus, elle s'écroule, elle craque. Ce matin-là, et tous ceux qui vont suivre,
elle n'ira pas travailler. Epuisement, stress, burn-out, Clara ne peut plus,
vêtue de son tailleur et de ses escarpins, continuer de vendre des crédits, d'assurer
des rendez-vous et rendre des comptes à sa responsable éternellement
insatisfaite. Ce matin-là, à cause d'une simple panne, la jeune femme prend
conscience de sa lassitude profonde, et de la vacuité tout aussi profonde de
son existence. Elle se cloître chez elle, décourage son compagnon avec lequel
elle a refusé de vivre en couple, s'isole, refuse de prendre les anxiolytiques
prescrits. Une longue traversée du désert où même aller faire des courses
relève d'une mission perdue d'avance. Une seule panne et tout s'effondre, comme
une seule lettre en plus peut tout faire basculer : de vaillante, Clara est
devenue vacillante. Jusqu'à ce qu'une amie d'enfance lui tende une main
secourable. Se reconstruire, tout doucement.
Catégorie
: Littérature française
dépression
/ burn-out / entreprise /
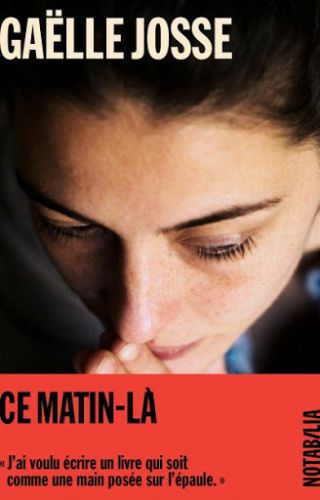
Posté le 19/02/2021 à 14:16
Walid Z., 26 ans, ancien étudiant de
Sciences Po où il est entré grâce au programme de la "discrimination
positive", comparaît devant la cour d'Assises de Paris. Accusé de viol par
Claire K., la femme de son directeur de recherches, il risque la peine de mort
par décapitation. A la barre, les témoignages se succèdent, tandis que les
proches et les connaissances de l'accusé prennent la parole pour construire un
récit terrifiant où l'on comprend que l'extrême-droite a pris le pouvoir...
Pour un jeune homme d'origine maghrébine
et issu des quartiers, l'entrée à Sciences Po est la garantie de l'ascension
sociale et d'une carrière réussie, et d'une sorte de revanche. Mais Walid va
vite déchanter : malgré sa réussie scolaire, il reste l'Arabe de service peu
fréquentable. Son travail acharné n'efface pas les humiliations, celles subies
dans l'école prestigieuse, et celles qui sont les conséquences des décisions
gouvernementales : Walid, désormais considéré comme un "octroyé",
bien différent d'un "Français de souche", est contraint de changer de
nom et, au terme de fastidieuses procédures administratives, doit se faire
appeler William ; lorsqu'il a rencontré les K., parents de sa copine, il a été
en butte au racisme affiché de celle qui va ensuite l'accuser. Alors il a beau
s'appeler William et avoir été un étudiant brillant, il n'en demeure pas moins
qu'il risque sa tête, puisque selon les nouvelles directives gouvernementales,
le viol est puni de peine de mort, "lorsqu'il est commis par une personne
agissant sous l'impulsion d'un racisme anti-français". Walid endure
ainsi un procès – dirigé par un juge qui expédie les séances pour épargner sa
phlébite – au cours duquel on ajoute à l'humiliation la lecture publique de son
journal intime et une stratégie de défense absolument pitoyable. L'argument
parole contre parole ne vaut pas, puisque la plaignante est, elle, de souche parfaitement
française. C'est à petites touches, dans le vécu de chacun des nombreux
personnages de ce roman choral – jurés, victime, universitaire, petite amie,
avocat, juge, et l'accusé lui-même – que se dessinent les contours d'une
société tout à fait plausible, qui met en place la préférence nationale, et qui
fait froid dans le dos.
Catégorie
: Littérature française
justice
/ viol / peine de mort / procès /
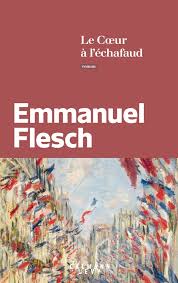
Posté le 19/02/2021 à 14:14
Tokyo, 1938. La tension est grande entre la
Chine et le Japon. Quatre musiciens, Yu, un Japonais, professeur d'anglais, et
trois de ses étudiants chinois, se réunissent pour répéter des morceaux de
musique classique occidentale. Un jour, alors qu'ils travaillent le premier
mouvement d'un quatuor à cordes de Schubert, des soldats interrompent la répétition,
piétinent le violon de Yu et embarquent les musiciens. Caché dans une armoire, Rei,
le fils de Yu, âgé de 11 ans, assiste à la scène d'autant plus traumatisante
qu'il ne reverra jamais son père. Un des soldats l'aperçoit mais ne le dénonce
pas, et lui confie l'instrument brisé.
Voilà pour l'allegro ma non troppo.
L'andante se déroule une bonne cinquantaine d'années plus tard. Rei l'orphelin
est devenu Jacques Maillard, luthier de son état. Toute sa vie s'est déroulée
sous le signe de ce traumatisme dont il n'est jamais parvenu complètement à se
défaire. Le hasard et la sagacité de sa compagne archetière l'amènent à renouer
avec son passé japonais, et à retrouver quelques-uns des fantômes qui le
hantent. Menueto : allegretto. Non qu'il s'agisse pour lui d'opérer une
quelconque vengeance, bien au contraire : Jacques/Rei trouve petit à petit le
moyen d'adoucir sa peine et de se reconstruire, patiemment, à, petites touches,
tout comme il a pu, lentement, mais avec opiniâtreté, réparer le violon de son
père. L'âme brisée, c'est celle du violon, cette petite pièce d'épicéa qui
relie le fond et la table d'harmonie d'un instrument à cordes, une toute petite
pièce de bois cependant essentielle puisqu'elle assure sa stabilité à
l'instrument et qu'elle lui permet de résonner. C'est aussi, évidemment, celle
de Jacques/Rei, qui va tout doucement se réparer. Evidemment, ce n'est pas pour
rien qu'il a choisi le métier de luthier, ni qu'il aime une archetière. Deux
métiers aussi complémentaire que le sont notre protagoniste et sa compagne
Hélène. Avec une grande délicatesse, Akira Mizubayashi raconte ce personnage et
son parcours de résilience ; il raconte aussi Schubert – on trouvera dans ce
récit de très belles descriptions de moments musicaux. Raconter la musique, le
ressenti à son écoute, c'est comme essayer de mettre des mots sur une odeur, un
goût. Il y faut la finesse de l'amateur, au sens premier du terme.
Catégorie
: Littérature française
musique
/ famille / solitude / traumatisme / résilience / violon / mémoire /
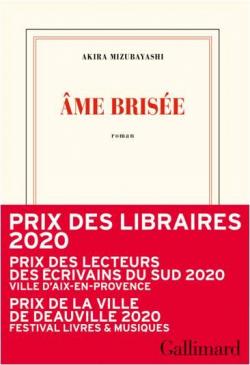
Posté le 14/02/2021 à 16:13
Paul travaille à la Poste. Mal habillé,
les dents de travers, le cheveu rare, il n'a rien pour lui, à l'exception de
ses très beaux yeux bleus. il souffre de sa grande laideur et vit replié sur
lui-même, plein d'envie et de rancœur. Pourtant, lorsque Mylène emménage dans
l'appartement d'en face, il est si fasciné qu'il surmonte sa timidité et
l'aborde. Une amitié se forme, qu'enfreint Paul une fois. Mylène ne lui
pardonne pas d'avoir franchi la ligne rouge et s'éloigne ; le voilà à nouveau
seul avec toute sa frustration. Il se console auprès d'Angélique, une collègue,
qu'il parvient à séduire plus facilement que Mylène.
Angélique est seule, mère célibataire,
et fragilisée par des blessures intimes. Plantureuse, séduisante sans le faire
exprès, elle est en quelque sorte instrumentalisée par Paul qui ne voit chez
elle que la possibilité de lui faire oublier Mylène et d'évacuer sa
frustration. On n'y verrait là rien de trop répréhensible finalement, n'était
le caractère obsessionnel de Paul, qui tient des carnets sur les femmes, dans
lesquels il consigne, à leur insu évidemment, les moindres détails de leur
existence. Des carnets onéreux, remplis de notes faites à l'encre bleue d'un coûteux
Waterman. Voilà dressée, dès les premières pages du roman, la nature maniaque
et malsaine du personnage, qui va monter en force tout au long du récit, d'autant
qu'elle se double d'une jalousie compulsive. On a là exposés, disséqués, les
fondements d'une violence conjugale, physique et morale qui s'exerce sur une
proie facile à dominer, un peu candide, gentille, et qui a tant besoin d'être
aimée. Paul est-il capable d'aimer, à commencer par lui-même ? On appréciera,
ou non, la troisième partie du roman consacrée à la "guérison" de
Paul. En tout cas, la démonstration des mécanismes de violence conjugale et
d'emprise est plutôt bien réussie.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
couple
/ emprise / jalousie / violence / laideur /
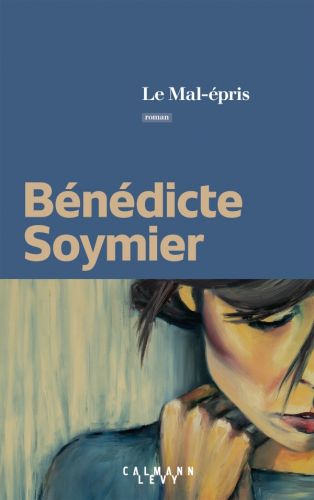
Posté le 12/02/2021 à 11:11
Figuette est tombé amoureux fou de Moïra, une
jeune femme passionnée et fantasque. Mais Moïra est partie sans un mot, le
laissant s'occuper seul de leur petite fille de 6 ans, Zoé. L'avenir semble
bien sombre, d'autant qu'en plus d'être père célibataire Figuette risque de
perdre son emploi car l'usine de la région de Lorraine où il travaille menace
de fermer. Les factures s'accumulent, l'été arrive, Figuette est malheureux
comme les pierres, mais il a promis des vacances à Zoé. Il improvise un séjour dans le sous-sol de la
maison…
La vie est dure pour ces familles
d'ouvriers menacées par le spectre du chômage, mais la solidarité est là, au
sein de ce quartier de la Caserne. Quitte à frôler l'illégalité en récupérant
des robots ménagers tombés du camion pour les revendre et constituer une caisse
de solidarité. La dureté de la vie n'empêche pas qu'on rigole un bon coup de
temps en temps, comme quand Bolchoi et Piccio font une course en fenwick autour
de l'usine, pour ensuite aller déplacer la Twingo du patron sur le parking en
se marrant d'avance quand son propriétaire va la chercher. Pourtant, il y a le
chagrin avec lequel compose Figuette depuis que Moïra est partie. Sa Moïra
imprévisible, violente, passionnée, un peu folle, qu'il n'a pas su retenir.
Figuette se sent coupable de n'avoir pas su entretenir le feu des soirées qu'il
improvisait à grand renfort de décors en carton-pâte, et s'il installe au
sous-sol de sa maison un camp de vacances improvisé pour amuser sa fille, c'est
pour la distraire et tenir sa promesse, mais aussi parce qu'il espère ainsi, en
postant de jolies photos de vacances de Zoé et du chien Mouche, pouvoir faire
revenir sa Moïra. Il y a de la tragi-comédie dans ce récit où résonnent des
mots d'italien, de ces immigrés de la troisième génération, et du patois local.
Figuette est chtarbé de chagrin, sa vie est frâlée mais il faut tenir.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
usine / pauvreté / famille
/ solidarité / révolte /

Posté le 12/02/2021 à 11:10
Sixtine est issue d'une famille
profondément catholique. Très pieuse elle aussi, elle rencontre Pierre-Louis Sue
de la Garde (ça ne s'invente pas) qui ne tarde pas à la demander en mariage. Le
jeune couple emménage à Nantes. Mais Sixtine n'est pas heureuse : les rapports
intimes avec son mari sont tout sauf satisfaisants, et, très vite enceinte,
elle supporte mal sa grossesse. Autour d'elle, sa belle-mère lui serine qu'elle
doit endurer ses douleurs sans se plaindre, comme une bonne chrétienne. Sixtine
culpabilise, s'astreint aux prières, accepte de tenir le rôle de
"croisée" dont on la charge, et craint de décevoir un mari souvent
absent, fort actif dans un groupe catholique d'extrême-droite appelé Les Frères de la Croix. Mais au cours
d'une manifestation entre les membres du groupe et des militants gauchistes, elle
commence à ouvrir les yeux sur un monde qu'elle ignorait.
Sixtine vit dans un autre monde. Un
monde où une femme enceinte n'est pas fatiguée, supporte ses nausées avec le
sourire et n'envisage pas d'accoucher sous péridurale. Tu enfanteras dans la
douleur. Un monde où l'acte sexuel se borne à cinq minutes d'une gymnastique
douloureuse et décevante. Un monde bien comme il faut, bien rangé, où l'on
porte jupe longue et mocassins plats, et où l'on récite le rosaire pendant une
heure à genoux – enceinte ou pas. Ce début de roman fait bigrement songer à la
série Unorthodox récemment diffusée
sur Netflix, qui mettait en scène un milieu juif ultra-orthodoxe. Les intégrismes
se ressemblent, tout autant que cette façon de vivre hors du monde réel, et de
perpétrer des traditions désuètes et, pour certaines, dangereuses. On frôle le
sectarisme. Sixtine est comme Esther à ce point embrigadée dans des valeurs et
des croyances d'un autre âge qu'il lui faudra du temps pour réaliser pleinement
la dangerosité du monde dans lequel elle vit. Ce n'est qu'une fois devenue mère
qu'elle ouvre enfin les yeux et qu'elle a le courage de fuir. Il en va de sa
survie. Cependant, son intégration dans le monde réel ne va pas de soi et
montre à quel point il est difficile, et douloureux, de se libérer de tous les
réflexes inculqués depuis l'enfance. Sixtine ne renie ni sa foi ni ses valeurs,
elle découvre l'humanité.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
religion
/ intégrisme / famille / emprise / liberté /
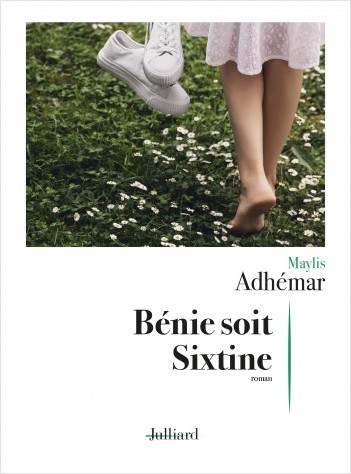
Posté le 12/02/2021 à 10:58
Violette Toussaint est gardienne de cimetière
dans une petite ville de Bourgogne. L'équipe des fossoyeurs, les trois frères
entrepreneurs de pompes funèbres, le curé et des habitués parfois se retrouvent
régulièrement dans sa cuisine et racontent des petits riens, des choses de la
vie, des émotions. Elle écoute tous ses visiteurs, entretient son petit
potager, change l'eau des fleurs et se rappelle son passé : sa rencontre avec
Philippe Toussaint, devenu garde-barrière à ses côtés, son mariage, la
naissance de sa petite Léonine, son soleil dans une vie difficile avec un mari
inconsistant et infidèle...
Née sous X, Violette est passée de
famille d'accueil en famille d'accueil. Elle pense trouver un point d'ancrage
quand elle rencontre le très beau et convoité Philippe Toussaint. Mais Philippe
Toussaint ne cesse d'aller "faire un tour" et néglige sa jeune femme,
qui reporte son affection sur sa petite fille. Elle aurait de quoi être amère,
Violette, mais elle est au contraire d'une profonde humanité, malgré une vie
bien dure. La rencontre avec Sacha, dont elle va prendre le poste au cimetière
de Brancion-en-Châlon, est décisive et l'ancre dans une identité qu'elle ne
quittera plus et lui donnera la force de continuer. Autour de ce personnage que
j'ai envie de qualifier de résilient, qui aime tant l'odeur des roses, adopte
chats errants et animaux orphelins après la mort de leur maître, et tient un
registre détaillé des obsèques de chacun, gravite une galerie de portraits
attachants – je pense notamment à Gaston, si maladroit qu'l lui est arrivé de
tomber dans la fosse qu'il venait de creuser, ou évidemment à ce Julien Seul
qui débarque un jour pour réaliser les dernières volontés de sa mère, qui a
demandé à ce que ses cendres soient déposées sur la tombe de son amant – et se
construit une histoire en patchwork dont l'unité se fait progressivement, avec
même une touche de roman noir. C'est très réussi, et, ce qui ne gâche rien,
écrit dans une langue fluide et élégante. On donnerait cher pour rendre visite
à ses morts veillés par une telle gardienne.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ deuil / cimetière / amitié /
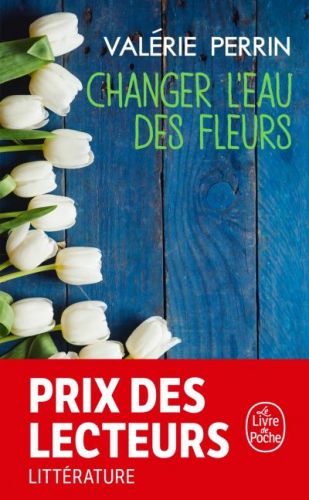
Posté le 12/02/2021 à 10:56
Jacques et Lucie se rencontrent dans les
années 60. Ils sont jeunes et beaux, cultivés, avides de voyages et de
découvertes. Ils s'installent à Paris, se marient, puis ont une petite fille,
Constance. Mais Jacques n'est pas heureux depuis longtemps, avant même
l'arrivée de sa fille. Vivre à Paris lui permet de comprendre, puis d'accepter
le fait qu'il aime les hommes. Il se décide enfin à vivre comme il l'entend, quitte
Lucie et rencontre Ivan, avec lequel il va vivre durant de longues années. Le
temps passe, la petite fille grandit et devient une femme. Les années 80 voient
l'apparition du sida, qu'on appelait encore à l'époque le "cancer des
homosexuels". Jacques n'échappe pas à la contamination et décède quelques
années plus tard. Devenue cinquantenaire, l'auteur rend hommage, dans ce roman
autobiographique, à un père parti trop tôt, elle raconte le manque et le deuil,
la maladie et le chagrin.
Constance est toute jeune encore quand ses
parents se séparent. Elle prend les choses comme elles viennent, sans porter de
jugement ni de rancune envers son père alors même qu'elle voit sa mère plonger
dans une profonde dépression ; elle s'attache au compagnon de son père avec un
naturel assez déconcertant – il faut dire aussi qu'on ne lui explique pas
grand-chose de la situation. Mais à l'adolescence, il est compliqué d'avouer à
ses amis que son père est homosexuel, en témoigne la scène où c'est Ivan et non
son géniteur qui vient la chercher à la fin d'une soirée, déclenchant chez la
jeune fille une gêne dont elle va peiner à se remettre. Constance ne craint pas
de l'avouer : si elle a accepté l'homosexualité de son père dans l'intimité
avec une facilité apparente, c'est socialement plus difficile. Est-ce pour
cette raison qu'elle fait preuve d'une sorte d'égoïsme quand elle s'occupe de
son père malade et affaibli ? Elle raconte sans fard sa peur de la
contamination, son refus d'évoquer la mort prochaine, son besoin parfois de
s'éloigner de lui, son agacement quelquefois, et son regret d'avoir choisi sa
jeunesse plutôt que de profiter des derniers moments. Malgré tout, une profonde
tendresse émaille tout ce récit à la fois pudique et pourtant si intime, comme
pour donner aux choses la possibilité d'être encore : "J'écris pour ne pas
tourner la page. J'écris pour inverser le cours du temps. J'écris pour ne pas
te perdre pour toujours. J'écris pour rester ton enfant."
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
homosexualité
/ famille / père / maladie / mort / deuil / hommage /
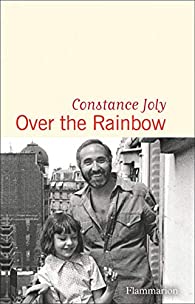
Posté le 01/02/2021 à 17:57
Un pianiste joue du
Beethoven sur les pianos publics des halls de gare ou d'aéroport. Il joue divinement,
dans l'indifférence des voyageurs. Que fait-il là et pourquoi ce concertiste
gâche-t-il ainsi son talent ?, finit par lui demander un voyageur plus attentif
que les autres. C'est alors que Joseph entreprend de raconter son histoire. A
15 ans, le voilà orphelin, et placé dans l'orphelinat des Confins, installé
dans un ancien prieuré dans les Pyrénées... Il y a rencontré ceux qui sont
devenus ses amis, la Fouine, Edison, Sinatra et Souzix. Et puis Rose. Cinquante
ans après, s'il joue ainsi, dans l'indifférence des gens de passage, c'est pour
elle…
Qu'il
est horrible, cet orphelinat des Confins ! Y règnent la maltraitance, la
malnutrition, le froid, et la cruauté de l'abbé Sénac qui n'a d'égale que la
violence de son sbire, la Grenouille, lequel inflige aux malheureux garçons
atteints d'énurésie la "cape de pisse", une punition qui oblige le
coupable à faire le tour de la cour vêtu de ses draps souillés. Par réaction
sans doute, on se serre les coudes, même si l'amitié n'est pas accordée
d'office. Joseph parvient à se faire accepter avec son camarade Momo dans la
société secrète de la Vigie, où ces garçons endurcis trouvent le moyen parfois
d'aider les plus faibles, de faire rêver Souzix, le plus jeune, ou de protéger
Momo, victime de graves crises d'épilepsie. Les pires épreuves donnent ainsi naissance
à de formidables élans de fraternité – de rivalité aussi. Pour le coup, la
présence de Rose serait presque secondaire, d'autant plus qu'elle est avortée
sitôt commencée. Joseph cependant se montre d'une fidélité inébranlable envers
sa seule aimée grâce à laquelle il a trouvé le rythme, ce rythme profond dont
lui parlait M. Rothenberg, son vieux professeur de musique, irascible et exigeant,
sans lequel Joseph n'aurait pas eu ce talent. Peu lui chaud, à Joseph enfin
libre et devenu adulte, d'écumer les salles de concert et d'être applaudi ; il
joue parce qu'enfin il a trouvé le rythme, cette magie dont Rothenberg lui
avait parlé et que Rose avait entendue ; il joue pour qu'elle l'entende encore
une fois, au hasard de l'arrivée d'un train ou d'un avion.
La
plume de Jean-Baptiste Andréa, toujours si élégante et juste, fait surgir de
multiples images, - on les voit, ces six garçons sous la voûte du ciel, à
écouter la voix de Marie-Ange Roig dans Carrefour
de nuit sur Sud Radio, on le voit, Joseph courbé sur la machine à écrire à
taper les phrases de Sénac plutôt que des notes sur un clavier - ; elle fait
surgir des rires et des larmes, avec la même justesse et la même force que dans
Cent millions d'années et un jour. On
en redemande.
Catégorie
: Littérature française
orphelin
/ famille / enfance / maltraitance / amitié / amour / musique /
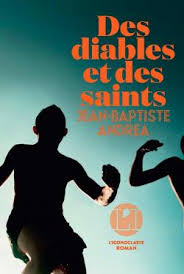
Posté le 01/02/2021 à 17:55
Michel H. s'est fait larguer
abruptement. En guise de cadeau de départ, Bérénice lui laisse un tas de livres
sur le développement personnel et la quête du bonheur, et un ouvrage sur la
mycose de l'ongle. Qu'à cela ne tienne, Michel est prêt à tout pour retrouver
l'être aimé, à mettre en pratique les conseils dispensés par ces ouvrages, devenir
végan sans gluten, pratiquer le feng-shui et jeter toutes ses affaires, attraper
une mycose à l'ongle, faire appel à un marabout, tandis que son voisin de
palier ne cesse de lui faire remarquer qu'il déroge au règlement de copropriété
et que celui du dessous continue à lui casser les oreilles avec sa musique…
Michel H. est un admirateur de Michel
Houellebeq dont il porte presque le même nom. Il est aussi hypocondriaque,
profondément dépressif, maniaque, paranoïaque, obsessionnel compulsif, et se
languit d'amour pour une femme qu'il a côtoyée pendant à peine trois semaines et
qui ne semble guère, c'est le moins que l'on puisse dire, lui vouer les mêmes
sentiments. Mais notre (anti)héros est persuadé que Bérénice, dûment
maraboutée, va revenir d'ici quelques heures sur le pas de sa porte. Voilà toute
l'histoire de ce nouveau roman de J.M. Erre, émaillée de gags loufoques et de
situations où l'absurde se mêle au pathétique. Pour un peu on le prendrait en
pitié, ce Michel parfaitement inadapté au monde, au point d'en devenir
caricatural. Ce pourrait être drôle, mais l'humour tombe un peu à plat alors
que se succèdent les échecs du protagoniste pour accéder au bonheur dans un
comique de répétition un peu longuet. Certes, il y a la langue subtile et
précise de J.M. Erre, son talent pour convoquer de multiples références,
littéraires ou non, et de s'en amuser, mais je n'ai pas retrouvé le plaisir de
lecture que j'avais eu à lire Qui a tué
l'homme homard ?, qui était, lui, particulièrement réussi, dans les
situations et dans les personnages parfaitement campés et d'une drôlerie irrésistible.
Catégorie
: Littérature française
rupture
/ solitude / dépression / quête du bonheur / fantasme /
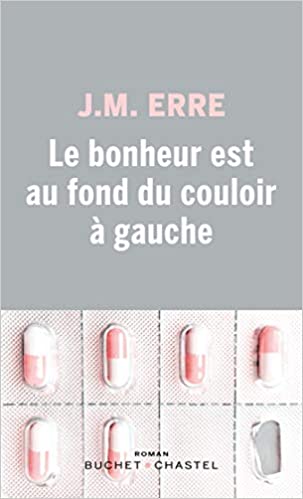
Posté le 22/01/2021 à 15:28
Une petite ville de Lorraine. Le père,
technicien à la SNCF, est un socialiste convaincu, qui continue de retrouver régulièrement
ses camarades de la section, même si la foi a déserté les rangs. Il élève seul
ses deux enfants depuis la mort de la môman : l'aîné, Fus, a préféré le foot à
des études assez médiocres, tandis Gillou nourrit de plus grandes espérances.
Les enfants grandissent, Fus se met à fréquenter des gars de l'extrême-droite,
tandis que Gillou se prépare à des études à Sciences Po. Le père et le fils ne
se parlent plus qu'à peine, tandis que le benjamin part étudier à Paris…
Une vie modeste, simple, des copains,
le bistrot, le foot du dimanche. Et les enfants qu'on élève seul, en faisant
comme on peut, qui s'éloignent. Le deuxième, par la force des choses, l'éducation
nécessaire, l'ascenseur social peut-être. Mais pour le premier, c'est plus
compliqué. Les engagements politiques et idéologiques qui vont séparer le père
du fils sont tels que, forcément, vient un moment où l'on ne peut plus accepter
tout ça, quand la ligne rouge est franchie. A travers ce récit, tout en finesse
et sensibilité, qui sonne comme une confession que ferait un type entre deux
âges au coin d'un zinc à un auditeur qui serait nous, lecteur, sans s'épancher,
sans auto apitoiement ni complaisance, se pose la question de l'amour entre un
parent et son enfant : est-il, doit-il être aussi inconditionnel qu'on le croit
? A-t-on le droit de ne plus aimer son enfant ? De se sentir trahi ? A-t-on le
droit de mépriser son père ? Et malgré tout, si l'important était d'aimer quand
même, même trop, même mal ?
Catégorie
: Littérature française
Lorraine
/ famille / extrême-droite / relation parent-enfant /
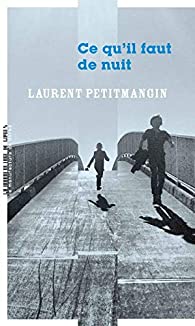
Posté le 22/01/2021 à 15:26
Clémence, 30 ans, est parvenue à rompre
avec son compagnon avec lequel elle a connu trois ans d'une relation toxique.
Elle vient de s'installer dans une petite maison où elle vit recluse, et n'a
pour seules relations sociales que son travail à la boulangerie. Elle essaie de
se défaire de sa peur de l'obscurité en allant explorer son jardin minuscule,
et espère guérir, comme l'un des cinq poissons rouges du bassin, mutilé mais
bien vivant. Mais combien il est difficile de se défaire de l'emprise que
Thomas a exercée sur elle, et combien elle peine à retrouver force et confiance
en elle, pour n'avoir plus peur de le voir surgir et la reprendre dans ses rets…
Clémence lutte contre elle-même, contre
ses doutes, contre ses angoisses. Son combat est celui d'une droguée en manque
: parfaitement lucide sur la dangerosité de ce qu'elle a vécu et sur la malfaisance
de son ancien compagnon, elle n'en est pas encore tout à fait guérie. Alors
qu'elle essaie de s'installer dans sa nouvelle vie, de se reconstruire, elle se
rappelle par bribes ce que Thomas lui a fait subir. Thomas, c'est l'homme
séduisant, affable, intelligent, qui est devenu, dans l'intimité du couple, un
véritable monstre. Qui lui a fait connaitre l'enfer, en témoignent les scènes
de course poursuite dans les bois, jusqu'à la punition épouvantable, extrême –
Clémence manque de mourir par la faute de Thomas, et c'est dans ses bras
qu'elle se jette lorsqu'il la sauve du piège dans lequel il l'a précipitée.
C'est cette scène-là qui raconte à mon sens parfaitement les mécanismes à l'œuvre
dans une relation avec un partenaire que l'on nomme, peut-être abusivement
parfois, un pervers narcissique. Du "PN", Thomas en a tous les
traits, y compris celui d'avoir tellement manipulé sa victime qu'elle aime
encore son bourreau. Clémence a eu le courage de partir, mais il lui faudra du
temps, et l'aide de tiers, pour parvenir à se défaire tout à fait de l'emprise.
Avec, au final, un dénouement qu'on ne peut s'empêcher de trouver jouissif.
Dans une langue parfois crue, souvent
travaillée, où elle use des tirets pour évoquer l'indicible, pour dire ce que
Clémence soudain réalise, Sandrine Collette nous offre là un récit bien
différent de ses romans habituels où la nature avait une grande place, même
abimée – je pense notamment à son avant-dernier opus, Et
toujours les forêts - ; cette fois la nature est une forêt hostile, et ce
récit davantage tourné vers des paysages intérieurs que son héroïne va devoir
reconquérir, comme elle parvient tout doucement à conquérir son petit jardin et
ses habitants.
Catégorie
: Littérature française
couple
/ pervers / manipulation / rupture / vengeance /

Posté le 18/01/2021 à 17:28
Rose, bientôt 50 ans, a pris l'habitude
après le travail de passer au Royal, un bar où elle boit et retrouve parfois sa
grande copine Marie-Jeanne qui coupe les cheveux des clients à la demande. Un
soir débarque Luc et son chien blessé, que Rose doit achever avec son revolver
qui ne la quitte jamais. Luc et Rose se revoient, malgré la méfiance que
nourrit cette dernière envers les hommes, qui l'ont déjà fait suffisamment
souffrir.
Rose a vieilli, mais elle a pour atout ses
très belles jambes, qui lui ont permis de temps en temps d'avoir des aventures.
Mais désormais c'est anecdotique, elle s'est installée dans une vie solitaire
et tranquille, sans trop de surprises. Voilà que Luc, un taiseux rassurant, vient
remettre en cause les convictions qu'elle a lentement étayées au fil des
années, et son équilibre. Rose ne se méfie plus assez, et la voilà à la merci
d'un homme… tout ce qu'elle s'était promis de ne pas faire. Dans cette longue
nouvelle, l'auteur, lauréat rappelons-le du prix Goncourt pour Leurs enfants après eux en 2018, campe
parfaitement bien une femme entre deux âges, que la vie a amenée à cultiver
l'indépendance comme une seconde nature, et qui pensait ne plus tomber
amoureuse. Dans sa concision, le récit sonne très juste, à l'exception de son
final très abrupt et auquel à mon sens il manque quelque chose qui le prépare.
Catégorie
: Littérature française
solitude
/ femme / liberté / indépendance / couple /
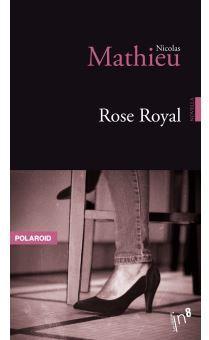
Posté le 11/01/2021 à 17:58
Axel, marié et père de deux enfants,
reçoit un jour une lettre bleu grisâtre pour le dépistage du cancer colorectal.
Las, ce dispositif concerne les hommes de 50 ans et plus, et Axel n'en a que
46. C'est le début pour lui d'une lassitude et d'une angoisse progressives, qui
lui donnent envie de tout plaquer, et de partir à Buenos Aires, où il jouerait
de la guitare et boirait des bières avec Benjamin Biolay, loin de toutes ses
préoccupations, des apéritifs trimestriels avec le couple de voisins maniaques,
des vacances à Biarritz pour faire du paddle, du sermon à tenir à son fils Tristan
à cause de son dessin obscène, des cierges à faire brûler que pour le petit copain
de sa fille Jade la re aime. Mais n'est pas crooner qui veut, et Axel
s'interroge sur son potentiel de séduction quand il prend pour la troisième
fois rendez-vous avec la professeur d'anglais de Tristan et culpabilise d'avoir
prié pour que la rivale de Jade devienne borgne. Un simple courrier
administratif dû à une erreur de logiciel, et c'est toute la vie d'un homme
ordinaire qui est remise en question. Un récit bourré d'humour qui n'exclut pas
la mélancolie – à ce titre je l'ai préféré à l'opus précédent, Le discours -, dans lequel on compatit
pour ce pauvre Axel qui se rêve à Broadway quand il doit acheter des pizzas
pour l'apéro des voisins.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ rêve / insatisfaction / angoisse /
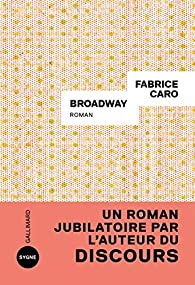
Posté le 04/01/2021 à 17:21
Adrien est chargé lors d'un diner
familial de rédiger le discours du mariage de sa sœur. Il passe la soirée à se
demander ce qu'il va bien pouvoir écrire tandis qu'il attend désespérément que
Sonia, qui l'a quitté 36 jours plus tôt, prétextant avoir besoin d'une pause, daigne
répondre à ses SMS. Entre sa sœur qui lui offre comme chaque année une
encyclopédie, sa mère qui répond à tout son mal être en lui conseillant de
boire du jus d'orange, et son père et son futur beau-frère qui discutent des
avantages du chauffage au sol, Adrien fait le tour de ses mésaventures
affectives et dresse le portrait d'un quarantenaire perdu et déprimé, qui sous
une apparente nonchalance se pose maintes questions et peine à trouver sens à
son existence.
L'auteur de BD Fabcaro met son humour au
service d'une fable désenchantée et grinçante qui dénonce avec finesse,
férocité aussi, les compromis auxquels la famille et l'amour nous plient.
Catégorie
: Littérature française
rupture
/ famille / solitude / désenchantement /
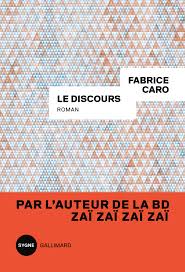
Posté le 04/01/2021 à 17:19
Mars 2021, vol AF006 Paris-New York. Le
Boeing 787 s'apprête à entamer sa descente quand il retrouve pris dans de très
fortes turbulences. Quand l'avion sort de la tempête et se signale auprès des
autorités, les contrôleurs sont stupéfaits : cet avion a atterri sans encombre
avec ses passagers et son équipage, mais 106 jours plus tôt. Nous sommes le 24
juin, et voilà qu'un double parfaitement exact a surgi du néant… Les autorités
américaine s'empressent de dissimuler le fait et tentent par tous les moyens de
comprendre cette anomalie.
L'espace s'est-il replié sur lui-même pour
donner naissance à un clone de l'avion ? Ne serions-nous finalement que les
parties d'un gigantesque programme informatique qui présenterait un bug ? Les
théories les plus folles sont émises pour expliquer l'inexplicable – à noter
d'ailleurs le tandem drôlissime des mathématiciens inventeurs du protocole 42
destiné à prendre en main cet événement inédit. En attendant, et à défaut de
trouver une raison, il va falloir gérer
ces doubles humains, puisque chaque passager du mois de juin a son double,
arrivé à l'aéroport de JFK au mois de mars. Le tueur à gages, l'écrivain dépressif,
l'architecte largué, le musicien nigérien, l'avocate aux crocs acérés, ou
encore la petite fille à la grenouille, c'est le sort de chacun d'entre eux qui
fait tout le sel de la deuxième partie du récit. Evidemment, les personnages
n'ont pas été choisis au hasard, et la vie de chacun d'entre eux pourrait être
le sujet d'un roman. En tout cas, ce récit inclassable, qui touche à
l'anticipation, à l'espionnage, au roman d'amour et au polar, bourré d'humour, est
tout simplement génial. Avec le prix décerné à Jean-Paul Dubois il y a deux
ans, le Goncourt redeviendrait-il une référence ?
Catégorie
: Littérature française
avion
/ tempête / clone /
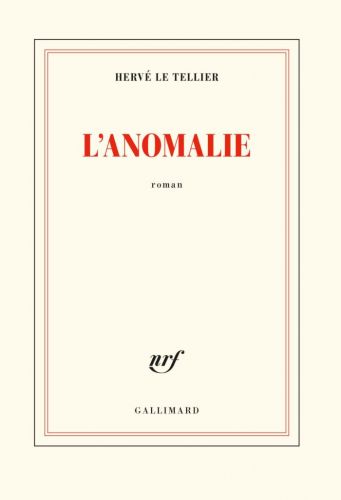
Posté le 27/12/2020 à 18:39
Un homme quitte sa région d'origine
avec ses enfants pour partir vers une ville de l'Est, espérant s'y construire
une nouvelle vie. Il fuit, Thésée, il fuit la mort de ses parents, et surtout
celle de son frère, qui s'est pendu à une conduite de gaz. Mais il n'est pas
entièrement libéré : il a pris avec lui des cartons d'archives qu'il répugne à
ouvrir. Ceux-ci contiennent l'histoire de son arrière-grand-père. Dans ce deuil
qu'il n'arrive pas à faire, et dans la peur qui le hante au point de le rendre
littéralement malade, Thésée est hanté par une interrogation maîtresse : "Qui
commet le meurtre de celui qui se tue ?". A laquelle s'ajoute une deuxième
question, alors qu'il a commencé d'ouvrir les cartons et de se plonger dans la
mythologie familiale : " Celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire
?". Il exhume alors la lignée des hommes qui meurent, l'arrière-grand-père
suicidé d'une balle en 1939, son frère mort très jeune d'une maladie sans nom,
ces morts qu'il met en lien avec celle de son propre frère ; il raconte les
photos, nombreuses, et retranscrit les pages du cahier de l'arrière-grand-père,
en une lente exploration et une réflexion profonde et douloureuse sur le poids
d'un héritage qu'on connaît mal et qui nous hante.
C'est un roman déconcertant que
celui-là, écrit sans majuscule en début de phrase ni point à leur fin, constitué
de réflexions, de poèmes, d'extraits d'un journal intime ; curieux objet
narratif dans lequel le narrateur s'adresse tantôt à ses parents, tantôt à son
frère, et passe de la première à la troisième personne. Comme si son identité fluctuait
au fur et à mesure de la découverte de ce passé resurgi. Que doit raconter
celui qui a survécu ? Que doit-il comprendre de ces parallèles – qu'il appelle
des synchronies – qui se dessinent devant lui, des dates qui mettent en regard
des événements, des morts ou des naissances par exemple ? Ces signes, qui
prouvent qu'on fait bien partie d'une lignée, quitte à ce qu'elle soit de
celles des hommes qui meurent, et qu'on n'y échappe pas, même en partant loin à
l'Est. La nouvelle vie de Thésée, c'est sans doute de faire avec le poids du
passé familial, de parvenir à conjurer sa peur pour ne pas, finalement, oublier
de continuer à vivre.
Catégorie
: Littérature française
deuil
/ famille / transmission /
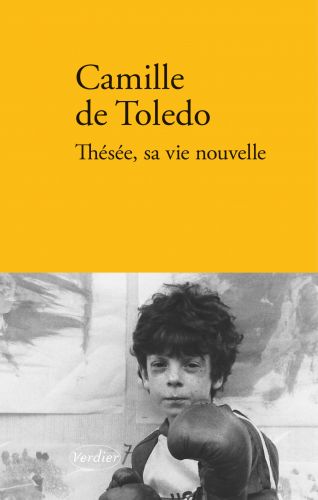
Posté le 10/12/2020 à 17:11
Dijon, 1977. Le narrateur, lycéen bien
comme il faut, raie sur le côté, lunettes et boutons d'acné, tombe en amour
pour une jeune femme aux cheveux verts et aux épingles à nourrice, qui hélas ne
s'intéresse guère à lui. N'importe, il est opiniâtre et prêt à tout pour la
remettre dans le droit chemin et qu'elle lui accorde son attention, y compris à
aller pogoter à un concert des Béru ou l'accompagner fidèlement dans des rades
dijonnais dont il n'avait jusqu'alors jamais soupçonné l'existence. La
persévérance s'avère payante puisque la punkette finit par lui proposer une
colocation pendant leurs études, de lettres pour qu'elle mène brillamment tout
en écrivant un roman, et de droit pour lui, qui finit tout de même par
abandonner le groupe des Jeunes Libéraux dont il faisait partie depuis des
années. Le couple tient bon, malgré des absences de plus en plus fréquentes de
la jeune femme qui se rend régulièrement à Paris où elle travaille pour un
éditeur. Il faudra bien que j'en parle, répète le narrateur dont on sent qu'il
veut encore rester dans la chaleur de ces quelques années partagées, il faudra
bien que j'en parle répète-t-il tout en continuant d'évoquer ses souvenirs, non
sans humour et tendresse. Il faut bien qu'il en parle et quand il se décide, le
récit bascule alors dans une toute autre ambiance. Adieu concerts et musique
punk, plats maison et séances érotiques, ne restent plus que la surprise, le
choc, le chagrin et la perte de tous les repères. Qui était-elle ? Qu'était-il
pour elle ? L'a-t-elle vraiment aimé ou manipulé ? Connait-on vraiment la
personne qu'on aime ? Les questions restent sans réponse dans une deuxième
partie sombre, bien loin de l'insouciance et de la drôlerie des débuts, et le
portrait d'une génération qui aimait Sid Vicious et David Lynch, vivait sans
portable et avait fêté la victoire de Mitterrand contre VGE. C'est là un des
points forts de ce roman, outre sa qualité littéraire indéniable : ce contraste
entre des deux périodes, l'avant et l'après, et la question du droit à
continuer à vivre, ensuite, quitte à se sentir un peu lâche, "accepter de
continuer en se rendant compte que finalement, ce n'est pas si insurmontable, que
nul n'est irremplaçable.". Un excellent roman offert par Manue Rêva, mon
binôme des 68 premières fois, que je remercie vivement pour cette découverte.
Catégorie :
Littérature française
punk / amour /
couple / deuil /
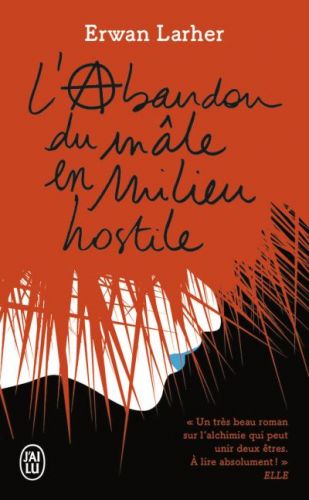
Posté le 30/11/2020 à 11:39
Aux Trois Filles Seules, hameau de La
Bassée, vit la famille Bergogne : Patrice, agriculteur, sa femme Marion et leur
fille Ida, ainsi que Christine leur voisine, artiste peintre. On s'apprête à
fêter les 40 ans de Marion. Tout le monde est mis à contribution : Ida a fait
des dessins, conseillée par Christine qui s'attelle aux gâteaux, tandis que
Patrice s'est chargé de la décoration et de la préparation du repas. Mais
d'étranges individus s'invitent à la fête et menacent tout le monde…
Malaise et non-dits règnent dans le
hameau. On sent chez Christine une réelle hostilité envers Marion, et si elle
lui cuisine trois gâteaux, c'est moins en son honneur que pour faire plaisir à
la petite Ida qu'elle adore. Et puis il y a ce couple un peu bancal, rencontré
via les réseaux sociaux, mal assorti, Patrice qui se trouve gros et se demande
ce qui a pu décider la belle et séduisante Marion à accepter de l'épouser,
Patrice qui voudrait lui dire sa tendresse mais doit taire son désir pour le
satisfaire de temps à autre dans des relations tarifées. Quant à Marion, elle
reste insaisissable et mystérieuse, comme venue de nulle part avec le secret de
sa vie d'avant. Arrivent alors les frères, Christophe, puis Bègue, et enfin
Denis. Se met en place un huis clos étouffant dans un coin perdu de campagne où
personne n'arrive par hasard, dans une tension qui va crescendo, à mesure des
longues phrases de Laurent Mauvinier qu'on serait tenté de lire d'une traite,
comme en apnée, avant d'arriver au point pour pouvoir reprendre son souffle. Il
faut prendre le temps et laisser faire pour s'habituer à ces phrases qui
semblent suivre le cours de la pensée de chacun des sept personnages et nous
faire connaître leurs désirs contrariés, leurs traumatismes et leurs
ressentiments. Ces 635 pages et les méandres de leurs mots racontent quelques
heures d'une tension grandissante, savamment orchestrée, jusqu'à un dénouement
tragique et implacable.
Catégorie :
Littérature française
campagne / huis
clos / famille / vengeance /
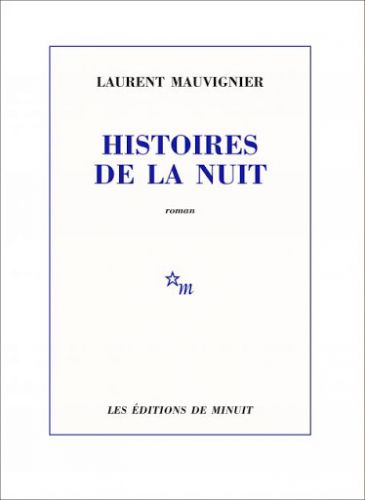
Posté le 30/11/2020 à 11:38
Jérôme, ingénieur agronome, a tout plaqué pour se lancer dans
l'agriculture bio. Mais c'est difficile, les dettes s'accumulent comme le
nombre de travaux à faire et de tâches à effectuer chaque jour. Et voilà que
Marion, sa femme, est victime d'un accident qui l'empêche de seconder Jérôme.
Solène, bientôt 15 ans, doit pallier l'invalidité de sa mère, sans aucun
enthousiasme. Elle déteste les travaux de la ferme et ne pense qu'à Baptiste,
avec qui elle commence à sortir. Et voilà que son père recrute un jeune woofer
qui va venir aider pendant quelques semaines…
Ce roman donne voix à Solène évidemment, qui exprime ses désirs,
ses colères et toutes les contradictions de l'adolescence. Mais il laisse aussi
parler Jérôme qui, submergé par ses propres soucis, en oublie d'aimer sa fille
et lui crie dessus toute la journée, quitte à s'en vouloir ensuite, à Marion,
qui fait souvent office de médiateur entre son mari et sa fille, et s'efforce
de supporter vaillamment le climat de tension et de ne pas sombrer dans le
découragement. Le monde du vivant, c'est celui de la vie : celle des néo-ruraux
dont les rêves d'une agriculture raisonnée et biologique se heurtent à la cruauté
de la réalité, via les discours écologiques de Jérôme et de Théo le woofer.
Celle de Solène qui éprouve les premiers émois amoureux et le désir dont elle
ne sait pas toujours trop quoi faire. Florent Marchet excelle dans la
description du désir adolescent : à 14 ou 15 ans, on est partagé la fascination
et le dégoût, on veut et on ne veut pas tout à la fois. Solène fait l'amour
avec Baptiste parce qu'il lui a demandé, par curiosité, et parce qu'il faut
bien se décider un jour. Elle n'en attend rien, n'a pas fantasmé là-dessus.
"Une forte appréhension se mêle à une envie de transgresser. Il y a le
mystère aussi, l'envie d'arracher l'écorce, de grandir d'un seul coup. Il faut
bien en passer par là […]." Et évidemment c'est raté. Et puis il y a son
attirance pour Théo, lequel finit par faire paraître bien fades les provocations
de Baptiste. Enfin c'est la vie de la terre, cette campagne dont Jérôme
regrette qu'elle ne soit pas davantage respectée, et que sa fille, malgré toute
son agressivité envers son père, aime aussi : "Quelques gouttes de pluie
tombaient mollement, libérant cette odeur de terre, de pétrichor qui se combine
avec l'ozone. Elle a appris ça en sciences nat. C'est la même odeur, partout
dans le monde, dès qu'une goutte de pluie tombe sur un sol sec." Se dit
Solène lorsque tombe l'averse d'été. Lire ces lignes et découvrir le pétrichor,
se rappeler cette odeur si particulière et volatile de terre mouillée, synonyme
d'une fraîcheur bienvenue après la chaleur c'est se souvenir des beaux jours en
cette automne morose et se dire qu'un jour, bientôt, tout ira mieux.
Catégorie :
Littérature française
campagne / bio /
famille / désir / jalousie /
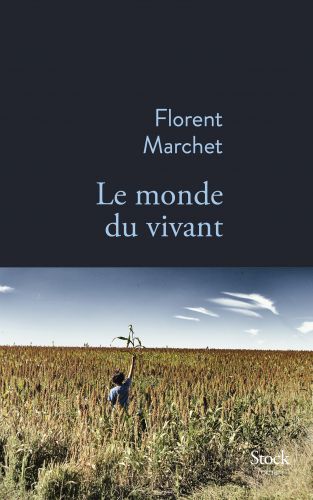
Posté le 30/11/2020 à 11:36
Une ferme du Lot, dans les années 80, où
vit la famille Fabrier. Agriculteurs depuis trois générations. A 15 ans, Alexandre
est le seul de la fratrie à envisager de prendre la succession des parents :
tout repose sur ses épaules, puisqu'aucune de ses trois sœurs n'a envie de
continuer à vivre à la ferme, dans un quotidien rythmé par les travaux
agricoles et le JT du 20 heures ou les sorties du samedi au Mammouth. Alexandre
suit des cours au lycée agricole, son avenir est tout tracé, ce qui lui importe
surtout c'est de passer son permis et de pouvoir emprunter la voiture
paternelle pour aller raccompagner sa sœur aînée, étudiante à Toulouse, pour
revoir Constanze, sa colocataire. Au cours d'une soirée, il fait la
connaissance d'activistes anti nucléaires, et découvre un engagement et un
combat qu'il n'aurait jamais soupçonnés…
Serge Joncour dépeint avec justesse le
milieu rural de ces années 80, et l'évolution des modes de vie et de travail. Les
présidents se succèdent, le téléphone met des mois à arriver pour prendre place
dans le couloir des maisons, on continue d'utiliser engrais et pesticides,
l'heure est à la production de masse. Agrandir, produire sont devenus les
maîtres mots de l'agriculture moderne, tandis qu'on envisage de faire passer
une autoroute tout près des terres de la famille. Il y a d'abord chez Alexandre
une forme de résignation face à tout ce qui arrive, puis une lente prise de
conscience de ce qu'il pourrait refuser. Comme une sorte d'affranchissement qui
se fait petit-à-petit. Mais au-delà du parcours initiatique du protagoniste,
c'est un portrait de la France qui nous est présenté, avec ses manifestations
anti nucléaires, la transformation des paysages et la multiplication des
hypermarchés et des ronds-points, l'élection de Mitterrand qui avait soulevé
tant d'enthousiasme, la lutte acharnée du monde agricole pour survivre, à coups
de subventions, les débuts de la mondialisation… Mon seul regret, les fautes
d'orthographe trouvées dans le roman, "laisser le moteur allumer", ou
" Il n'avait pas vue Constanze", un peu décevantes de la part d'un écrivain
chevronné comme Serge Joncour, auteur d'un roman couronné par le Fémina, et publié
par une grande maison d'édition qui doit bien avoir les moyens de faire appel à
des relecteurs…
Catégorie
: Littérature française
campagne
/ France / années 80 / militantisme / agriculture /
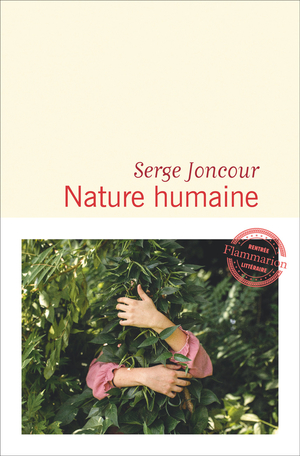
Posté le 13/11/2020 à 10:09
Tom Cianco, chanteur-auteur-compositeur un
peu paumé, revient dans la maison familiale d'un petit village perdu. Cet
hiver-là, il y fait la connaissance de Marie, apicultrice, qui conduit l'hiver
un chasse-neige. C'est l'amour fou, le vrai, la symbiose parfaite, qui inspire
Tom et lui fait composer onze chansons, lesquelles vont donner naissance à un
album, sous l'égide d'un producteur qui va le propulser vers le succès. Tout
irait bien si Tom n'était pas rattrapé par ses démons : hypersensible, il
s'avère d'une jalousie dévorante et devient violent…
L'histoire de Tom serait banale si elle
n'incluait pas une galerie de personnages hauts en couleurs : la famille de Tom
d'abord, un père sanguin et violent qui fait voler quand il s'énerve tout ce
qui lui tombe sous la main, une mère douce et aimante qui p.rd ses m.ts suite à
u. AVC, un frère Antoine, cadre parisien au bord du burn-out, et Lucille, la
sœur ainée infirmière, qui vont tous se réunir à Peyrade. Et puis, Franck le
producteur aux dents gâtées comme des touches de piano, qui s'avère influent et
le propulse vers le succès, avec les trois musiciens du coin recrutés par Tom,
le guitariste anglais alcoolique, le batteur surdoué accro à la coke et le
bassiste autiste qui refuse qu'on l'appelle par son nom. N'oublions pas Igor,
le sculpteur chilien révolutionnaire, et évidemment Marie, la belle Marie, à la
fois plantureuse et solide, capable de réparer n'importe quel moteur ou de
porter à bout de bras des ruches pleines. Au milieu de tous, Tom, daltonien
mais capable de voir des couleurs imperceptibles au commun des mortels, des
couleurs qui caractérisent les personnes qui l'entourent ou leurs sentiments,
Tom, sa guitare et sa voix, qui compose des odes à l'amour et trouve des notes
à chaque bûche qu'il empile.
Fabrice Capizzano rend hommage à la nature
du Vercors dont il et originaire, aux abeilles qu'il a élevées ; il doit
probablement lui aussi jouer de la guitare et possède une grande culture
musicale. Il y a de l'inspiration dans ce récit, des passages touchants, malgré
certaines incohérences et certaines longueurs. Par ailleurs le roman a été mal
relu, et comporte encore des fautes d'orthographe assez inadmissibles, des
fautes d'accord ("une vie idéale qui n'aurait jamais existée"), des
confusions de conjugaison (il écrit systématiquement "fût" pour
"fut", "que je vois", etc…) et le style est sincère mais
parfois maladroit.
Catégorie
: Littérature française
musique
/ amour / famille / violence /
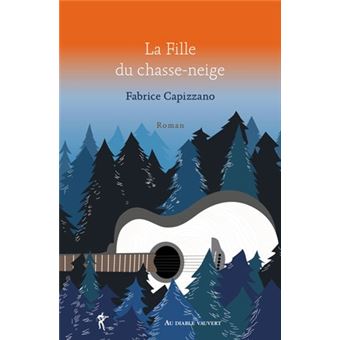
Posté le 30/10/2020 à 17:53
Charlie et sa mère sont dans la salle
d'attente d'un hôpital. Le père de Charlie est au bloc opératoire, où il subit
une lourde opération visant à le faire changer de sexe. En effet, Aurélien a décidé
de devenir Alice. Pendant ces quatre heures interminables, Charlie se rappelle
ces deux dernières années qui ont chamboulé sa famille.
Pas facile, à 14 ans, d'entendre son
père annoncer une telle nouvelle. Il faut accepter sans forcément comprendre,
il faut endurer les moqueries au collège, quand le père de Charlie se met à
sortir de la maison vêtu en femme, il faut faire avec ses sentiments de honte
et de rejet. Mais Charlie et Aurélien sont complices, unis par un attrait pour
la chimie et les phénomènes sismologiques. Face à un tel tremblement de terre,
c'est toute l'unité de la famille qui est menacée, et il faut tout l'amour
entre ses trois membres pour tenir, face à la double adversité de la
condamnation sociale et du long parcours semé d'épreuves qu'est un changement
de sexe. Charlie tient un journal de bord où il consigne tout : les
conséquences des prises d'hormones, les périodes d'enthousiasme et de
découragement, les rendez-vous médicaux, les chats des forums sur lesquels son
père passe ses soirées, ses propres interrogations. Il lui faudra parcourir un
long chemin pour passer du rejet à l'acceptation et au soutien. De la mère, il
est peu question au début : Charlie raconte bien quelques disputes, mais elle
paraît tout de même soutenir inconditionnellement son mari. Certes, l'histoire
est racontée par l'adolescent, qui ne peut avoir entière conscience des conséquences
pour le couple d'une telle décision, mais Charlie semble accorder peu de cas
finalement à sa mère, présente tout du long en filigrane, et c'est peut-être le
seul bémol à trouver dans ce récit bien mené, qui ne cache rien des difficultés
rencontrées aujourd'hui par les personnes transgenres, et par leur entourage.
Catégorie
: Littérature française
genre
/ changement de sexe / opération /
famille /
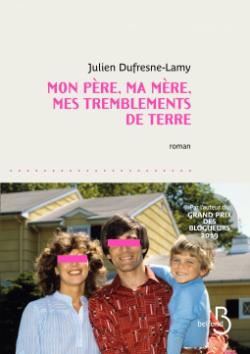
Posté le 30/10/2020 à 17:51
Ilarène, petite ville de Méditerranée,
2015-2016. Garance Sollogoub est élève de seconde, et prend des cours de danse
dans l'école de sa mère, ancienne danseuse étoile. Une très jolie jeune fille,
qui prépare la variation de Gamzatti avec sa meilleure amie Souad. Mais voilà
qu'elle se rapproche d'un groupe d'élèves de terminale, des amis d'un certain
Vincent Dagorn, dont elle est tombée amoureuse avant qu'il ne parte faire ses
études à Grenoble. Elle est peu-à-peu intronisée dans le groupe, et découvre
l'alcool, la drogue, la séduction et l'éveil à la sexualité, dans un climat où
l'amitié n'exclut pas une forme de rivalité et de compétition. Elle se met à
perdre pied, et un beau jour, elle disparaît.
Francesca Serra prend son temps. Elle
plante le décor – l'école de danse, la compétition entre les jeunes filles, la
beauté de Garance, l'univers des ados 2.0 et leurs échanges sur les réseaux
sociaux, leur cruauté et leurs enthousiasmes. Elle nous plonge dans l'univers
des millenials à qui confisquer le portable équivaut à une mise au trou, et
campe parfaitement différents personnages, entre les populaires qui fascinent
les plus jeunes, et les mal aimés, gros, ou bons élèves, qui se réfugient au
CDI. Les différentes parties du roman oscillent entre l'automne 2015 et l'été
2016, date de la disparition de Garance, et mettent en place, petit-à-petit,
toutes les pièces de puzzle. L'écriture de Francesca Serra compose elle aussi
une sorte de patchwork parfaitement réussi, entre les monologues intérieurs
d'adolescents, les échanges sur Instagram ou Whatsapp d'une justesse
confondante, et les passages narratifs. Elle a obtenu pour ce premier roman au
titre intrigant le prix littéraire "Le Monde", amplement mérité.
Catégorie : Littérature
française
adolescence / lycée /
réseaux sociaux / influence / harcèlement /
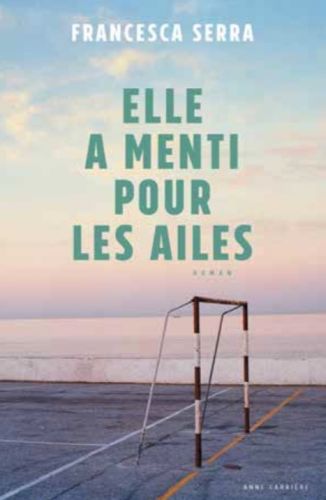
Posté le 30/10/2020 à 17:50
Années 80. Cléo est en quatrième et
rêve de devenir danseuse de modern jazz. Elle rencontre Cathy, qui la couvre de
cadeaux et lui propose de postuler pour une bourse financée par une mystérieuse
fondation nommée Galatée. Elle pourra réaliser son rêve et intégrer l'école
d'une compagnie. Mais la bourse tarde à venir. En attendant, Cléo participe à
un déjeuner avec des hommes plus âgés qu'elle, puis est chargée de repérer dans
son collège d'autres jeunes filles qui pourraient elles aussi concourir pour
obtenir la bourse. 25 ans plus tard, un appel à témoins est lancé pour
retrouver les victimes de la fondation. Devenue danseuse pour la télévision,
Cléo s'interroge sur son passé et sa part de responsabilité dans les méfaits
accomplis par Galatée.
Le récit est construit comme une sorte de
puzzle qui mêle les époques - celle de l'adolescence de Cléo, ses débuts comme
danseuse chez Drucker, sa vie de femme -, et les différentes personnes qu'elle
a côtoyées. On ne s'y perd pas, tandis que se découvre, au fur et à mesure, le
spectre de la pédophilie en cours dans les années 80, et qui laissait Matzneff
et consorts donner libre cours à leur attirance pour les adolescents sans qu'à
l'époque on n'en trouve grand-chose à redire ; s'y tissent aussi des réflexions
sur le pardon et le poids des souvenirs. Comment oublier, comment vivre avec le
remords d'avoir entraîné tant d'autres filles dans ce piège ? On découvre aussi
le milieu de la danse et de la variété, ses coulisses, les faux-cils, et sous les
plumes et les paillettes, les douleurs du corps et de l'âme, les salaires trop
bas, les conditions de travail difficiles, dissimulées sous un sourire factice.
Ce n'est sans doute pas un hasard si Lola Lafon a fait le lien entre les
pratiques occultes de la pédophilie des années 80 et les dégâts qu'elle a
causés chez leurs jeunes victimes, et la danse de cabaret : on sourit sous le
fard, malgré l'armature en métal qui corsète le dos, malgré les courbatures et la
fatigue, parce que c'est la loi du spectacle, the show must go on. Jusqu'à ce
qu'enfin la parole se libère.
Catégorie :
Littérature française
pédophilie / manipulation
/ consentement / danse / spectacle /
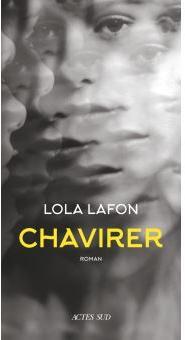
Posté le 30/10/2020 à 17:48
Pierre vient d'être condamné à quatre mois
de prison avec sursis pour violences conjugales. C'est l'occasion pour lui de
réfléchir à ce qui l'a conduit à devenir violent, et de replonger dans son
enfance. Issu d'une famille bourgeoise, catholique et versaillaise, il a grandi
dans une véritable sécheresse affective et a été élevé à la dure, suivant une
éducation qui n'excluait pas les coups et la violence...
La vie de Pierre nous est révélée en flash
back. Né dans un milieu favorisé, avec son petit polo et sa raie sur le côté,
il a tout pour être heureux. Mais derrière les tentures, bien à l'abri des murs
de la maison bourgeoise, se développe la maltraitance. Le plus effrayant ce
n'est pas les coups, c'est le comportement de la mère, qui contraint son fils à
rester à table plusieurs durant parce qu'il n'a pas terminé sa salade de
carottes, pour finir par lui mettre le nez dedans ; c'est une mère dure, implacable,
dont la violence des mots est insupportable. Commet se construire après ? Comment
éviter de reproduire à son tour la violence dont on a été victime ? Pierre
porte les séquelles de cette éducation, et semble incapable de contenir la
violence qu'on lui a inculquée. Est-il bourreau ou victime ? Le propos du roman
n'est pas de répondre à cette question, mais de donner voix à un auteur de
violences conjugales. Sans l'excuser, en exposant les faits.
Catégorie
: Littérature française
violence
/ famille / bourgeoisie /
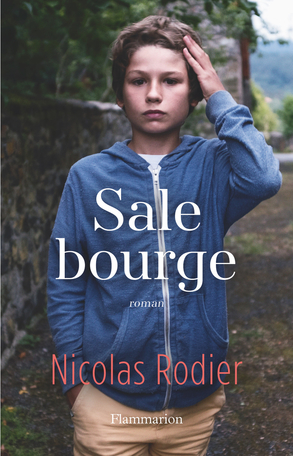
Posté le 30/10/2020 à 17:45
Elle est mariée à Vincent, et maman
d'une Esther de 8 ans. Arrive un nouveau bébé, Alban. Il a cinq mois quand sa
mère découvre une tache noire dans le cou du nourrisson. D'autres taches
suivent, de plus en plus nombreuses, qui se développent sur tout le corps. Puis
c'est la peau tout entière qui peu à peu s'assombrit, Elle le mesure en
comparant la pigmentation avec un nuancier de peinture. Le bébé est métis et va
révéler la couleur définitive de sa peau au cours des prochains mois. Comment
est-ce possible ? Elle ignore tout d'un possible ancêtre noir ! Face à
l'inconcevable, la mère en proie à une panique grandissante va lever le voile
sur un secret de famille qu'elle va avoir terriblement de mal à assumer.
Voilà que la mère aimante se met à
rejeter petit à petit son enfant pour lequel elle n'éprouve que du dégoût.
Professeure de lettres de formation, elle se réfère à Samsa, le cafard de
Kafka, auquel elle compare le nourrisson. Ne pourrait-elle pas l'écraser d'un
coup de balai ? A la fois lucide sur sa possible violence, et atterrée par ce
dont elle pourrait être capable envers son bébé, elle ne parvient tout de même
pas à s'empêcher de sombrer dans une sorte de folie, qui la conduit à cacher la
couleur de la peau de son enfant à tout le monde, y compris à sa fille, en
l'engonçant sous des couches de vêtements et de fond de teint. Certaines
scènes, qui relèvent d'une véritable maltraitance, font vraiment froid dans le
dos, mais comment blâmer cette mère qui a subi un double traumatisme dans son
enfance et qui se retrouve finalement bien seule pour affronter ce qu'elle vit
comme une véritable catastrophe ? Certes, tout cela fait beaucoup pour une
seule femme, mais ce récit aborde la question délicate de l'amour maternel dont
on commence à comprendre qu'il peut ne pas être aussi instinct et évident qu'on
le pensait.
Catégorie :
Littérature française
famille / maltraitance
/ secret / abandon /
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois
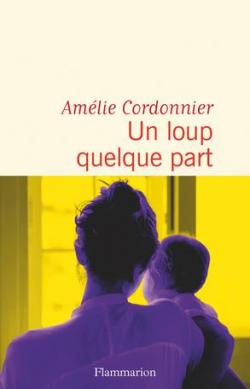
Posté le 12/10/2020 à 17:07
Marc, Mathieu, Mabel et Luc sont frères
et sœurs et se retrouvent fréquemment pour se suspendre par des cordes au
viaduc qui enjambe la vallée. Ils vivent dans une vallée reculée dont la
population vit sous le joug de Joyce, le propriétaire de la centrale
électrique, qui assure toute la vie économique de la communauté, mégalomane au
point d'avoir fait rebaptiser toutes les rues de la ville à son nom. Marc et
Mathieu travaillent pour lui, ainsi que leur père. Personne n'ose se révolter,
jusqu'au jour Mabel, chassée de la maison par sa mère, est convoitée par l'une
des brutes à la solde de Joyce…
Après un premier chapitre au ton
légendaire, le récit se met lentement en place, pour mêler progressivement tous
les ingrédients d'un drame à venir. On ne sait où se situe ce Gour Noir ni
quand se passe l'histoire. Comme si Franck Bouysse avait voulu ainsi donner une
portée universelle à un récit sombre, qui évoque de nombreux thèmes :
l'émancipation féminine, les rapports familiaux, les premières amours, la
toute-puissance du patronat… Ouvrir un nouveau roman de Franck Bouysse c'est
retrouver sa patte qui campe parfaitement bien une atmosphère rurale et des
personnages typiques : le tyran Joyce, qui a enfermé sa femme, les brutes qui l'entourent,
la mère des enfants confite dans une religion qui l'empêche d'aimer, le père à
qui un marin rencontré dans un bar va ouvrir les yeux… Cependant, le roman m'a
paru receler quelques écueils : malgré ses qualités indéniables et la plume si
juste de son auteur, il souffre de longueurs et son intrigue manque de
cohésion. Et puis, que tout est noir…
Catégorie :
Littérature française
campagne / famille /
ouvriers / patron / pouvoir / injustice /
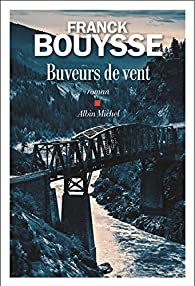
Posté le 12/10/2020 à 16:59
Dans une petite ville de grande banlieue, trop verte
pour être un "quartier" et trop goudronnée pour ressembler à la
campagne, Jonas, Poto, Ixe, Miskine, Untel, Habib et Lahuiss tuent le temps en
fumant de gros spliffs et en jouant aux cartes. Jonas se sent bien avec sa
bande de potes, même s'ils ne font pas grand-chose. Ce qu'il veut, lui, c'est
être tranquille, pouvoir s'entraîner à la boxe et préparer son prochain combat.
Et continuer de temps en temps à fréquenter Wanda.
Un portrait de tout jeunes adultes un
peu perdus, désœuvrés, qui cherchent un sens à une existence sans grande
ambition. Le choix d'une langue très orale et actuelle – tchek de l'épaule,
vas-y bien ou quoi, wesh gros on joue ou quoi ? – peut rebuter certains
lecteurs, mais ce récit qui sonne fort juste est très bien construit. Et ce
n'est pas parce que le récit est écrit dans l'argot des banlieues que l'auteur
n'a pas de références littéraires, en témoigne un passage désopilant où
Lahuiss, le seul à faire des études, entreprend de faire faire une dictée d'un
extrait de Voyage au bout de la nuit
à la bande. Un extrait : "Je lui demande s'il n'aurait pas l'extrait de
Voltaire dont il nous avait parlé la dernière fois, avec des histoires de
jardin et tout ça, mais il dit non, puis annonce qu'il va nous dicter trois
extraits d'un livre écrit par une femme qui s'appelle Céline je crois, enfin
c'est ce que j'ai cru comprendre parce que ce n'est pas facile de l'écouter
avec tous les autres qui demandent quel jour on est, pour mettre la date en
haut à gauche de la feuille, et ceux qui râlent parce que leur stylo n'écrit
pas bien. Untel demande wech, c'est qui celle-là, et Lahuiss lui répond qu'il
s'agit d'un homme, ce qui fait dire à Poto vas-y c'est quoi comme gars bizarre
ça encore." L'ensemble est très réussi et vivant, et empreint, dans son
dénouement, d'une jolie dimension poétique.
Roman lu dans le cadre des "68 premières
fois".
Catégorie :
Littérature française
adolescence / banlieue
/ ennui / bande / drogue /

Posté le 12/10/2020 à 16:58
Ils sont sept, membres d'une bande
soudés comme des frères : Kevin, Ryan, Idriss, Thomas, Lucas, Saïd et Raphaël,
le narrateur. Ensemble au collège, ensemble pour zoner, pour fumer des pétards
et boire des bières. Arrive un jour Quentin dont la coupe mulet va bientôt lui
donner son surnom de Queue-de-rat. Queue-de-rat devient le souffre-douleur de
la bande, notamment de Kevin. Ce qjui n'est pas sans gêner Raphaël, amoureux fou
de la sœur jumelle de Quentin, qui enveloppe les garçons de son mépris le plus
total. Mais Quentin finit par intégrer la bande, et par participer aux défis
les plus stupides. Jusqu'au drame…
Du drame, qui ouvre le roman et
entraîne chez le narrateur un dégoût de soi absolu, on n'en saura la nature
qu'au dénouement. Le récit met en place, de façon implacable, les différents
éléments qui vont y mener. Claudine Desmarteau a fait le choix d'adopter la
voix et le point de vue d'un des adolescents, dans une langue parfois crue, et
dresse à travers cette confession désespérée un portrait cruel mais juste
d'adolescents désœuvrés, obsédés par les filles, prêts à tout pour tuer
l'ennui.
Catégorie :
Littérature française
adolescence / bande /
rivalité / jalousie / amitié /
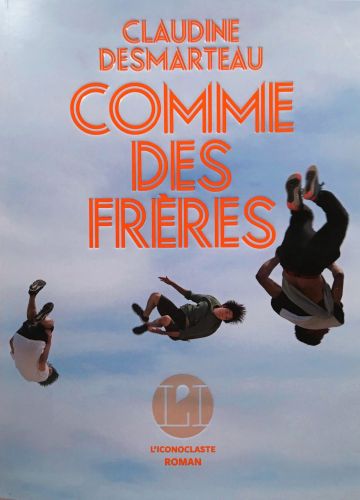
Posté le 12/10/2020 à 16:56
Une ville de la région bordelaise, dans
les années 50. Elise et son frère Lucien, orphelins, vivent chichement avec
leur grand-mère. Lucien a des ambitions : après s'est marié et avoir eu une
petite fille, il monte à Paris avec sa maîtresse. Sa sœur, qui adore son frère,
finit par le suivre et se fait embaucher au contrôle dans une usine de
voitures. Le travail se fait dans des conditions épuisantes et difficiles, par
des ouvriers dont une grande partie est composée d'Algériens. Elise y fait la
connaissance d'Arezki, ils deviennent amants, dans une France de 1957 où la
guerre d'Algérie – qu'à l'époque on nomme pudiquement "les
événements" – bat son plein, ainsi que le racisme qui dénonce la présence
des sales bicots, des ratons, lesquels volent le travail des Français.
Lire ce roman c'est replonger dans
cette époque trouble où il ne fait pas bon être arabe, ni en fréquenter un.
Ainsi Elise et Arezki sont-ils contraints à la discrétion, à des promenades
interminables dans Paris ; ainsi Arezki craint-il le moindre agent de police et
les arrestations nombreuses qu'il subit, relâché après une nuit passée au
poste, à condition d'avoir une fiche de paie en bonne et due forme. Cinquante
ans plus tard, la lecture de ce récit fait froid dans le dos, ainsi que la
découverte des conditions de travail des ouvriers à la chaîne de l'industrie
automobile. L'histoire d'amour entre Elise et Arezki vient heureusement mettre
un peu de tendresse dans ce tableau féroce, racontée par une jeune femme qui
vit enfin, et pour peu de temps, sa "vraie vie", même si elle reste
tiraillée entre son amour naissant et l'attachement pour son frère.
Roman lu dans le cadre des "68 premières
fois"
Catégorie :
Littérature française
France / Algérie /
guerre / usine / condition ouvrière / amour / famille /
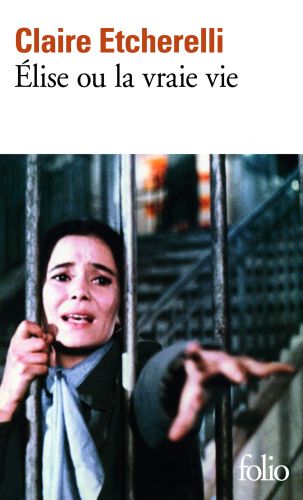
Posté le 16/09/2020 à 17:23
Il est des romans qui semblent écrits
pour vous. Non pas que l'intrigue ressemble à votre vie, ou que l'un des
personnages vous ressemble, mais ce qui est raconté, exposé – dans cette
autofiction qui se livre sans fard – vous touche, par sa justesse, et par ce
qu'elle résonne en vous. Pour ce qui me concerne, par ce rapport qu'entretient
l'auteur avec ses personnages fictifs certes, mais inspirés de personnes
réelles, et par sa façon de se mettre proprement en scène, dans une
"expérience intime". Ainsi l'auteure évoque-t-elle son manque d'imagination,
qu'elle compense par une sensibilité exacerbée, matière brute pour le
romanesque : "C'est en tout cas à
cette période que j'avais pris conscience du fait que je vivais le plus souvent
sur le mode romanesque. Tel mouvement, tel instant, futile en apparence,
prenait pour moi valeur de scène. Il m'arrivait d'ailleurs de provoquer
volontairement certaines situations, afin de modifier le cours banal des jours.
Ma rencontre avec Serge en était un exemple, ce qui n'atténuait pas l'élan que
j'éprouvais pour lui." S'agit-il de bovarysme ? L'auteure a-t-elle lu
trop de livres, ce qui la pousse à s'imaginer personnage de roman ? J'imagine
que nombreux sont les grands lecteurs, amateurs de littérature, qui font de
même – j'en suis, raison pour laquelle, entre autres, ce roman m'a touchée.
Cécile Balavoine raconte sa rencontre à
New-York, dans les années 90, avec le grand critique, le grand professeur Serge
Doubrovsky, avec lequel elle va nouer une "amitié amoureuse".
Quarante-cinq ans les séparent, mais l'homme reste homme, au point d'oser, un
soir, l'embrasser au coin de la bouche. Ce qui choque la narratrice, qui
cependant, inconsciemment, maintient dans leur relation une ambiguïté, à
s'assoir sur ses genoux, à respirer son après-rasage, au point que, quelques
mois plus tard, le "chair Serge" va la demander en mariage. Cécile
Balavoine ne cache rien de ses désirs et de ses contradictions, de ses élans de
tendresse envers cet homme qu'elle trouve trop vieux, qui a les dents jaunies, les
mains tavelées, et dont elle se refuse à imagine le sexe sous le slip de bain sur
la plage où il propose de l'emmener ; elle rend aussi un bel hommage à celui
qui fut son mentor et avec lequel elle a entretenu, au fil des années, une
amitié tissée de complicité et d'estime réciproques. En écrivant Une fille de passage, dont le titre fait
écho au dernier opus de Doubrovsky, Un
homme de passage, elle entre elle aussi dans l'autofiction où le maître
devient le protagoniste de l'histoire écrite par son disciple. C'est courageux,
ce travail de l'exposition de l'intime, et c'est aussi brillamment réussi.
Roman lu dans le cadre
des "68 premières fois"
Catégorie : Littérature
française
New-York / Paris /
littérature / écrivain / amitié / amour / autofiction / âge /
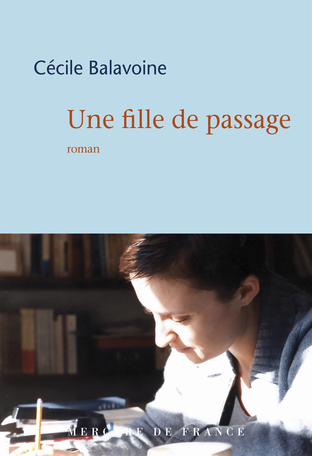
Posté le 28/07/2020 à 17:14
Costard, cravate, chaussures cirées et
cheveux lissés, Grand Frère, syrien par son père et breton par sa mère, est
devenu chauffeur de VTC après des années de galère à vivoter en fumant du
cannabis. Chaque vendredi, il va dîner chez son père qui n'évoque jamais le
sujet tabou : la disparition de Petit Frère, infirmier parti faire de
l'humanitaire au Mali, dont la famille est sans nouvelles depuis trois ans.
Mais voilà qu'un soir, l'aîné croit l'apercevoir aux abords de la gare. Est-il
enfin rentré en France ? Qu'est-il allé faire à l'étranger ?
Rédigé dans une langue contemporaine
mâtinée de termes arabes, de verlan et d'argot – glossaire à la fin pour les
novices -, ce roman fait parler Grand Frère qui, entre deux bouffées de joints,
s'interroge sur sa vie, le devenir des chauffeurs Uber et des indépendants, et
le destin de son frère ; il laisse aussi la parole à Petit Frère, qui raconte
son engagement pour une ONG musulmane en pleine Syrie en guerre, ses idéaux, et
son désarroi face à l'intransigeance des intégristes. A travers ce récit croisé
et la question de l'intégrisme religieux, c'est aussi la vie de quartier qui
s'exprime, l'ascenseur social en panne, l'argent facile de la drogue et les
trafics, le statut d'indic, le pouvoir des mots et de la pensée – avec un joli
clin d'œil à Romain Gary - la fraternité et la question de l'identité. De
nombreux thèmes qui n'entachent en rien une intrigue plutôt bien construite.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
Catégorie :
Littérature française
Islam / intégrisme /
Djihad / fraternité / banlieue / taxi /

Posté le 27/07/2020 à 16:39
Un petit village au pied du mont
Violent, Cantal, 1914. Les hommes sont envoyés au front, dont le père de
Joseph. A 15 ans, le jeune homme doit entretenir la ferme avec sa mère et sa
grand-mère. De l'autre côté, Valette, qui n'a pas été mobilisé à cause d'une
main atrophiée, rumine son aigreur avec une femme tout aussi pleine de rancœur que
lui. Arrivent chez lui sa belle-sœur et sa fille Anna suite à la mobilisation
du mari. Anna et Joseph se rencontrent, se
plaisent, et s'attirent très vite la jalousie de Valette qui révèle sa nature
profondément malveillante.
Dans ce coin reculé de l'Auvergne, au
début du siècle, la vie est rude, les étés caniculaires et les hivers féroces.
On travaille la terre, on tue le cochon sans s'émouvoir de ses cris, on
pratique le fatalisme comme une religion et le désir, bestial, anime les
hommes. Avec son écriture sobre et juste, Franck Bouysse campe à merveille cet
univers rural impitoyable surplombé par une montagne qui porte bien son nom.
Catégorie :
Littérature française
Cantal / Première
Guerre mondiale / vie rurale / jalousie / amour /
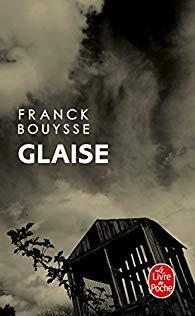
Posté le 21/07/2020 à 10:06
Shelly et Laura sont passionnées par le lilas, dont elles suivent la
floraison chaque printemps en parcourant les Etats-Unis à bord de leur
camping-car, remontant vers le nord au fur et à mesure que les boutons
éclosent. C'est aussi l'occasion d'emmener discrètement avec elles des femmes
auxquelles elles vont faire traverser la frontière avec le Canada. Cette fois,
c'est Maria Pia, une sexagénaire d'origine mexicaine qui les accompagne, et qui
va dévoiler à chaque étape du périple l'histoire de sa vie.
Dans ce long roman amplement documenté, qui fait la part belle aux figures
féminines, l'auteur aime à prendre son temps et ne craint pas les digressions.
A travers la bouche de Maria, lors de ces séances d'écriture imposées par
Shelly et Laura, sous l'odeur entêtante et envoûtante du lilas, il raconte
notamment le destin de Léopoldine, archiduchesse autrichienne mariée au roi du
Portugal et exilée au Brésil, où elle est publiquement bafouée par un mari devenu
empereur, volage et cruel, et où elle s'éteindra à 29 ans. Il narre aussi celui
de Thérèse, l'amoureuse que Maria va suivre à Paris, celui de leurs filles,
Rose et Simone. Alors oui, il arrive que l'on perde de vue le propos initial,
le fait que Maria est sans papiers et projette de refaire sa vie dans un pays
dont elle va franchir la frontière en toute illégalité – et c'est le but de son
voyage, et elle se fout du lilas. Mais tous ces destins croisés, au Brésil au
19ème siècle, à Paris dans les années 50, dans les Etats-Unis de
2011, racontent à leur façon la lutte des femmes pour leurs droits et leur
émancipation. Au printemps, l'odeur des lilas donne à chacune une envie de
liberté.
Catégorie :
Littérature française
périple / Etats-Unis /
destin / femme /
Roman lu dans le cadre de Masse Critique Babelio
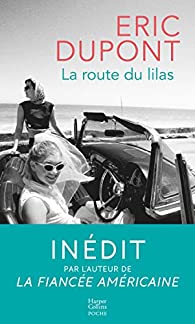
Posté le 06/07/2020 à 18:23
Suite à une rupture amoureuse, le
narrateur, employé d'un pressing, survit à coups de bière. C'est dans cet état
de naufrage qu'il rencontre Emma. Le coup de foudre est immédiat, et va le
conduire, six mois plus tard, au mariage. Les deux amoureux partent pour
Sandpiper, un village de vacances en bord de mer, pour s'installer dans un
bungalow nommé "Bernique" – tout un programme. Le jeune marié passe
la nuit de noces complètement aviné ; à son retour au bungalow, Emma a disparu.
Le récit part ensuite dans une intrigue rocambolesque où le narrateur devient
gérant du camping et rameute ses quelques amis afin d'endiguer la vague de curieux
venus admirer l'Allemand neurasthénique qui tourne en rond sur la plage pendant
des jours en psalmodiant le prénom de sa femme disparue.
L'histoire est assez drôle au fond, si on sait faire fi de l'écriture
franchement médiocre : cela se veut drôle, c'est pétri de vulgarités, de
métaphores faciles – "En rentrant au travail, j'étais satellisé. Au bord
du faux pli et pas du tout accro à la pattemouille. Je le reconnais aisément,
ça n'a pas amidonné sec cet après-midi-là." – et parfois d'un mauvais goût
absolu – son couple de patrons chinois a la peau si fripée qu'on pourrait en
repasser les plis. Le propos se veut drôle et un peu déjanté, pourquoi pas,
mais pour moi ce roman n'a rien de littéraire, ne présente pas grand intérêt et
sera vite oublié.
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois
Catégorie :
Littérature française
mariage / rupture /
alcool /
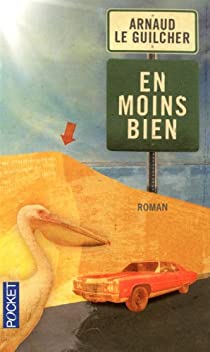
Posté le 22/06/2020 à 11:43
A Palerme, dans les années 60, Antonia
a épousé un homme qu'elle n'aime pas, dont elle a eu un fils. Elle s'ennuie,
étouffe, dans cette vie bourgeoise alors qu'elle rêve d'horizons libres. La
découverte de lettres et de photos suite au décès de sa grand-mère lui font
prendre davantage consciente de l'insatisfaction qui est la sienne. "Antonia,
écrit-elle, tu dois : émerger, apparaître, sortir, te montrer, jaillir des
tréfonds, manifester ta présence. Qu'attends-tu ?". Dans le journal
qu'elle tient sur un an et demi, elle raconte les souvenirs de sa vie passée,
sa souffrance actuelle, sa mélancolie, ses déceptions, ses difficultés à être
une bonne mère. Elle dit aussi son dégoût pour son mari et cette vie étriquée
qu'il lui fait mener. Au bout de dix-huit mois d'écriture, elle se décide enfin
à exister, et à faire craquer les coutures du corset dans lequel elle était
enfermée. On pourrait reprocher à ce récit diariste sa brièveté, cette
concision me parait cependant suffisante pour rendre compte du cheminement
progressif qu'elle parcourt. En revanche, on se perd un peu dans le nombre
important de membres de la famille et des liens qui les unissent – ou les
séparent -, ce qui aurait mérité, pour le coup, quelques pages supplémentaires.
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois
Catégorie :
Littérature française
Italie / années 60 /
couple / ennui / mélancolie /
"Oublier le
climat myope de ses yeux
Oublie ce qu'il
disqualifie et surtout son acharnement
Oublier ce long et
interminable couloir
Oublier de préparer le
déjeuner. Oublier de ranger
Oublier de suivre le
programme
Oublier de le
questionner sur sa journée
Perdre la liste des
choses à faire
Feindre des migraines
régulièrement
Oublier de fermer les
fenêtres
Oublier son corps
liquide
Oublier la laideur
Ignorer les bouts
d'ongles qui traînent sur le bord du lavabo
Relire si
nécessaire" p.66
"Franco est un homme
tiède, sans courage. Sa vie s'étend sur quelques mètres carrés. Parler avec lui
c'est restreindre mon horizon, restreindre mon vocabulaire, restreindre mon
imaginaire. Franco porte une minerve qui l'empêche de regarder à gauche et à
droite, et moi une camisole de force de perfect
house wife. Où allons-nous ainsi ?" p.71
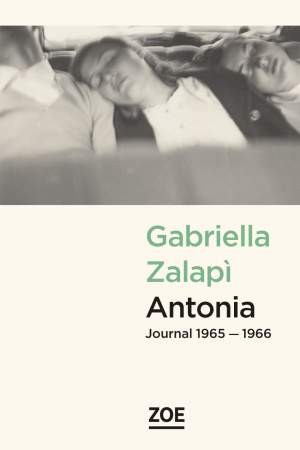
Posté le 21/06/2020 à 17:32
Dans les années 1970, Diego Garcia
appartient à l'archipel des Chagos, lui-même rattaché à l'île Maurice.
Marie-Pierre Ladouceur y mène avec sa fille Suzanne une vie simple et pauvre
mais heureuse. Elle fait la rencontre de Gabriel, un jeune Mauricien venu
travailler comme administratif, dont elle tombe amoureuse. Il lui apprend à
lire, elle lui apprend l'amour. Le bonheur pourrait durer ainsi, mais suite à
l'indépendance de Maurice en 1973, les Chagos sont réquisitionnés par l'armée
britannique et leurs habitants contraints à un exil aussi soudain que brutal
vers l'île Maurice où ne les attendent que la misère et les bidonvilles. Ce
récit lie la petite et la grande histoire, il raconte l'amour de Marie et de
Gabriel, et celui que les Chagossiens vouent à leur terre perdue ; il raconte
le long chemin que les habitants spoliés ont entrepris pour obtenir justice et
réparation, à travers le personnage de Joséphin, le fils de Marie. Il faudra 45
ans pour que la requête soit examinée par le tribunal de la Haye et qu'enfin,
les Chagos soient rendues aux Chagossiens. Outre son aspect éminemment
romanesque et attachant, ce récit lève avec brio le voile sur un pan méconnu de
l'histoire coloniale britannique.
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois.
Catégorie :
Littérature française
archipel /
colonisation / Grande-Bretagne / exil / spoliation / drame / famille /
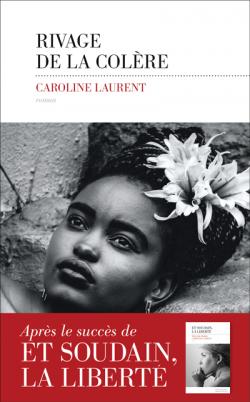
Posté le 21/06/2020 à 17:27
Depuis toute petite,
Nelly Alard est passionnée par l'impératrice Elisabeth de Wittelsbach, plus
connue sous le surnom de Sissi l'impératrice, incarnée par Romy Schneider dans
la série éponyme des années 50. Une légende court sur la fille secrète que
l'impératrice aurait eu, une certaine Karoline Zanardi Landi. L'auteur se donne
pour mission d'éclaircir le mystère entourant la prétendue filiation entre
Sissi et Karoline, et mène une enquête qui lui fait découvrir Elissa Landi,
actrice des années 30 et 40, fille de Karoline. Ses recherches, qui l'amènent à
accepter le fait qu'Elissa n'a pas d'ascendance impériale, la conduisent à
s'attacher au personnage d'Elissa, à ses débuts dans le monde du cinéma. Voilà
que le récit de son enquête devient le roman d'Elissa, entrecoupé de ses
réflexions et des comptes-rendus de ses visites à Caroline, la fille d'Elissa.
Finalement, c'est cela qui importe, davantage que la réalité historique,
avérée ou non : le rapport que l'écrivain entretient avec ses personnages,
réels mais, par le biais de la fiction, devenus l'enjeu d'interrogations
personnelles. Quel lien entretient-on avec des célébrités quand il ne reste que
la version officielle de leur histoire et des écrits intimes soumis à
controverse ? Ce va-et-vient entre fiction et réflexions est l'aspect le plus
intéressant d'un récit qui m'a paru par ailleurs complexe, en raison du nombre
de personnages et de la généalogie des familles de Sissi et d'Elissa, et dont
la thématique, je l'avoue, me laisse un peu froide.
Catégorie :
Littérature française
monarchie / famille / fiction / histoire /
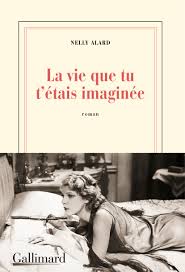
Posté le 21/06/2020 à 17:25
Barbara est
enseignante à la fac. D'une indépendance et d'une assurance à toute épreuve,
elle a fait le choix d'un célibat agrémenté de jeunes amants occasionnels. Ce
bel équilibre menace de rompre quand elle est convoquée par le médecin de
l'EHPAD où réside Rose, sa mère devenue sénile. Ces retrouvailles obligées avec
cette mère qu'elle a fuie à ses 18 ans la contraignent à revisiter son passé,
tandis que Charles Bodier, neurologue en fin de carrière nouvellement nommé
dans cet EHPAD, fait le constat amer d'une vie qui ne lui convient plus et
s'ennuie un peu. Lise, elle, ne s'ennuie pas, elle passe ses journées à courir
d'un patient à l'autre, tâchant de donner à chacun l'humanité dont ils ont
besoin et que ne permet pas l'exigence de rentabilité du secteur.
C'est un beau parcours que celui de ces trois personnages qui vont tous
trois, à leur manière, s'entraider, et accomplir un chemin inconfortable vers
une libération. Avec beaucoup de sensibilité, d'élégance et de finesse, Gaëlle
Pingault explore les continents de vies qu'on construit comme on peut, jusqu'à
ce que vienne l'heure des choix qui se font quand on parvient à faire la paix
avec soi-même. Ces cœurs imparfaits et solitaires vont ce qu'ils peuvent, et
c'est déjà beaucoup.
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois
Catégorie :
Littérature française
vieillesse / solitude
/ choix /
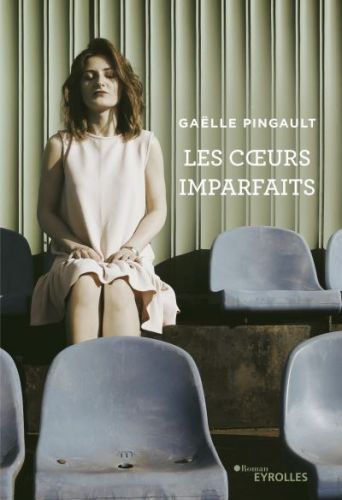
Posté le 21/06/2020 à 17:18
Jean a perdu sa femme et a dû élever
seul son fils Pierre. Il fait les nuits avec son taxi pour profiter au maximum
de son fils qui, à 20 ans, est resté très proche de lui, fait des études et
écrit un roman. Ils partagent tous deux une passion pour la plongée en apnée. Las,
lors d'une dernière séance, Pierre est anormalement fatigué. Son état de santé
se dégrade ensuite, au point qu'il doit passer des examens, lesquels révèlent
que le jeune homme souffre d'un cancer. Dévasté, Jean décide de soutenir son
fils autant qu'il le peut, et tant pis s'il doit déguiser la réalité. Car c'est
bien de cela que parle ce court roman, écrit d'une plume précise et sobre par
ce tout jeune auteur, de l'amour d'un homme pour son fils, de ce qu'il est
capable de faire pour lui donner un peu d'espoir, de raison de tenir, alors que
Pierre est condamné. Bien sûr, on ne nous cache pas grand-chose de la triste
réalité hospitalière, de l'impuissance du corps médical à soigner le jeune
homme, mais c'est surtout de la façon dont on peut ou dont on croit aider au
mieux le malade qu'il est question. Substituer à la terrible réalité une autre
réalité un peu moins dure, c'est mentir, peut-être, mais c'est aussi redonner
un peu de lumière dans le regard du fils mourant. Ce qui est inventé peut aussi
être vrai, tout autant que le réel. Une référence au paradoxe de Schrödinger,
complexe voire incompréhensible aux néophytes, mais finalement, peu importe ce
qui est, l'important est ce que l'on croit.
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois
Catégorie :
Littérature française
maladie / aidant /
vérité / espoir /
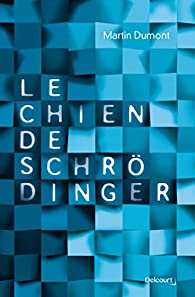
Posté le 13/05/2020 à 09:45
Corentin, délaissé par
sa mère, a passé son enfance dans plusieurs foyers d'accueil avant d'arriver
chez son arrière-grand-mère Augustine, qui vit dans un hameau perdu, les
Forêts. Contre toute attente, il y trouve attention et affection. Parti faire
ses études dans la Grande Ville, il s'étourdit de fêtes avec des amis dans les
catacombes. Jusqu'au jour où une tempête de feu ravage la terre et détruit la
population, à l'exception de Corentin et de ses amis. Que faire ? Désormais, il
n'a qu'une obsession, survivre, pour retrouver Augustine.
Un énième roman sur
l'apocalypse et la destruction du monde ? Oui, mais pas que. Certes, Sandrine
Collette plante un décor fait de cendres, de cadavres à demi-brûlés, de ciel
uniformément gris d'où tombe une pluie acide, un monde de silence absolu où
toute vie, animale ou végétale, a disparu, laissant place à un silence
assourdissant, un monde qui n'est pas sans rappeler celui de La route de Cormac McCarthy, auquel
l'auteur fait allusion lorsque Corentin aperçoit un jour un homme et son fils
qui remontent la route en poussant un caddie. Un monde affreusement désolant
donc, mais dans lequel subsiste un peu de vie. Celle du chien aveugle qu'adopte
Corentin, celle des enfants que sa compagne Mathilde va mettre au monde, celle
des pommes de terre qu'il fait parvenir à faire pousser, rabougries, petites,
mais des pommes de terre quand même. Une raison de ne pas céder au désespoir.
Et puis il y a la langue de Sandrine Collette, son rythme, sa rugosité parfois,
qui restitue si justement la dureté de cette vie et les pensées de Corentin.
Celui-ci est un homme, avec ses failles, ses doutes, ses erreurs, ses moments
d'espoir puis de désespérance, porté par l'instinct de survie. Forcément, on
s'y voit aussi. Aucun miracle ne vient clore cette histoire sombre, mais on
peut croire, en refermant ce beau roman, à un avenir un peu plus clair, là-bas,
vers l'ouest.
Catégorie : Littérature française
destruction / catastrophe / famille / survie /
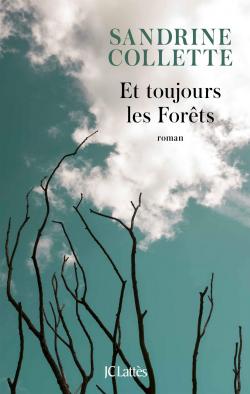
Posté le 13/05/2020 à 09:44
Destins croisés sur l'autoroute. Il y a
Romand Carratero, professeur de technologie qui va rendre visite à sa femme
hospitalisée, Frédéric Grison, chauffeur de poids lourd, Sylvain Page et son
fils mutique partis pour Disneyland, un autostoppeur portant une pancarte qui
mentionne "Ailleurs" en guise de destination, Pierre Palmier, qui vit
dans une caravane sur une aire d'autoroute, Catherine Delizieu, forte femme à
la tête d'une multinationale, Maryse et Lucien Gruson, un couple septuagénaire,
Zoé Soriano, serveuse dans une cafeteria, enfin un jeune couple en 205. On suit
chacun d'entre eux, dans des récits de vie scandés par la radio, informations,
annonces publicitaires, on découvre leur histoire à petites touches ; rien ou
presque ne semblent les réunir, tandis qu'ils suivent l'autoroute dans un sens
ou dans l'autre, jusqu'à ce que le hasard, ou la fatalité, les fasse se
rencontrer.
Marcus Malte joue à déstabiliser son
lecteur. D'abord, avec cette introduction où un professeur enseigne, dans une
novlangue surprenante, la façon dont on vivait jadis, à "l'ère de la
procréation naturelle". Ensuite, en introduisant chaque personnage par le
véhicule qu'il conduit, dont la puissance moteur, l'âge et la cote argus sont
représentatifs de sa classe sociale. Enfin, en choisissant volontairement un
récit choral dans lequel chacun a sa place sans jamais rencontrer l'autre. Une
sorte de patchwork dont on ne saisit que progressivement l'unité, au fur et à
mesure que les pièces s'ajoutent pour créer un ensemble qui va prendre sens. Ce
que raconte surtout Marcus Malte à travers les destins croisés de ses 14
personnages, c'est des rêves, des désillusions, des attentes, des regrets,
c'est une actualité parfois absurde, ou terrible, le portrait d'une société contemporaine
dans laquelle les humains sont identifiés par leur véhicule, symbole de leur
puissance ou de leur ambition. J'ai retrouvé dans ce roman l'humour parfois
corrosif et l'intelligence de la langue du Garçon,
mais sans son romanesque. Le parti pris d'un roman choral, sans réelle
rencontre des personnages à part celle de l'impitoyable fatalité, m'a paru un
peu fastidieux et long.
Catégorie : Littérature
française
personnage / route /
destin /
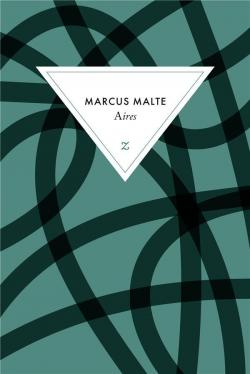
Posté le 13/05/2020 à 09:42
Sarah est morte. Dans un univers
inconnu elle nous parle et nous raconte sa vie d'avant, et sa rencontre avec
Théo, qui lui fait oublier ses difficultés à vivre et à être heureuse. Suivent
alors de belles années avec l'arrivée d'un petit Simon puis, trois ans plus
tard, une nouvelle grossesse. Mais on découvre alors que Sarah souffre d'un
cancer du thymus, extrêmement invasif et inopérable. Mais le couple refuse de
céder au désespoir. Ils sont jeunes, drôles, et savent puiser dans leur
complicité l'énergie pour endurer les traitements. Le récit ne fait l'impasse
sur rien, effets secondaires de la chimio ou moments de découragement, mais
avec élégance et discrétion. Non plus qu'il fait l'impasse sur la possibilité,
pour l'accompagnant, de chercher dans d'autres bras les forces dont il a besoin
pour continuer. Dans les récits ou témoignages de bataille menées contre cette
maladie, on parle finalement assez peu des aidants, et notamment des conjoints.
Comment tiennent-ils le coup ? Ici, le choix a été fait de ne rien omettre du
désir de vie de Théo, qui parvient à le concilier avec sa présence auprès de
Sarah. Ce pourrait être une trahison, c'en est loin, et d'ailleurs cette nouvelle
relation qu'entame Théo est racontée par Sarah sans aucune jalousie ni
souffrance. Ce récit, dont le sujet aurait pu rebuter, a l'intelligence de
faire une grande place au bonheur et à la capacité de vivre.
Catégorie :
Littérature française
maladie / mort / amour
/

Posté le 13/05/2020 à 09:38
Le narrateur, commercial pour une
entreprise de jouets, séjourne régulièrement en Chine. Il se lie avec Mme Ming,
la dame-pipi de l'hôtel où il réside. Ils se mettent à converser régulièrement,
Mme Ming lui narre l'histoire de sa famille nombreuse et émaille son récit de
nombreuses citations de Confucius. Mais est-il crédible que cette dame ait pu
avoir autant d'enfants sous le régime de l'enfant unique ? Mme Ming n'est-elle
qu'une affabulatrice ? Eric-Emmanuel Schmitt nous offre de façon très efficace
une sorte de conte qui mêle réflexion sur la condition humaine et quête
personnelle.
Catégorie :
Littérature française
Chine / enfant /
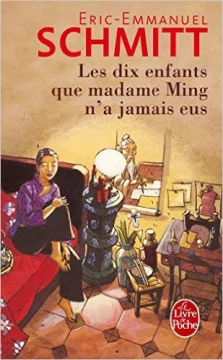
Posté le 13/05/2020 à 09:37
À l'heure où le régime castriste
s'essouffle, Juan Jonava, surnommé Don Fuego, chante toujours dans les cabarets
de La Havane. Il enflamme depuis des années le public du Buena Vista Café au
son des rumbas et chansons cubaines. Il se targue d'avoir chanté Hasta siempre devant Fidel Castro,
chante des standards comme Oye como va,
Guantanamera. Jadis, sa voix
magnifique électrisait les foules. Aujourd'hui, les temps ont changé et le roi
de la rumba doit céder la place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une
jeune fille " rousse et belle comme une flamme ", une jeune fille
sauvage qu'il prend sous son aile et dont il devient fou amoureux, malgré une différence
d'âge conséquente et la nature rebelle et mystérieuse de la jeune fille. Mais
le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle.
"Sans la musique je ne suis plus
qu'un écho anonyme lâché dans le vent. Je n'ai plus de veines, et donc plus de
sang ; je n'ai plus d'os pour tenir debout ni de face à voiler." dit- Don
Fuego. Sa rencontre avec Mayensi, lui permet de retrouver une deuxième
jeunesse. Grâce à sa patience, il réussit à apprivoiser cet oiseau sauvage et à
l'emmener vivre avec lui dans une cahute au bord de la mer tandis que qu'il
vivote de contrats comme chanteur remplaçant. Le bonheur semble être à portée
de main, pour disparaître très vite. Un beau récit poétique et mélancolique sur
le désenchantement, et la sagesse qui se cache mais qui est là, derrière le
désespoir.
Catégorie :
Littérature française
Cuba / musique /amour
/
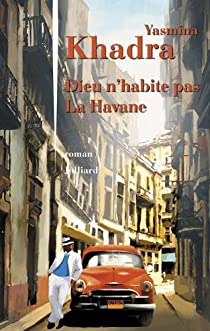
Posté le 13/05/2020 à 09:34
Paula Karst entre dans l'Institut de
peinture à Bruxelles. Elle va y suivre une formation pour devenir peintre en
trompe-l'œil. D'abord très solitaire et mal dans sa peau, elle va se lier avec
Kate et Jonas, et parvenir à suivre le rythme infernal d'un cursus très
technique, exigeant et épuisant. Chacun des trois étudiants poursuit ensuite sa
route et trouve des contrats de durée variable, chantier de restauration,
création de décors pour un film, entre misère et exaltation.
Dans cette école on apprend à peindre
les bois, les marbres, les pierres semi-précieuses, les plafonds et les frises,
les dorures et l'argenture ; on devient expert en pigments, jaune de cadmium,
vermillon, noir impérial, sang-de-bœuf, terre d'ombre… Paula peint le plafond
d'une chambre d'enfant, contribue à la création de la loge papale d'Habemus papam de Nanni Moretti, avant
d'être intégrée dans une équipe chargée de reconstituer à l'identique les
fresques de Lascaux. Elle y trouve là son apothéose, au fond d'un hangar où
elle broie ses matériaux, manie les ocres et se fond dans le décor. Sous nos
yeux de lecteur se dessine une belle aventure humaine et artistique, amplement
documentée, portée par la langue fluide et dansante de Maylis de Kérangal.
Catégorie :
Littérature française
peinture / art /
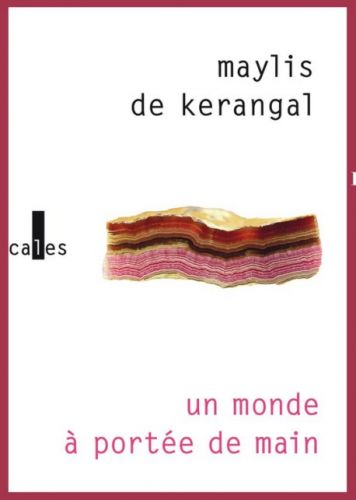
Posté le 13/05/2020 à 09:32
8 octobre 1908. Les résultats du
concours d'entrée à l'Académie des beaux-arts tombent : Hitler est recalé,
tandis qu'Adolf H. est reçu. Au bout de trois pages, la question fuse : "Que se serait-il passé si l'Académie des
beaux-arts en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, à cette minute
précise, le jury avait accepté Adolf Hitler ? Cette minute-là aurait changé le
cours du monde. Que serait devenu le vingtième siècle sans le nazisme ? Y
aurait-il eu une Seconde Guerre mondiale, cinquante-cinq millions de morts dont
six millions de Juifs dans un univers où Adolf Hitler aurait été un peintre
?".
Eric-Emmanuel Schmitt va donc explorer
la piste : dans cet ample roman, il trace le parcours du vrai Hitler, né de la
guerre, du dépit - "Il n'a que le talent de la haine. Mais il en a
tout le talent", écrit-il dans une postface passionnante qui narre la
genèse de la rédaction du roman, ses doutes en cours d'écriture et la réaction
de son entourage ; il met parallèlement en scène un Adolf H. devenu étudiant en
peinture, pas forcément peintre talentueux mais un homme "bien", un
double antagoniste du dictateur assassin, qui "guérit et s'ouvre aux autres tandis qu'Hitler s'enfonce dans sa névrose
en se coupant de tout rapport humain." Le premier est tout ce qu'il y
a de plus réel, de plus glaçant, de plus horriblement véridique, infligeant à
son auteur la tâche détestable d'entrer dans sa tête et de connaître par cœur
les moindres détails de sa biographie, de la naissance de son antisémitisme à
la fin de la guerre 14-18 à la solution finale ; le deuxième est lumineux
d'humanité, environné de personnages qui font respirer, Onze-heures-trente,
sœur Lucie, Sarah… Un projet qui lui a valu méfiance, voire condamnation, mais
un résultat saisissant d'intelligence, relevant à la fois de la dystopie et
d'une réflexion sur l'altérité, cette part de l'autre qu'Hitler a niée quand
Adolf H. en a fait son miel.
Catégorie :
Littérature française
seconde guerre
mondiale / Hitler / altérité / dystopie /
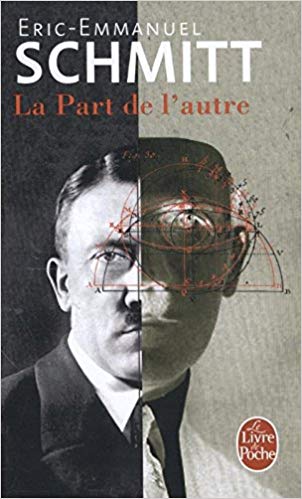
Posté le 12/05/2020 à 18:16
Emma Servin est enseignante de français
dans un collège de banlieue. Huit élèves sont soupçonnés de viol en réunion sur
une de leurs camarades et certains d'entre eux sont arrêtés. Toute la
communauté éducative s'interroge et se voit profondément ébranlée, enseignants,
surveillants et principal se demandent pourquoi ils n'ont rien vu, rien deviné
; les hypothèses et les rumeurs se multiplient. Emma est encore plus
bouleversée que les autres par ce drame qui réveille des fantômes, d'autant
plus qu'elle avait en classe certains des coupables. Ce récit est à la fois
celui d'une femme blessée, d'éducateurs impuissants, et de jeunes dont on ne
sait s'ils ont conscience ou non de la gravité de leurs actes. Le récit de
Gabrielle Tuloup est un roman, mais il est inclut aussi d'autres pièces du
dossier, bulletins trimestriels, rapport de l'assistante sociale… Il évoque à
la fois le difficile chemin pour la victime qui souvent n'ose pas porter
plainte, et le parcours de cette enseignante touchée à double titre. L'auteur
traite d'une plume élégante un sujet délicat, sans tomber dans le pathos.
Catégorie :
Littérature française
viol / collège /
Roman lu dans le cadre des 68 premières fois.
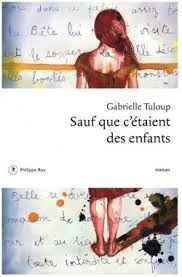
Posté le 12/05/2020 à 18:15
L'histoire des derniers jours de Jésus racontée par lui-même. Il vient tout
juste d'être condamné à mort et attend d'être crucifié le lendemain. Il revient
sur ses miracles, auxquels ceux qui ont assisté sont venus au procès en tant
que témoins à charge, il évoque son étrange pouvoir, ses relations avec ses
disciples et avec Madeleine. Il découvre la peur, et comment la combattre :
entretenir la soif.
Amélie Nothomb s'attaque à un mythe, et fait le pari ambitieux de nous
faire rencontrer connaissance avec un homme, mais avec ses faiblesses, ses
désillusions, presque ordinaire pourrait-on dire si ce n'est qu'il se définit
lui-même comme incarné et fils de Dieu. Il a une dimension tout ce qu'il y a de
plus humain, il ne se dérobe pas à son long supplice et, face à la mort, et
même ressuscité, il est comme n'importe quel être humain : seul. C'est sur ce
thème que se clôt ce récit un peu étrange, non dénué d'humour parfois, qui
donne à voir un Jésus bien loin de celui qui a enduré sa passion en rémission
de nos péchés faits et à venir.
Catégorie :
Littérature française
catholicisme / religion
/
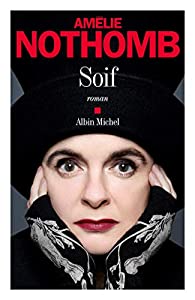
Posté le 12/05/2020 à 18:13
François Abergel s'apprête à épouser
Léningrad mais semble bien moins intéressé par les préparatifs de son mariage
que son fiancé. C'est qu'il a bien d'autres choses en tête, notamment les accès
de colère de son père contre sa judéité, qui va jusqu'à assister au
one-man-show d'un certain Donnémoidufric, antisémite et raciste. L'occasion
pour le père et le fils de se fourrer dans un guêpier et de faire la
connaissance de créatures aussi diverses que dangereuses : Ionas le vampire,
amoureux de l'artiste pyromane Sara Lanterne, enlevée par un montre aussi
redoutable que repoussant, Liou la femme mandragore, Miss Je Kill, tueuse
redoutable qui change de sexe chaque mois, Rougarou la femme crocodile. Et sur
le plan humain, Rebecka la psychanalyse du Monter World et une rabbine. Tout se
petit monde s'allie pour faire la peau du terrible démon ravisseur qui se
nourrit de la haine des hommes.
C'est un récit drôle, dans lequel
l'auteur ne craint pas de griffer le Judaïsme, notamment à travers le
personnage du père de François. Un récit délirant aussi, oscillant entre
réalité, récit social et politique, et historie fantastique. Un drôle de
mélange un peu décousu où les créatures surnaturelles échangent sur Monster
Tinder, où on ne craint pas le kitsch des pires films d'horreur avec un combat
entre les Abergel et des morts vivants qui se dévorent le cœur et la cervelle
en décomposition, et une dénonciation, sous couvert de l'humour, des pires
discours antisémites. Ce qui n'exclut pas une distanciation et une critique du
Judaïsme, de son aspect parfois conservateur, avec un humour parfois féroce et
une autodérision qui ne sont pas sans rappeler – et l'auteur y fait d'ailleurs
une référence assez claire – les tribulations de Mangeclous ou des Valeureux
d'Albert Cohen. C'est certes un peu décousu, parfois presque outrancier, mais
si on se laisse porter par cet univers un peu foldingue on y prendra un vrai
plaisir de lecture.
Roman lu dans le cadre de Masse Critique de Babelio
Catégorie : Littérature
française
Judaïsme / monstres /
humour / homosexualité / religion /
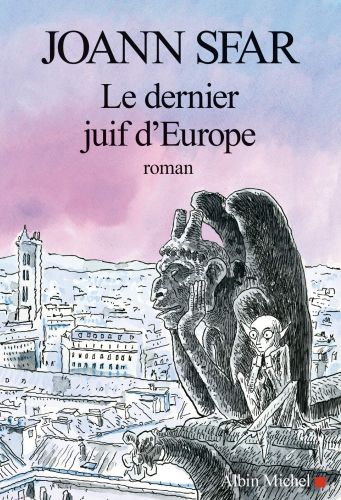
Posté le 12/05/2020 à 18:02
Paris, années 50. Une jeune Américaine
prénommée Violet Lee débarque, avec pour tout bagage quelques bijoux et son
Rolleiflex. Elle a quitté un mari fortuné et surtout laissé son petit garçon.
Quel drame l'a poussée à faire un tel choix absolument inconcevable de la part
d'une mère qui garde précieusement la photo de son enfant ? Violet a fui
quelque chose, et craint d'être poursuivie. Le hasard de rencontres lui
permettent de trouver de l'aide et de refaire sa vie dans un Paris qui se remet
des blessures de la guerre au fond des clubs de jazz où elle fait la
connaissance de musiciens et tombe amoureuse d'un mystérieux homme d'affaires.
Elle conquiert sa liberté et son indépendance, devient photographe, sans jamais
oublier le petit garçon qu'elle a laissé à Chicago…
Ce récit, c'est le Paris des années 50
ressuscité sous la plume de Gaëlle Nohant, c'est le Chicago de la ségrégation
où les Noirs sont parqués dans des ghettos où le moindre mètre carré est loué à
prix d'or par des promoteurs peu scrupuleux qui y entassent des familles dans
des conditions infectes. C'est aussi l'histoire d'une femme qui se bat d'abord
pour sa propre liberté avant de combattre pour l'égalité des droits. Si Gaëlle
Nohant campe avec talent les lieux et les époques, et un vrai protagoniste
avide de liberté, on peut regretter cependant que certains personnages, qui ont
joué un grand rôle dans la vie de Violet, disparaissent de l'histoire de façon
un peu rapide, notamment Horacio, le pianiste aveugle, qui a tout de même
partagé de longues années avec l'héroïne.
Catégorie :
Littérature française
Etats-Unis / Chicago /
Paris / femme /
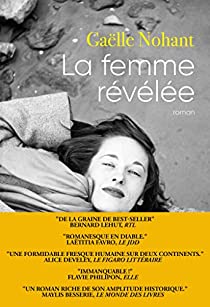
Posté le 12/05/2020 à 17:59
L'auteur apprend de la
bouche de sa grand-mère que son grand-père est né d'un viol. Abasourdi par la
révélation, il entreprend de reconstituer les faits en se documentant auprès de
l'état civil et en recueillant des témoignages. Au printemps 1923, quatre naissances
ont été enregistrées à la mairie de Sougy, de père inconnu. L'auteur fait alors
le lien avec le bal de la Saint-Laurent, qui a eu lieu en août de l'année
précédente, et reconstitue les faits. Les jeunes filles ont-elles été
consentantes, ou, étourdies par le vin et la fête, se sont-elles laissé faire
sans vraiment être d'accord ? La question est d'autant plus cruciale que la
révélation de ce secret arrive en pleine affaire MeToo, et que la compagne de
l'auteur travaille sur cette notion de "zone grise". La
reconstitution que fait Deslande de ces jours d'été 1922 et de cette soirée est
remarquable ; la deuxième partie de l'ouvrage, qui évoque le devenir de ces
enfants dits "naturels" est intéressante mais fait perdre au récit de
son intensité, jusqu'aux derniers mots écrits par Zineb Dryef, compagne de
l'auteur, d'une réalité glaçante. La question du consentement s'affranchit des
époques et reste d'une triste actualité.
Catégorie :
Littérature française
viol / consentement /
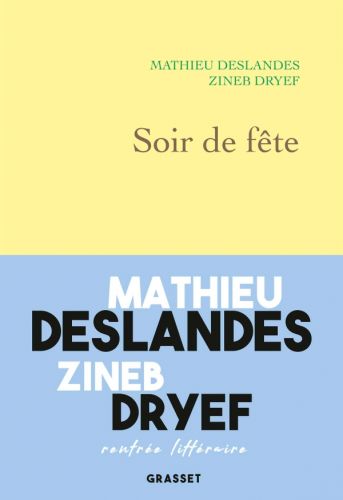
Posté le 12/05/2020 à 17:56
Tristan est chef
d'orchestre dans une ville de province. Pianiste de formation, il se consacre
tout entier à son art, tout en menant une relation amoureuse avec une
chorégraphe de 25 ans sa cadette. Jusqu'au jour où les sons harmonieux de la
musique qu'il écoute ou qu'il dirige arrivent à son oreille curieusement
déformés et faux. Alors que la première de Tristan et Isolde se profile, il
devient incapable de diriger l'orchestre.
Ce roman, écrit par un musicien, est
l'œuvre d'un spécialiste. Les références techniques sur des accords ou des
variations de ton et de demi-ton pourront rebuter un lecteur qui se sera pas au
fait de la gamme en 12 notes. Cependant, le protagoniste est touchant, affligé
d'une maladie à la cause inexplicable qui compromet le projet d'une vie
entière.
Catégorie :
Littérature française
musique / orchestre /
ambition /
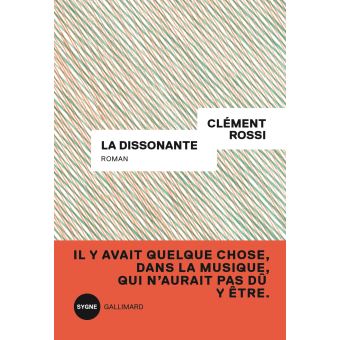
Posté le 12/05/2020 à 17:52
Paul Ackerman est écrivain. Il écrit la
nuit, se couche à pas d'heure et ne se lève pas avant midi. Quand il parvient à
s'endormir, il est rugbyman professionnel et tanne l'équipe anglaise d'en face,
ou rêve qu'il vole. Il est passionné de vieilles anglaises décapotables pour
lesquelles il se ruine, au grand dam de son épouse qui cependant partage avec
lui la même ambition, celle de travailler le moins possible. Et tant pis si on
leur coupe l'eau ou que la banque menace d'hypothéquer la maison. Tous les
matins je me lève est la phrase qui inspire plus ou moins Paul pour son
prochain roman, et celle qui va clore celui qu'on a entre les mains : "Je
ne vaux pas grand-chose, je ne crois en rien et, pourtant, tous les matins, je
me lève." Un récit doux-amer sur l'inspiration qui va et qui vient, le
refus absolu d'entrer dans un moule, la vie que l'on mène, sans ambition ni
forfanterie, mais la sienne.
Catégorie
: Littérature française
écrivain
/ famille /
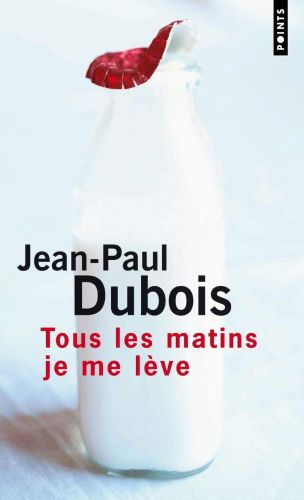
Posté le 26/01/2020 à 12:08
Le père de Paul Peremüller a disparu
dans un lac canadien où, deux fois l'an, il allait pêcher. Paul décide de se
rendre sur place, dans la ville de La Tuque, où il retrouve l'ami d'enfance de
son père. Jean Ingersöll va lui faire une révélation bouleversante.
Il lui en faut du temps à Paul pour
digérer ce qu'il vient d'apprendre. A lui désormais d'aller sur les traces de
ce père qu'il croyait connaître, sur les rives du lac Flamand où il va passer
quelques jours avant de décider, sur une impulsion, de pénétrer dans les Bois
sales situés juste à côté de la cabane de pêcheur. Des forêts inextricables,
sauvages, dont la légende raconte que de nombreux hommes y ont perdu la vie en
cherchant à les traverser. Geste désespéré ? Volonté de mourir pour mieux
renaître ? Paul s'y enfonce sans savoir s'il en ressortira vivant, dans une
plongée au cœur de lui-même, pleine d'épines et de ronces. Ce récit fait la
part belle à la nature canadienne et aux questions de l'homme, aux rivières
survolées en Cessna ou en Beaver, et on y sent les prémisses du dernier roman de
Jean-Paul Dubois, Tous les hommes
n'habitent pas le monde de la même façon. Ses Paul, qu'ils s'appellent Hansen
dans son dernier opus, Peremüller ou encore Ackerman (Tous les matins je me lève) dont des hommes ordinaires que la
notion de réussite ne touche guère et dont l'ambition est surtout de rester
libres, et c'est bien cela qui les rend touchants et si humains.
Catégorie
: Littérature française
famille
/ secret / solitude / renaissance /
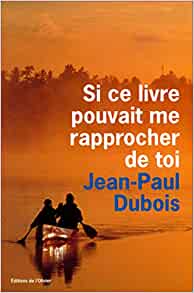
Posté le 26/01/2020 à 12:05
2009. Violette a récupéré une cassette
audio que l'antique lecteur refuse de lire. Sur la bande, un héritage
douloureux qu'elle s'empêche d'écouter depuis vingt-sept ans. En 1982, Violette
avait 10 ans et vivait avec ses parents, jusqu'à ce qu'un jour son père soit
victime d'un étrange malaise puis de maux de tête terribles qui ont entraîné
son hospitalisation. On a éloigné la fillette pour la "préserver" ;
on pensait bien faire, on lui a volé la mort de son père. Devenue adulte,
Violette souffre encore de n'avoir pas pu lui dire au revoir.
Un beau récit sur le deuil qui n'a pas
plu s'accomplir. La narratrice en est parfaitement lucide, qui dit que si sa
famille avait préféré France Inter à Europe 1, Dolto à Pierre Bellemare, elle
aurait pu faire ses adieux et entamer son travail de deuil. Cet éloignement et
cette dissimulation, s'ils nous semblent monstrueux aujourd'hui, étaient de
mise à l'époque, entraînant à l'âge adulte le traumatisme qu'on imagine. Jusqu'à
la libération salvatrice, quand on parvient à faire la paix avec ses fantômes.
En plus de sa vertu cathartique, ce roman nous tient par une nostalgie
distillée à petites touches, qui ne peut que toucher les lecteurs qui ont
dépassé les 45 ans : il ressuscite à merveille toute une époque, le Nesquik,
Michael Jackson et les premiers vidéoclips, le brushing impeccable d'Eddy
Mitchell et La dernière séance –
j'avais à peu près l'âge de Violette en 1982, j'ai frissonné sur Thriller et dansé
sur des chansons de Kajagoogoo.
Roman lu dans le cadre des
68 premières fois
Catégorie
: Littérature française
famille
/ deuil / mort / années 80 /
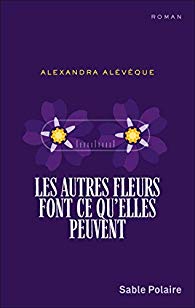
Posté le 26/01/2020 à 12:01
Jean Farel est un célèbre journaliste
politique, sa femme Claire une brillante essayiste féministe. Leur fils
Alexandre fait des études dans la prestigieuse université américaine de
Stanford. Tout semble réussir à ces trois personnages, malgré quelques failles
: Jean vient d'avoir soixante-dix ans mais s'entretient et parvient tout juste
à conserver sa place dans un milieu concurrentiel où les jeunes menacent leurs
aînés ; Claire étouffe dans sa vie de "femme de" et tombe amoureuse
d'un enseignant de son âge. Le couple s'apprête à divorcer quand Alexandre revient
brièvement à Paris. Rien de grave cependant, jusqu'au jour où une accusation de
viol vient faire basculer la vie de la famille...
Depuis la libération de la parole des
femmes et le mouvement MeToo, de nombreux romans sont publiés sur le thème du
viol et/ou du harcèlement. Au cours du récit une allusion est d'ailleurs faite
à l'affaire Weinstein. Toute la question est de savoir où est la vérité, et de
définir à partir de quand on peut considérer les faits comme relevant d'une
agression ou d'un viol - ce qui n'est pas la même chose. Karine Tuil ne prend
parti ni pour l'un ni pour l'autre, se bornant à relater les faits puis à en
donner les différentes versions ; dans une première partie qui souffre sans
doute de longueurs, elle met méticuleusement en place les différents acteurs du
drame, le père et la mère, personnages pris par leur carrière et
indubitablement peu présents auprès de leur fils, et le caractère d'Alexandre.
Elle met le même soin à reproduire les différents moments du procès. Un récit
glaçant de vraisemblance qui pose cette affaire de mœurs dans un contexte
français.
Catégorie
: Littérature française
journalisme
/ politique / intrigues / pouvoir / médiatisation / viol /
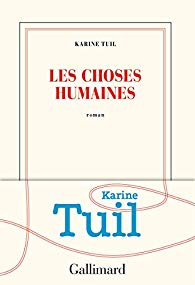
Posté le 26/01/2020 à 12:00
Dely Brahim est une petite ville située à
l'est d'Alger. On y a construit la cité du 11-Décembre, où la vie est paisible,
tandis que les enfants jouent au foot sur le terrain vague au milieu du
lotissement. Un beau jour, deux généraux débarquent, plans à la main,
revendiquant la propriété de la parcelle sur laquelle ils comptent bien se
faire bâtir deux belles villas. Mais c'est sans compter avec l'obstination de
trois enfants du quartier, Inès, Jamyl et Mahdi, qui refusent qu'on leur prenne
leur terrain. Ils font fuir les deux hommes et entrent en résistance, bientôt
rejoints par de nombreux autres enfants du quartier...
Face à une telle détermination, un tel
courage, l'administration et les adultes se révèlent parfaitement impuissants.
Que faire contre un groupe d'enfants qui refusent d'obéir à la loi ? Ni l'Etat
ni l'armée n'y peuvent rien. A travers ce récit de résistance, il y a aussi une
belle galerie de portraits, des généraux et des colonels en retraite, des pères
et des mères, et l'ancienne moudjahida qui a combattu les Français pendant la
guerre d'Algérie.
Catégorie
: Littérature française
Algérie
/ enfant / pouvoir /
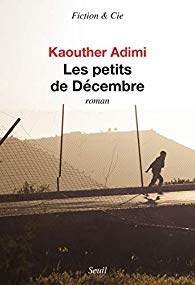
Posté le 26/01/2020 à 11:55
Jeanne a 39 ans et apprend qu'elle a un
cancer du sein. Elle entame seule les traitements, tandis que son mari est aux
abonnés absents, effaré à l'idée que Jeanne devienne chauve. La voilà seule
pour affronter le K. Au cours d'une séance de chimio, elle fait la rencontre de
trois femmes, Assia, Brigitte et Melody. Seule la première n'est pas malade,
mais épaule sa compagne Brigitte. Les trois femmes, qui sont comme Jeanne en
mal d'enfant, l'accueillent dans l'appartement qu'elles partagent et lui
apportent le soutien et la drôlerie dont elle a besoin. Elles finissent par lui
faire une proposition absolument rocambolesque, puisqu'après tout elles n'ont
rien à perdre...
La première partie du roman narre le
parcours de Jeanne à l'hôpital, les séances de chimio, l'indifférence atroce de
son mari. On pourrait se sentir embarqué dans un récit sur la maladie et ses
conséquences, entre effets secondaires et modifications du quotidien. Mais
l'arrivée de Brigitte, de sa gentillesse et de sa joie de vivre nous épargne le
pathos et fait glisser le roman dans une saga féminine qui n'est pas sans
rappeler Thelma et Louise. Ou comment des femmes "ordinaires" – il
n'y a rien de péjoratif dans l'adjectif – deviennent capables d'extraordinaire.
Comme les deux héroïnes de Ridley Scott, ces quatre femmes sont prêtes à tout
puisqu'elles n'ont plus rien à perdre, elles sont allées trop loin pour faire
demi-tour. Comme elles, elles vont sombrer dans l'illégalité, et cela les
effraie tout autant que cela les galvanise. On éprouve donc beaucoup de
sympathie pour ces personnages, même si l'histoire prend un tour qui n'est pas
toujours crédible. Peu importe, on se laisse emporter par la joie féroce de la
transgression.
Catégorie
: Littérature française
maladie
/ amitié /
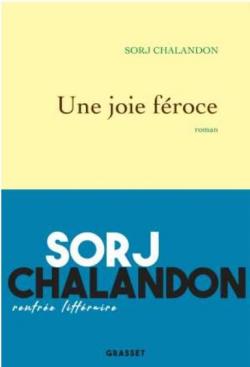
Posté le 26/01/2020 à 11:21
Sully
Price, jeune inspecteur vétérinaire, est envoyé en mission en pleine campagne
belge pour aller contrôler une exploitation agricole, suite à des dépôts de
plainte. Il est à peine arrivé qu'une tempête hivernale de forte amplitude
s'abat sur la région, le contraignant à rester plus longtemps qu'il n'en avait
l'intention. Il est aidé par le patron du bar du coin et par sa serveuse si
attirante et tâche d'avancer dans son enquête, alors que la neige rend les
conditions de circulation de plus en plus difficiles et oppressantes.
Un coin
perdu des Flandres, la neige et le froid, de gros 4x4 qui seuls peuvent
parvenir à rouler, des habitants rudes, un diner perdu mais accueillant, on se
croirait dans le Montana en plein hiver. La quatrième de couverture évoquait
"un western polaire, moderne et poétique". Certes, ces éléments lui
donnent tout du western, et on pouvait s'attendre à un Pete Fromm belge. Las,
le récit, pour intéressant qu'il soir, souffre d'un discours interminable sur le
bien-être animal, les conditions de vie des animaux d'élevage pour la
consommation humaine, des considérations sur le végétarisme, et des réflexions parfois
très techniques sur les réglementations… Deux kilos deux, c'est le poids que
doit faire un poulet pour être bon à manger. On peut comprendre l'objectif de
Gil Bartholeyns de sensibiliser son lecteur à une réalité que le collectif L214
a largement contribué à faire découvrir, et qui rendrait tout le monde vegan,
mais fallait-il pour autant détailler à ce point les diverses règlementations
pour nous prouver que santé et bien-être de l'animal sont deux concepts bien
différents, et que seul le premier critère est pris en compte ? Cela se fait au
détriment d'une histoire qui aurait été passionnante, d'autant que les
personnages sont bien campés et que l'ambiance, hivernale à souhait, nous fait
découvrir un pan méconnu de la Belgique.
Catégorie :
Belgique / hiver / animal / maltraitance /
cruauté /
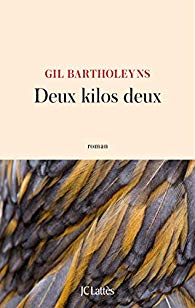
Posté le 26/01/2020 à 11:13
Rose,
psychologue, part faire une croisière avec ses deux enfants, Emma et Gabriel.
Un soir, une centaine de migrants nigériens sont pris en charge par l'équipage.
Rose décide d'aider et fait la connaissance de Younès à qui elle donne, sur une
impulsion, le téléphone portable de son fils, lequel passe le reste de la
traversée à le chercher désespérément. Younès suit ses compagnons d'infortune
tandis que Rose et ses enfants rentrent à Paris avant de s'installer à Clèves,
dans le pays basque, avec leur mari et père. Rose s'y installe comme thérapeute
mais n'oublie pas Younès, lequel se manifeste en utilisant le téléphone de
Gabriel.
Curieuse
femme que cette Rose, qui agit impulsivement, et semble douée d'un don
particulier qu'elle va vraiment exploiter quand elle va s'installer à Clèves.
Elle éprouve pour Younès un mélange d'attirance et de dégoût, et une probable
culpabilité. Elle est censée le retrouver à Paris, et se contente de le suivre
dans les rues sans se manifester ; elle est prête ensuite à traverser la France
pour le récupérer à Calais, et le ramener chez elle où il va passer plusieurs
mois, sans d'ailleurs que son mari ne trouve grand-chose à en dire. Que
cherche-t-elle à réparer ? Marie Darieussecq ne donne pas de réponse, mais à
travers son personnage elle dit très justement ce sentiment d'impuissance et de
honte mêlées qui peut nous prendre, à voir ces images terrifiantes
d'embarcations remplies jusqu'à la limite de la submersion par des centaines de
migrants dont une partie ne verra jamais l'Eldorado convoité. Un Eldorado dont
nous, spectateurs, savons trop bien de quel mirage il relève. Rose, elle, a
agi.
Catégorie : Littérature française
famille / migrant /

Posté le 26/01/2020 à 11:11
Automne 1939. La France est entrée en guerre
contre l'Allemagne. Jacques Jaujard, directeur du musée du Louvre, décide de
déménager les collections du musée pour les mettre à l'abri de la convoitise
des Allemands. Trois femmes liées au directeur racontent via leurs journaux
intimes cette migration clandestine : Marcelle, la femme de Jaujard, qui dans
le même temps, à 39 ans, tente tout pour avoir un enfant ; Carmen, fille d'un
couple employé au musée et filleule de Jaujard, qui attend impatiemment
l'arrivée de sa puberté ; Jeanne Dubois, comédienne et ancienne maîtresse de
Jaujard, qui vient de subir un avortement et se fait embaucher par les
Allemands pour faire l'inventaire des œuvres restantes au Louvre, et de celles
qu'ils récupèrent...
Histoire
de l'art et féminité, voilà les deux fils conducteurs de ce récit. Ces trois
femmes sont toutes trois passionnées d'art : la première, à cause de son statut
d'épouse de, a le privilège de fréquenter souvent les œuvres et en dehors de
l'ouverture des lieux au public ; la deuxième, malgré son jeune âge, a grandi parmi
tableaux, gravures et sculptures et leur témoigne une solide admiration ; la
troisième enfin, qui a mis fin à sa carrière sur les planches, a une formation
d'historienne de l'art. Mais toutes trois sont aussi et avant tout des femmes,
avec leur désir amoureux, leur désir d'enfant, leur envie de devenir femme. Carmen
en particulier, qui se désole que les femmes peintes par Watteau, Ingres,
Manet, n'aient pas de poils, cherche désespérément si les siens vont pousser et
ses règles finir par arriver. Il y a bien Courbet, et L'origine du monde, mais il n'est pas au Louvre, lui répond son
parrain qu'elle a interrogé. La peinture
vue par les yeux d'une adolescente en pleine poussée hormonale est tout
bonnement réjouissante. Marcelle, elle, a l'esprit plus pratique : "C'est
très contrariant une peinture de grand format, mais quand son auteur est
pauvre, ça vire tout nûment à l'emmerde.", écrit-elle en évoquant un
tableau de Géricault, qui enduisait ses toiles de bitume, qui ne sèche jamais.
L'œuvre va donc devoir être transportée telle quelle, quitte à se coincer dans
les fils électriques. Josselin Guillois mêle avec brio amour de l'art et
détails concrets, et restitue parfaitement l'ambiance d'une époque où on boit
un bon coup avant de prendre le volant d'un camion qui transporte des œuvres
inestimables. Un grand plaisir de lecture.
p.
32 :
-
Gérard, mes phares marchent pas.
-
Les miens non plus.
-
Demande à M. le directeur d'en faire poser des nouveaux, c'est le musée qui
facture, dit le patron.
-
Vous êtes cons.
-
Pourquoi ?
-
Je vous rappelle qu'avec le balck-out on n'a pas le droit d'allumer nos feux.
-
Avais oublié.
-
Je parie que tous phares éteints je roule plus vite que toi. 1000 francs ?
-
Tenu !
-
Tu porteras quoi toi ?
-
Des souliers cirés.
-
Dans le camion ducon !
-
Ah, des toiles d'Italie je crois."
p.
119 : "Nous sommes en mission pour parrain, pour sauver les collections
françaises, pour sauver la peinture, et c'est le printemps, le plus beau
printemps du monde. Non ce que je veux dire c'est que pas une fleur nous salue,
ni nous encourage, ou nous remercie, rien dans les fleurs ne s'alarme, parce
qu'elles sont indifférentes au sort des peintures qui pourtant, souvent, les
prennent comme modèles."
Catégorie : Littérature française
art / peinture / guerre / France / Allemagne /
femme /
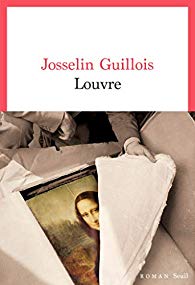
Posté le 26/01/2020 à 11:09
Wàipo,
la grand-mère de la narratrice, est morte chez elle, à Savannakhet au Laos. La
jeune femme s'y rend avec son frère et sa mère, afin d'organiser et d'assister
aux obsèques. La famille y retrouve le grand-père, dont la narratrice découvre
l'extraordinaire beauté un peu fanée. Elle parle à peine le vietnamien, se sent
dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge d'un an, tout aussi étrangère
qu'en France. Ce qui n'est pas le cas de son frère, de dix ans son aîné, qui
pleure la mort de son aïeule et peine à sortir de son apathie.
Ce
récit raconte une quête de ses origines et de son identité. Bien sûr, il y a la
culture et la langue, les traditions, mais surtout une découverte de soi, à
travers une sexualité libre et sans complexe, dans laquelle le regard, érotisé,
joue un rôle fondamental – la narratrice est d'ailleurs assistante d'n célèbre
photographe. En témoigne la rencontre inaugurale du récit, à Paris, avec un
homme fasciné par son visage ; de même va-t-elle prendre en filature un grand
Occidental installé dans le village, qui la dévore des yeux. Plaisir des sens
avant tout, sans attachement, puisque le seul vrai amour qu'elle éprouve est
pour son frère, qu'elle tente par tous les moyens de sortir de son indolence.
Ce roman est fin et délicat, mais n'exclut pas une forme de violence : bien
cachée sous son visage lisse, elle s'exprime à travers son désir pour les
hommes, ses envies de transgression et son amour fraternel.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
Catégorie : Littérature française
Laos / exil / famille / amour / regard /
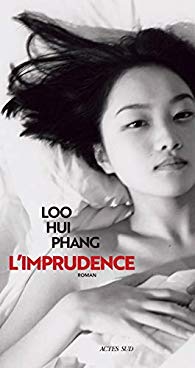
Posté le 26/01/2020 à 11:08
Raphaëlle
et Antoine se sont connus pendant leurs études. Ils se sont aimés, disputés,
séparés, retrouvés. Finalement, l'entrée dans la vie active scelle la fin de
leur relation, quand Raphaëlle trouve un emploi tandis qu'Antoine multiplie les
lettres de motivation et les entretiens de recrutement.
Ils ont
vécu ensemble comme on fait la fête, avec cette insouciance qui fait oublier
les lendemains. Sauf que ceux-ci ne chantent pas toujours : au réveil, on est
abruti, sonné, et la réalité vous revient en pleine face. Lola Nicolle raconte
tout cela, de façon un peu déconstruite, suivant un fil narratif non linéaire,
au risque de perdre son lecteur. Elle dit les enthousiasmes, les déceptions,
les espoirs, les tensions que peut connaître un couple confronté à la réalité
du chômage de cette génération née dans les années 80. C'est un récit sensible,
avec des passages un peu désenchantés mais d'une justesse absolue sur le monde
qui change, et pas forcément en bien. Je pense par exemple à ce que l'auteur
écrit sur les centres villes désertés par les habitants, dont une partie des
appartements est dévolue à la location saisonnière : "Bientôt les grandes
villes européennes ressembleraient à des halls d'aéroport. Le chant des valises
à roulettes résonnant chaque matin, chaque soir, dans les rues bien endormies
des capitales." Une sorte d'effilochage du monde, et des sentiments. Pour
ne pas y succomber, il vaut mieux prendre la fuite.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
Catégorie : Littérature française
couple / désillusion / rupture / ville / chômage
/
Posté le 26/01/2020 à 11:07
Les
Caradec achètent un appartement dans un éco quartier de la région parisienne. A
eux la nature, le calme, le mode de vie écolo ! Une fois le stress du déménagement
passé, place à l'enthousiasme. Mais au plaisir des débuts succède vite
l'agacement, quand le quartier se peuple petit-à-petit de vosins plus ou moins
sans gêne et indélicats, tout comme le gros chat roux sur lequel Charles
Caradec a des envies de meurtre. Il se met à déprimer, alors que la narratrice,
elle, peine à accepter que leur choix de vie n'était peut-être pas judicieux.
Et puis le chat est retrouvé éventré, les voisins font refaire une terrasse
dont les travaux n'en finissent pas, la vie dans le lotissement écolo devient
un enfer...
Récit
satirique, roman de la désillusion, tout devient insupportable, les fêtes qui
durent tard dans la nuit, les liaisons adultères qu'on ne peut ignorer, les
aboiements du chine, les disputes. C'est féroce, souvent drôle, jusqu'au moment
où le récit prend un virage polar, avec la disparition de la très agaçante
Annabelle. Un virage mal négocié car l'histoire devient alors confuse, avec un
final abrupt.
Catégorie : Littérature française
écologie / voisinage / couple /
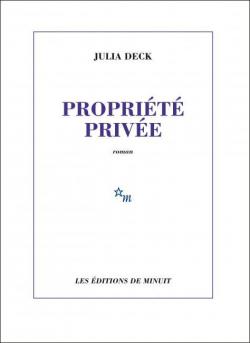
Posté le 26/01/2020 à 11:04
Emma,
la compagne américaine de Mathieu, le soutient lorsque ce champion de ultra-trail
et d'expéditions en haute montagne décide de tenter l'ascension du K2 au
Pakistan pour le redescendre en snow board. Elle compte profiter de l'occasion
pour enrichir sa thèse de sociologue sur la prise de risques. En toile de fond,
elle tente de résoudre le mystère qui entoure la mort de la mère de Mathieu,
partie en expédition avec son père, dont le corps vient d'être retrouvé vingt
ans plus tard.
Mélanie
Valier connaît bien la haute montagne et ne se montre pas avare des multiples
détails qui font le charme des récits d'expédition en haute montagne, dont je
suis friande. Equipement, aléas météorologiques, ascension sans oxygène,
exploit surhumain, dépassement de soi, et surtout, l'ambiance au sein de
l'équipe des grimpeurs et de leurs compagnons qui restent au camp de base, tout
est là pour donner à ce récit toute sa véracité. L'enquête sur la mort de la
mère de Mathieu, dont la résolution aura des conséquences importantes sur la
vie du jeune homme, donne au roman un côté polar qui n'est pas déplaisant.
Cette aventure qui se déroule principalement au pied de l'un des "huit
mille" mythiques se lit avec grand plaisir.
Catégorie : Littérature française
haute montagne / alpinisme / famille /
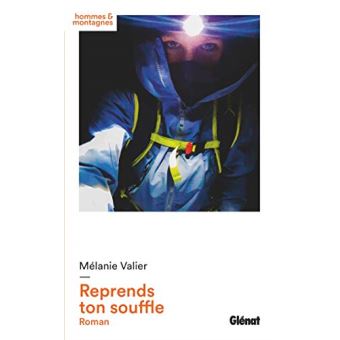
Posté le 11/12/2019 à 15:00
Léna participe
à une visite très encadrée de la ville de Pripiat, dans la zone irradiée par la
catastrophe de Tchernobyl. Elle y a vécu enfant, et l'a quittée avec ses
parents et sa grand-mère le lendemain de l'explosion, pour aller s'installer en
France, à Cherbourg. Elle a laissé derrière elle son amour d'enfance, Ivan,
dont elle est sans nouvelles depuis vingt ans, qu'elle n'a pourtant jamais
oublié.
C'est le souvenir
d'Ivan, justement, son absence, l'ignorance même de savoir s'il est vivant, qui
a suscité la décision de Léna de revenir sur les lieux de son passé. Ivan qui
lui écrit des lettres sans jamais pouvoir les lui envoyer, puisqu'il ne sait où
elle vit. Léa entreprend une quête vers son passé : elle part à la recherche de
son amour perdu, mais aussi de ses racines, qu'incarnait sa grand-mère Zenka et
qu'elle retrouve en parlant le russe et l'ukrainien. De facture assez
classique, avec une longue partie centrale consacrée aux vingt ans que Léna a
passés en France, c'est un roman de la nostalgie, de l'amour perdu, de la
difficile acclimatation à une autre langue, une autre culture, qui permet
également de découvrir "de l'intérieur" les circonstances de
l'explosion de la centrale nucléaire, la façon dont elle a été traitée par les
autorités russes et ses conséquences pour les habitants de la région. Le récit
est bercé par une sorte d'onirisme incarné par les deux santons sculptés par
Ivan pour Léna, et qui trouve un joli point d'orgue dans les retrouvailles de
ces deux êtres qui n'ont jamais cessé de s'aimer : "Ils avaient encore
plus d'une demi-vie à partager : une demi-éternité".
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Littérature française
catastrophe nucléaire / Tchernobyl /
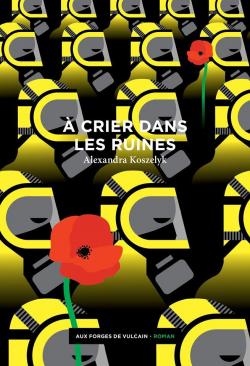
Posté le 11/12/2019 à 14:54
Marwan, comme ses deux frères, est fils d'un
couple marocain. Il se sent plus français que marocain, et peine à comprendre
pourquoi son père, décédé subitement, demande à être enterré à Casablanca, ni
pourquoi c'est lui qui a été désigné pour accompagner le cercueil. Tout juste
quitté par sa compagne, il doit à la fois assumer le deuil de son père et le
retour dans un pays qu'il connaît bien mal.
Marwan
est écartelé entre deux cultures, trop marocain pour la France, et trop
français au Maroc où on lui reproche de parler arabe avec l'accent algérien. Ce
voyage qu'il entreprend contre son gré va l'amener à lever le voile sur des
épisodes de souffrance qu'ont vécu ses parents et l'ami de son père, installé
lui aussi en région parisienne. C'est un beau roman plein de pudeur, et sans
pathos, sur la famille et ses secrets bien sûr, sur les liens familiaux,
l'amitié, l'identité, et ce qu'est concrètement ce que l'on nomme l'intégration
et qui, finalement, ne veut pas dire grand-chose.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
Maroc / famille / identité / immigration /

Posté le 11/12/2019 à 14:52
Blanche a quitté le Rwanda en 1994, après le
génocide. Elle est désormais infirmière à Bordeaux, où elle partage sa vie avec
son mari et son fils. Elle finit par rendre visite à sa mère au Rwanda. Les
retrouvailles ne sont pas faciles, la mère porte en elle un passé lourd, deux
enfants nés de deux pères différents qui l'ont abandonnée, l'un d'eux suicidés.
Blanche s'interroge sur son identité, puisqu'elle est fille d'un Blanc qu'elle
va tenter de retrouver.
Le
récit est raconté par plusieurs voix, celle de Blanche bien sûr, mais aussi
celle d'Immaculata, puis celle de Stokely, son petit fils. Il fait fi de la
temporalité, au risque de perdre son lecteur, et se réfère aux traditions
rwandaises. Malgré tout le respect que l'on doit aux victimes du génocide, je
n'ai pas réussi à adhérer à cette histoire déconstruite, gênée également par
les nombreuses références aux proverbes rwandais ; je n'ai pas été sensible à
la recherche des racines qui anime chacun, et enfin j'ai peiné à parvenir au
bout de ce roman.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
Rwanda / famille / génocide
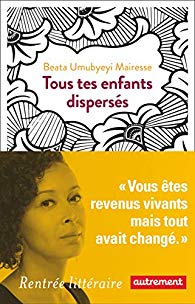
Posté le 11/12/2019 à 14:49
Le père de Marie-Emmanuelle est diplomate en
poste à Berlin, sa mère femme au foyer. Celle-ci peine à se satisfaire de la
vie qui est la sienne, sans emploi à part être une parfaite maîtresse de
maison. Parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle se sent prisonnière des
conventions sociales, parce qu'elle n'aime rien tant que nager dans l'océan,
par tous les temps, elle part. Et revient. Et repart encore. La narratrice
grandit donc entre un père absorbé par son travail et une mère fugueuse. Malgré
ces abandons constants, elle parvient à se construire, à vivre sa vie de femme.
Elle sera même une présence constance et chaleureuse auprès de ses parents
vieillissants revenus en France.
L'amer,
en langage maritime, c'est un point de repère fixe, identifiable sans
ambiguïté. Un phare, un clocher d'église… Emmanuelle Grangé eût intitulé son
roman "L'amer remarquable" qu'on aurait cru à un jeu de mots cruel de
l'inconscient, tant la mère de la narratrice n'en est justement pas un, d'amer.
Mais elle a mis le terme au pluriel. Qui sont donc les repères qui ont permis à
la petite Marie-Emmanuelle de grandir et de devenir une femme accomplie ? Le
roman n'y répond pas, l'auteur ne cède jamais à l'analyse psychologique de
parents absents ; en revanche, il se dégage de ce récit un amour inconditionnel
pour cette mère fantasque et irresponsable qui, finalement, fait ce qu'elle
peut pour aimer ses enfants, maladroitement.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
famille / fugue /

Posté le 11/12/2019 à 14:46
Environs
de Montréal. Paul Hansen est en prison, où il partage sa cellule avec Patrick
Horton, un Hell's Angel coupable de meurtre. Il supporte tant bien que mal la
promiscuité avec cet homme et demi qui défèque chaque soir avec constance et
sans aucune gêne, ses conversations indigentes et sa capillophobie, tandis
qu'il se remémore son passé, entouré de ses trois fantômes : son père, pasteur,
sa femme Winona, pilote de Beaver, et sa chienne Nouk.
Petit
à petit, nous découvrons l'histoire de Paul Hansen, qui était concierge factotum
d'une résidence de luxe. Paul purge ses deux années de peine sans jamais
accepter de faire amende honorable, et pour cause : le crime qu'il a commis
était une conséquence tout à fait logique et entendable de ce qu'il a vécu. L'auteur
a de la sympathie pour son personnage, le lecteur aussi ; et c'est tout le
talent de Jean-Paul Dubois de nous narrer à petites touches cette lente montée
vers le drame, en y alliant un humour d'une grande finesse quand il raconte la vie
en cellule avec son compagnon. Et puis, sous la plume de Jean-Paul Dubois, nous
partons au Danemark, dans le Jutland paternel où une église s'est ensablée ;
nous survolons les rivières et les lacs au-dessus de la région de Montréal,
conduits par Winona Mapachee, mi-algonquine mi-irlandaise, qui nous fait battre
le cœur tout autant que celui de Paul. Ce livre est une merveille.
Catégorie : Littérature française
prison / vengeance / amour /
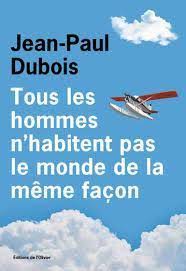
Posté le 01/11/2019 à 18:55
Le
Paradis, c'est une ferme isolée tenue d'une main de fer par Emilienne, secondée
par Louis, le commis, qu'elle a embauché pour le protéger de la violence de son
père. Elle a la charge de ses deux petits enfants, Blanche et Gabriel, qui ont
perdu leurs parents dans un accident de voiture. Blanche rencontre Alexandre à
l'école. Leur amitié se transforme progressivement mais sûrement en un amour
d'une évidence et d'une force qui rend Louis malheureux et jaloux. Jusqu'à ce
qu'Alexandre décide de quitter le village pour faire des études de commerce,
laissant une Blanche désespérée, incapable qu'elle est de quitter sa terre.
Désespérée,
abattue, Blanche s'enferme dans sa chambre après le départ d'Alexandre. Cécile
Coulon ne nous épargne rien du désespoir absolu qui va toucher par deux fois la
jeune femme, qui lui fait refuser toute nourriture et manger des araignées.
Cette Blanche-là est entière et pure, entièrement dévouée au Paradis et à son
amour pour le traître Alexandre ; si elle a pardonné la première trahison
d'Alexandre, elle ne pourra passer outre la deuxième, et s'empêcher d'ourdir sa
vengeance. Mais nul soulagement là-dedans : Blanche reste sur sa terre qu'elle
a sauvée de la convoitise des promoteurs immobiliers, y trouvant la consolation
de continuer de l'entretenir. C'est sa terre qui la tient, tandis que Gabriel
connaît quant à lui un bonheur qui lui restera toujours étranger. Dans le récit
de Cécile Coulon il y a la violence des hommes et celle de la nature, et une
sorte de fatalisme contre lequel on ne peut pas davantage lutter que contre
l'éternel retour des saisons, la froidure de l'hiver et les enfants des autres
qui naîtront.
Catégorie : Littérature française
campagne / amour / trahison /
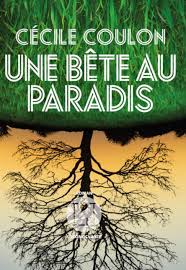
Posté le 01/11/2019 à 18:53
Les
Fontaines est un petit hameau niché au pied des Trois Gueules. André s'y
installe comme médecin généraliste. Il est rejoint par Bénédict, le fils qu'il
a eu d'une brève liaison au cours de ses études, un enfant qui voue à son père
une admiration sans bornes. Devenu adulte, Bénédict épouse Agnès, dont il aura
une fille, Bérangère. Laquelle tombe amoureuse de Valère, un jeune garçon du
cru. Leur amour va bouleverser toute la famille…
D'un
côté il y a le village, qui s'étend sous la houlette des frères Charrier,
exploitants de la carrière. De l'autre côté des montagnes, la ville, celle où
part régulièrement Agnès, qui ne se sentira jamais vraiment d'ici,
contrairement à son mari. Au village, on vit sous l'ombre des montagnes, on ne
se départit pas d'une certaine superstition et d'une forme de fatalisme, celui
qui n'a donné au couple qu'un seul enfant, et qui fait que, quinze ans plus
tard, Agnès tombe enceinte contre toute attente. On retrouve dans ce roman les
thèmes chers à l'auteur, la violence des sentiments, le drame qui couve, et la
nature omniprésente, qui conditionne le destin des hommes.
Catégorie : Littérature française
famille / campagne / jalousie /
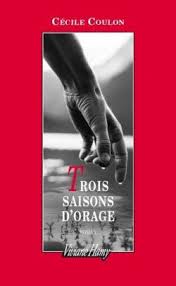
Posté le 01/11/2019 à 18:52
A la
recherche du brontosaure perdu. C'est son but ultime, son Graal, à Stan,
paléotologue, qui a obtenu de justesse les crédits pour partir en expédition
quelque part dans les Alpes franco-italiennes pour y trouver la grotte où selon
la légende se trouverait le squelette de l'animal préhistorique qui pourrait
faire sa gloire. Accompagné de son ancien assistant Umberto, d'un jeune
allemand et d'un guide, il va passer plus de deux mois à chercher la grotte.
Evidemment,
on se doute que les choses ne vont pas être simples : l'été est court en haute
montagne, et quand l'emplacement de la grotte est enfin détecté, il faut
creuser six mètres de glace pure et dure comme du granit. Stan fait preuve d'un
entêtement qui frise la folie – sa carrière est en jeu, et sans squelette, il
retournera à son obscur bureau et à ses fossiles. Mais c'est plus que cela :
son obstination, au mépris de tous les dangers, des avertissements du guide,
est une sorte de revanche de son enfance où ses camarades moquaient sa passion
des pierres et de l'histoire. Et comme souvent dans les récits de haute
montagne, tout va virer à la catastrophe, le froid arrive, et de ses doigts
crochus va avoir raison de l'entêtement des hommes. C'est un beau récit, âpre,
magnifiquement raconté, où l'auteur donne à voir des paysages somptueux, et tout
ce que la montagne revêt de beau, d'implacable et de cruel, où les hommes
meurent d'avoir voulu la dominer.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
haute montagne / paléontologie /
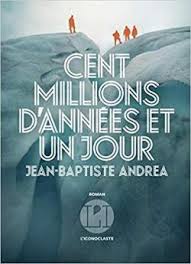
Posté le 25/10/2019 à 18:00
Dolorès
quitte son mari et affronte seule les fins de mois difficiles, et
l'indifférence de son fils qui lui préfère son père et lui dit, avec la
brutalité et l'égoïsme de l'enfance, qu'il ne l'aime pas. Elle finit par
s'inscrire sur un site de rencontre et se met à fréquenter Jean. Qui va la
quitter à son tour.
Quitter
ou être quitté. Aimer, puis ne plus aimer, parce qu'on est trop différents,
parce que la vie à deux relève parfois d'une alchimie qui se ne fait pas.
Dolorès s'interroge, souffre, déprime, et se montre parfois d'une
intransigeance aussi forte que celle de ses partenaires. Elle est enfermée dans
un processus de répétition dont elle ne sort d'autant moins qu'elle semble
assez passive, se maintenant dans une position de victime qui l'empêche de se
remettre en question. Difficile, à mon avis, d'avoir beaucoup de sympathie pour
ce personnage, ainsi que pour les autres, qui sont tous assez monstrueux à leur
façon. A commencer par le père, une espèce de brute mal dégrossie, un peu
pervers, et le fils, dont la cruauté m'a semblé peu vraisemblable. Sans parler
du deuxième compagnon, encore plus brut de décoffrage que le premier. Par
ailleurs les choix de l'auteur, avec un point de vue unique, celui de Dolorès,
une narration chronologique au présent, l'omniprésence des objets personnifiés,
qui devient à la longue assez pesante, donnent au récit un aspect longuet et
répétitif auquel je n'ai pas adhéré.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
couple / rupture / solitude / mère-enfant /

Posté le 25/10/2019 à 17:57
Paul
Lerner, écrivain en perte de vitesse, a quitté Paris pour la Bretagne avec sa
femme et ses deux enfants. Journaliste à L'Emeraude,
le quotidien local, il s'interroge sur son avenir littéraire et revient sur les
allers-retours accomplis au cours de sa carrière entre la région de Saint-Malo
quittée pour l'animation parisienne et retrouvée après des déconvenues.
L'horizon semble tout aussi bouché que peut parfois l'être le ciel breton
certaines journées d'automne, il porte avec douleur ses 45 ans et ses maux de
dos et découvre l'infidélité de sa femme.
Quelle
est la part de fiction et la part de réalité dans ce récit où Paul Lerner
semble indéniablement incarner le double littéraire de l'auteur ? Ceux qui
connaissent bien sa biographie pourront s'amuser, peut-être, à retrouver dans
le roman des éléments autobiographiques. L'important n'est sans doute pas là,
mais réside plutôt dans les réflexions du protagoniste sur les habitants du
cru, sur le travail de journaliste qui se démène comme il peut pour donner
corps à une actualité qui relève parfois de la rubrique des chiens écrasés, sur
les liens familiaux, sur ces paysages bretons et l'omniprésence de la mer. Le
roman se lit agréablement, même si l'on peut se sentir parfois un peu perdu
entre les périodes parisiennes et bretonnes que le narrateur mélange ; l'effet
est sans doute voulu, peut-être à l'instar de ces parties de tennis où la balle
passe d'un côté du filet à l'autre sans que parfois on ne sache plus très bien qui
a fait le service. Au dernier set, tout s'emballe, Lerner n'en est plus à
cogiter sans fin sur son avenir de romancier compromis, cette fois il faut
reprendre l'avantage, et cette accélération du rythme est la bienvenue dans un
roman qui pêche parfois par excès de longueur.
Catégorie : Littérature française
Bretagne / écrivain / famille / adultère /
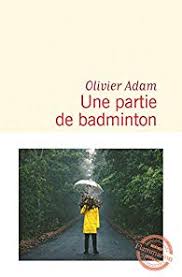
Posté le 14/10/2019 à 14:59
Jeff,
le petit ami de Kate est mort dans un attentat en Israël. Soucieux de l'épargner,
sa famille, et surtout sa mère, lui cachent l'événement jusqu'à ce qu'elle le
découvre, quelques semaines plus tard, dans la presse.
Quelle
étrange idée qu'a donc la mère de Kate ! Et que cela semble donc bien peu
crédible ! N'importe quel parent bien attentionné n'aurait jamais fait une
chose pareille, et aurait au contraire accompagné sa fille dans ce douloureux
processus du deuil. Mais attentionnée, la mère de Kate ne l'est pas, c'est le
moins que l'on puisse dire. Elle est si toxique que c'est leur relation qui
prend le pas sur le chagrin de Kate, et c'est d'ailleurs paradoxalement cette
thématique qui donne un peu de force à un roman qui m'a paru un peu creux au
demeurant, écrit dans une langue parfois poétique mais souvent un peu ampoulée,
qui abuse des métaphores et des effets de style : "Aussi lui prouvent-ils
leur amour en la protégeant de leur assourdissant silence, tendant sous ses
pieds le trou noir du déni, et rattrapant au vol toutes les balles
perdues." Kate converse avec le fantôme de Jeff, lui raconte une scène où
un père maltraite son enfant dans un restaurant, cela n'en finit pas et on se
demande ce que l'auteur veut nous dire, de ces enfants mal aimés, de ces
parents pervers, à part que peut-être son ami a vécu cela aussi, comme elle :
ce roman est tout autant l'histoire de ces enfants maltraités que celui du
deuil. Le roman se rattrape tout de même dans ses dernières pages, lorsqu'enfin
Kate ne vit plus avec le fantôme de Jeff, qu'elle a cessé de l'attendre, même
si, quand on a fermé le livre, on reste dubitatif sur ce que l'on vient de
lire.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
mort / famille / maltraitance /
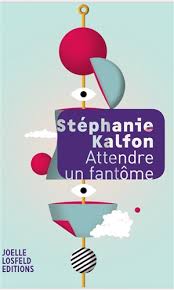
Posté le 14/10/2019 à 14:58
Il
fait chaud cet été-là, dans le camping des Landes où Léonard termine ses
vacances avec sa famille. Oscar est mort une nuit, étranglé par des cordes de
balançoire, tandis que le jeune homme le regardait mourir sans intervenir.
Après avoir, dans un geste qu'il ne s'explique pas, enterré le corps sur la
plage, le jeune homme traîne son ennui et son mal être, sa culpabilité aussi,
dans le camping. Puis il rencontre Luce, qui fréquentait Oscar, qui lui plaît
sans qu'il n'ait jamais osé l'aborder.
Le récit, court, se tient sur quarante-huit
heures. Il est, pour l'essentiel, l'illustration d'un mal être adolescent : Léo
a du mal à se lier, se sent mal dans son corps et avec les autres, s'estime
incompris de ses parents. Rien de plus classique, y compris ses premiers émois
amoureux et sa première fois, bien moins grandiose que ce dont il rêvait. Ce
pourrait être l'histoire d'un adolescent devenu cet été-là un homme, écrit
probablement à la lueur de souvenirs ou d'expériences personnels, mais il y a
la mort d'Oscar qui va le pousser à intervenir trop tard, et de travers. A la
lecture, j'ai pensé à L'étranger, à
cause du soleil écrasant, à cause de l'absurdité du comportement des hommes, sauf
que, contrairement à Meursault, Léo n'a pas tué, il s'est contenté de ne rien
faire. Non assistance à personne en danger, voilà la responsabilité réelle du
jeune homme. Mais ce qui aurait été intéressant, et qui aurait fait de ce récit
quelque chose de plus profond, c'est que Léo s'interroge sur sa passivité et
sur son intervention tardive, inutile et lourde de conséquences. Sur son désir
inconscient d'être considéré comme l'assassin du garçon dont il a dissimulé le
corps.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
vacances / adolescence / mort / jalousie /
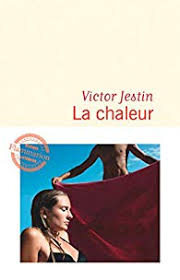
Posté le 14/10/2019 à 14:52
Paris,
1885. Le professeur Charcot officie à l'hôpital de la Salpétrière, qui
accueille de nombreuses femmes soignées pour hystérie. Il est secondé par une
nombreuse équipe médicale, dont Geneviève, une infirmière admirative du grand
homme. Elle prend en charge Eugénie Cléry, placée là par son père qui a
découvert qu'elle est capable de voir les défunts et de les entendre. Eugénie
voit apparaître le fantôme de Blandine, la sœur de Geneviève, disparue des
années plus tôt. De quoi ébranler les convictions de l'infirmière…
Ce
roman mêle très habilement diverses thématiques : le statut des femmes à la fin
de ce 19ème siècle si rigoriste, dans une société patriarcale si
prompte à les enfermer dès lors qu'elles s'écartent de la place qu'on leur a
assignée ; l'internement abusif ; les conditions d'hygiène et de soins
désastreuses – on traite les hystériques à coup d'éther et de compression sur
les ovaires ; enfin, la pratique du spiritisme fort à la mode à l'époque.
Solidement documenté, il fait la part belle à ces deux personnages très
romanesques que sont Geneviève et Eugénie, au milieu d'autres aliénées tout
aussi attachantes. Le roman se déroule sur les quelques jours qui précèdent le
fameux Bal des Folles, seul moment où ces femmes peuvent se montrer à un public
mondain qui espère secrètement assouvir sa curiosité morbide et assister en
direct à une fameuse "crise" ; à ce bal n'y sera d'ailleurs consacré
qu'un chapitre qui vient clore le récit dans un dénouement en apothéose. Sur la
forme, Victoria Mas nous offre un roman de facture classique, écrit dans une
langue très fluide et élégante, avec un usage des temps parfaitement maîtrisé.
C'est donc fort agréable à lire, même si on pourrait reprocher au roman un côté
un brin trop appliqué, un peu trop lisse.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
folie / hôpital /droits des femmes / 19ème
/
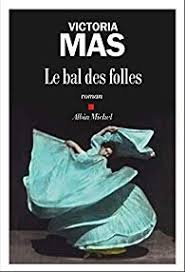
Posté le 14/10/2019 à 14:51
Jenny
Marchand, 15 ans, traîne son ennui et son mal être à Sucy-en-Loire. Rejetée par
ses camarades de classe, incomprise par ses parents, elle se réfugie dans la
lecture d'Harry Potter et les réseaux
sociaux. Un soir plus noir encore que les autres, elle poste un message dans
lequel elle fait part de son intention d'en finir. Elle reçoit une réponse pleine
d'empathie et se met à échanger, sur un réseau crypté, avec une jeune fille qui
semble parfaitement la comprendre. Elle fait ainsi la connaissance de Dounia,
qui lui parle d'un idéal qui lui permettra de trouver enfin une cause et une
identité. Elle devient Chafia Al-Faransi, et se met à porter le voile…
En
parallèle avec la progressive – mais rapide – entrée de Jenny dans l'islamisme
radical, on suit l'histoire de Saint-Maxence, le président vieillissant qui va
devoir céder sa place à son ancien poulain Benevento, qui l'a trahi pour un
engagement vers la droite dure. On ne peut s'empêcher de voir là, de façon
romancée, une partie de notre histoire politique. A travers ce qu'il nous
raconte, à travers une fine observation si plausible de ces jeunes filles
voilées de noir qui se rêvent en épouses martyres, ce roman s'ancre dans le
réel, profondément ; il est sans concession pour les petits arrangements avec
le pouvoir, et pour l'impuissance du gouvernement à régler le problème de
l'embrigadement de ces jeunes perdus et sans réelle existence, proies faciles
pour un Islam galvaudé et haineux du "kouffar". C'est ce que connaît
Jenny, qui, quand elle a enfin choisi quoi faire pour le Jihad, se dit
qu'"elle occupera une place à part dans le cœur des gens". Enfin,
elle existera, on la reconnaîtra. Je n'ai pu m'empêcher de songer au personnage
d'Adèle, dans le roman de Constance Rivière, Une fille sans histoire, que j'ai lu juste avant celui-ci : c'est
le même mal être adolescent, la même solitude, qui conduit à des actes graves.
Un premier roman violent, terriblement juste.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
terrorisme / fanatisme / Islam / adolescence /
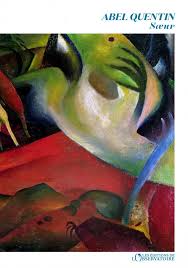
Posté le 14/10/2019 à 14:47
Abal,
13 ans, est venu du Liban avec ses parents et vit rue Léon à Barbès. Il mate
les seins de FEMEN qui ont leur bureau en face de chez lui, en fait profiter
des copains avant qu'on ne porte plainte contre toute la bande. Abal est puni,
doit consulter une psychologue qui lui "ouvre le dedans". Amoureux
d'une jeune fille voilée qui va disparaître du jour au lendemain, il raconte la
vie du quartier, Omar-le-Salaf, le "barbapapa" qui entreprend de
"nettoyer" les rues de la perversion occidentale, Gervaise la
prostituée qui se fait tabasser, la drogue et les jeunes employés dans les
"fours", la misère sociale et le destin tout tracé de ceux qui n'ont
pas eu la chance de naître du bon côté.
C'est
un récit un peu désespérant, aux influences multiples, un mélange de destins
contrariés dont on sort un peu sonné et passablement désenchanté. Car il n'y a
pas de rédemption pour tous ces gens que fréquente Abal : noir, métis ou blanc,
on finit battu à mort, on crève d'overdose ou d'Alzheimer. J'avoue avoir eu de
la peine à lire ce roman dont le sujet a mis à mal mon optimisme et mon espoir
en des lendemains meilleurs.
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois".
Catégorie : Littérature française
misère / pauvreté / drogue / immigration /
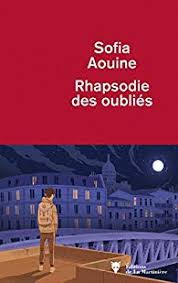
Posté le 14/10/2019 à 14:46
Les
parents de Mathilde tiennent un café, dans lequel certains soirs, son père se
met à l'harmonica et joue Frou frou, pour le plus grand plaisir de la
clientèle. L'établissement tourne bien, notamment grâce à la personnalité
charismatique de cet homme auquel Mathilde voue un amour éperdu, jusqu'au jour
où l'on lui diagnostique la tuberculose. Il est envoyé au sanatorium, bientôt
rejoint par sa femme, tandis que Mathilde et son frère sont hébergés dans des
familles d'accueil bien peu chaleureuses. Mathilde n'a de cesse de tâcher
d'aider ses parents qui ne peuvent bénéficier de la toute jeune Sécurité
sociale ni de la pénicilline qui pourrait les guérir, et de s'occuper de son
frère. Farouche et indépendante, celle que son père surnommait son "petit
gars" parvient à maintenir la cohésion familiale et à acquérir tout
doucement son indépendance.
Cinquante
ans plus tard, Mathilde revient au sanatorium. Le paquebot des années 30 a
disparu, n'en reste que des ruines taguées et des fenêtres brisées, mais les
souvenirs sont tenaces et féroces, tout comme l'adoration que la petite fille
vouait à son père, et qui aurait tant aimé danser avec lui les samedis soirs au
café. Un très beau récit sur l'amour filial.
Catégorie : Littérature française
maladie / hôpital / famille /
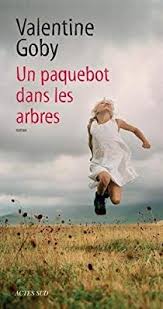
Posté le 21/08/2019 à 18:12
Fin
juillet 1890. Vincent Van Gogh agonise dans sa petite chambre de l'auberge
Ravoux, à Auvers-sur-Oise, d'une balle dans le ventre. On conclura à un
suicide. Mais rien n'est moins sûr, il pourrait bien s'agir d'un assassinat.
C'est la thèse que défend l'auteur, qui revient sur les derniers mois de la vie
du peintre, depuis son séjour à Arles et ses tentatives de créer un groupe
d'artistes, son admiration pour Gaughin, jusqu'à son internement puis son
arrivée à Auvers. Marianne Jaeglé évoque aussi l'enfance de Van Gogh, le
traumatisme initial de la perte de son frère aîné dont il porte le même prénom
et que ses parents emmenaient régulièrement fleurir la tombe, sa foi, ses
relations avec son frère Théo, sa terrible solitude et sa frénésie de peindre
le monde tel qu'il le voyait, dans un beau récit lumineux et fluide.
Catégorie : Littérature française
peintre / génie / solitude / folie /
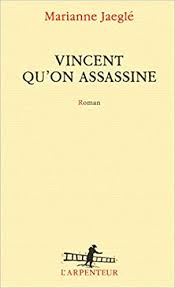
Posté le 21/08/2019 à 18:11
Michèle,
surnommée Michka, vieillit. Les mots commencent à lui échapper, elle les
oublie, ou les confond. Marie, celle qui tient dans sa vie le rôle de la
petite-fille, constate sa lente dégradation, d'autant plus insupportable que
Michka était correctrice pour un grand magazine. Mais avec les mots perdus,
c'est toute sa vie qui devient difficile, au point que Marie doit la placer
dans un EHPAD. Marie et Jérôme, l'orthophoniste, racontent en alternance les
derniers mois de Michka.
Ce
court roman, trop court peut-être, raconte à deux voix la dégénérescence
intellectuelle, et le désarroi de celle qui en est victime ; il dit aussi
l'affection qui unit les deux femmes, la complicité qui se noue avec
l'orthophoniste. Delphine de Vigan aborde ce thème grave de la fin de vie avec
délicatesse et parfois de la drôlerie qui fait pleurer lorsque Michka confond
les mots, en invente d'autres, disant le Catalogue des Trois Cuisses ou si pas
tant, même s'il est insupportable, pour une intellectuelle comme elle, de voir
les mots lui échopper, lui écharper : "A la fin, il n'y aura plus rien,
plus de mots, tu comprends, ou bien n'importe quoi, pour remplir le vide. Tu
imagines, un monospace… un monoglotte de vieille peau, toute solifère",
dit-elle à Marie. Après Les loyautés,
qui évoquait les promesses qu'on se fait à l'enfance, et qui sont le sel et le
poison de l'existence quand on essaie tout du long de leur être fidèle,
Delphine de Vigan aborde dans Les gratitudes
ce merci que l'on n'a pas toujours le temps de dire à ces rares êtres auxquels
on doit tant.
Catégorie : Littérature française
sénilité / vieillesse / famille /
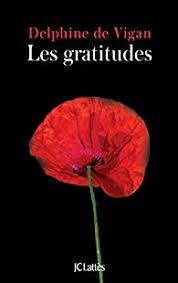
Posté le 21/08/2019 à 18:08
Julien
a grandi dans une cuisine. A 5 ans, il prépare la brioche du dimanche avec son
père, chef du "Relais fleuri". A 12, il fait la cuisine pour sa
colonie de vacances. Sa vocation est là, même si son père rêve pour lui d'un
tout autre avenir que celui où on embauche à 7 heures du matin pour finir passé
23 heures, et que ce sacerdoce va lui coûter sa vie de couple lorsque sa femme
Hélène part sans un mot. Julien n'en démord pas, et s'acharne à remettre la
main sur le cahier de recettes où son père a noté ses secrets et tours de main.
Il
y a plein d'amour dans ces pages : pour son père, qui est en train de mourir à
force d'avoir fumé ses Gitanes qu'il laissait se consumer sur un coin du piano
; pour la cuisine, qu'il entretient en réalisant des recettes paternelles, et
qu'il va choisir tout en menant des études de lettres, puisqu'il n'a pas eu le
droit de s'inscrire au lycée hôtelier ; pour Hélène dont l'absence se ressent
cruellement. C'est le roman de l'hommage d'un fils à son père, auquel il
s'adresse ; c'est aussi le roman d'un auteur amoureux de la cuisine, à
condition qu'elle soit bonne et sans chichis, mâtinée d'influences diverses et
basée sur un savoir-faire appris avec patience.
Catégorie : Littérature française
gastronomie / famille /
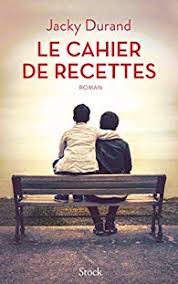
Posté le 21/08/2019 à 18:06
Un
homme brisé par le désespoir va saccager une église dont il séquestre le
prêtre. Son fils Benjamin a été victime de viols commis dans le cadre d'une
colonie de vacances organisée par des religieux. Il s'en veut de n'avoir pas vu
les choses et n'aspire qu'à se venger du prêtre qui a été placé dans une autre
paroisse.
Glaçant.
C'est le seul adjectif qui vienne en tête à la lecture de ce récit. Le père,
c'est à la fois le géniteur, mais aussi le prêtre. Ce sont les seuls mots que
le petit garçon a été capable de prononcer lorsque son mal être est devenu
évident. Le père de Benjamin, élevé par une mère pratiquante, cite les
Evangiles et fait un parallèle entre Isaac, le fils que Salomon a failli
immoler, et son propre enfant. Il fait le constat de son aveuglement et de sa
terrible impuissance. Benjamin s'en sort malgré tout, mais la question reste :
à quoi bon la foi, à quoi bon l'amour des hommes quand l'Eglise peine encore à
lever le voile sur des pratiques assassines ?
Catégorie : Littérature française
Eglise / pédophilie / famille /
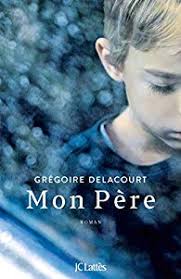
Posté le 09/08/2019 à 10:10
Maximilien
Médard, orphelin traîné d'une famille d'accueil à l'autre, travaille pour la
fourrière dont il explose les quotas. Un jour, il va un peu vite et emmène une
superbe Rolls Royce avant de s'apercevoir qu'elle est occupée par une très
vieille dame qui n'a plus toute sa tête et le prend pour son amant de jeunesse.
Aidé par Samira, son amie étudiante en pharmacie, Max parvient à lui faire recouvrer
ses esprits, si bien que la vieille dame, qui n'est autre que Madeleine
Larmor-Pleuben, fondatrice de la société de gâteaux du même nom, et qui,
sentant sa fin proche, a décidé d'opter pour le suicide assisté en Suisse, décide
d'en faire sa personne de confiance, puis son plus proche collaborateur. Un
moyen de se défaire de son neveu qui tente de lui extorquer ses parts de
l'entreprise. Voilà Max embarqué dans une nouvelle vie…
Raconté
par Max à un enquêteur, voilà un récit rocambolesque qui mêle gravité et
humour, un mélange que Van Cauwelaert connait bien. Abus de faiblesse, suicide
assisté, intérêts financiers, c'est du lourd que l'auteur traite avec légèreté
et finesse.
Catégorie : Littérature française
dépendance / vieillesse / amitié /
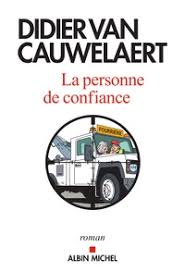
Posté le 15/07/2019 à 17:01
Isidore,
11 ans, est le seul enfant "normal" dans une fratrie qui se compose
de cinq autres enfants surdoués. L'aînée vit à paris et s'apprête à présenter
sa thèse, la deuxième est sur la même voie tandis que les deux frères sont
musiciens et sociologues. Isidore partage sa chambre avec sa troisième sœur,
qui en avance de trois classes lui demande d'écrire sa biographie. Isidore
quant à lui est un élève sans histoires, mais fait montre d'une sensibilité et
d'une maturité précoce. Pour exister dans cette famille exceptionnelle et
parfois désorientée, il se cesse de faire de courtes fugues qui lui permettent
peu-à-peu de s'affirmer, tandis qu'il tisse des liens autour de lui.
Isidore
est censé ne pas avoir hérité du gène familial de la haute intelligence. Du
moins se présente-t-il comme tel, sans qu’il paraisse en souffrir. Cependant,
au vu des conversations qu’il a avec sa sœur Simone ou avec d’autres
personnages, on est en droit de douter de ses capacités moyennes, tant il fait
preuve d’esprit et d’empathie. Et puis il vit, cet Isidore qui ne cesse de
faire des fugues ratées, il espère, il rêve, il découvre des choses et des
gens, et la vie, contrairement à ses frères et sœurs qui vivent davantage
repliés sur eux-mêmes. On suit donc l’évolution de ce jeune garçon fort
sympathique, malgré certaines longueurs au cours de ces quatre cents et
quelques pages qui rendent compte de l’entrée dans l’adolescence.
Catégorie : Littérature française
famille / surdoué /
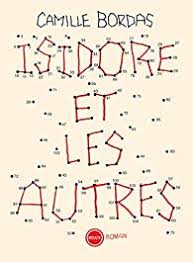
Posté le 15/07/2019 à 16:52
Une
famille modeste qui vit dans une zone pavillonnaire surnommée le
"Démo". Le père est un homme brutal, qui n’a que deux passions :
la chasse et la télé. La mère est un personnage falot et timide, qui passe son
temps à craindre son mari et à s’occuper de ses animaux. Quant aux enfants, ils
sont deux, une fille qui va entrer au collège, et son petit frère Gilles, qui
perd toute sa joie de vivre le jour où le glacier meurt sous ses yeux dans
l’explosion de son siphon à chantilly. La jeune fille décide alors de tout
faire pour rendre le sourire à son petit frère, tout en se passionnant pour les
sciences. Mais c’est sans compter avec la violence du père…
Un
récit raconté par les yeux d’une toute jeune fille, qui pourrait relever de la
littérature de jeunesse. A l’opposé du personnage ignoble du père, elle est une
véritable incarnation de l’optimisme et de l’intelligence. Après avoir compris
que son projet de fabriquer une machine à remonter le temps est impossible,
elle refuse de céder au désespoir et d’agir. Elle est sans doute la seule, au
sein de cette famille, à se comporter comme adulte. Mais le roman n’appartient
pas à au genre de la littérature de jeunesse : certes les thèmes - la violence
domestique, les surdoués, la liberté d’expression, les premiers émois amoureux
– et le ton du récit, d’une apparente naïveté, pourraient le faire croire, mais
les derniers chapitres s’adressent clairement à un public adulte ou à des
grands adolescents.
Catégorie : Littérature française
adolescence / famille / maltraitance / violence /
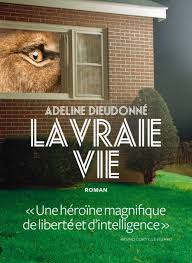
Posté le 15/07/2019 à 16:49
Laure a
rencontré Vincent via les réseaux sociaux. Ils sont devenus rapidement
complices et conversent quotidiennement par SMS. Et voilà Laure amoureuse d'un
homme qu'elle pense bien connaître mais qu'elle n'a encore jamais rencontré. Il
occupe ses pensées en permanence ; il suffit qu'il ne réponde pas immédiatement
à un de ses messages pour qu'elle soit en proie aux pires inquiétudes.
L'imagination lui fait vivre des fantasmes qu'elle espère bien pouvoir réaliser
lorsqu'ils prévoient enfin de se rencontrer.
A
travers le personnage de Laure, c'est le sentiment amoureux version 2.0, c'est Fragments d'un discours amoureux de
Roland Barthes revu à l'aulne des réseaux sociaux et des smartphones. Le récit
montre parfaitement l'enfermement de l'être amoureux, dont l'aliénation est
rendue encore plus forte à cause du smartphone. L'amoureuse écrit, beaucoup –
n'oublions pas que ce couple virtuel appartient aux classes intellectuelles et
possède une grande culture littéraire et cinématographique -, attend une
réponse que la technologie pourrait rendre immédiate, se désespère du silence ;
elle est disponible, en permanence. Il y a ici une double dépendance, à la
communication et à l'être aimé. On ne peut s'empêcher de la plaindre un peu,
Laure, tout en craignant secrètement de vivre semblable histoire.
Catégorie : Littérature française
passion / Internet / solitude
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
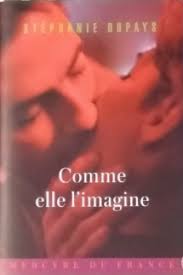
Posté le 15/07/2019 à 16:48
Francine
est âgée et veuve, coupée de sa fille avec laquelle elle ne s'entend guère.
Elle ne supporte pas de rester immobile et passe ses journées dans le bus. A
l'approche de Noël, au cours d'une de ses pérégrinations, elle rencontre Avril,
une jeune femme gothique perdue qu'elle surnomme la Bougie et prend sous son
aile. Mais elle est bien mal remerciée en retour, et renvoyée à son éternelle
solitude.
Un
joli portrait d'une femme terriblement solitaire, acariâtre et méchante, qui
pourrait paraître antipathique, mais
s'avère généreuse sous sa carapace. Le récit, qui ne fait pas l'impasse sur
l'enfance traumatisante de Francine, prend dans le dénouement des allures de
conte et, sans laisser de souvenirs impérissables, se lit avec
plaisir.
Catégorie : Littérature française
solitude / vieillesse / famille / amitié /
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
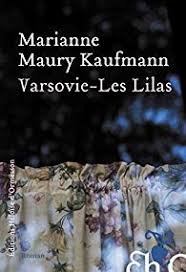
Posté le 15/07/2019 à 16:47
Ils s'appellent Antoine, Cédric, Samuel, Fred,
Greg, Sacha, Alex, Gilles, Abel, ils sont d'âge différents, rencontrent des
femmes, aiment ou sont quittés, ont des enfants ou souffrent de ne pas en
avoir. Loin des nouvelles à chute, l'auteur nous propose des tranches de vie,
dans une approche très réaliste, et probablement d'inspiration autobiographique
ou le fruit d'histoires qu'on lui a racontées. On retrouve certains des
personnages d'une nouvelle à l'autre, avec un autre point de vue. Cette idée
d'écho assez originale – les nouvelles sont en général au sein d'un même
recueil indépendantes les unes des autres – est évidente à travers la figure de
Samuel, que l'on retrouve par épisodes au fil du recueil, de son entrée en
sixième jusqu'au jour où il enterre la femme qu'il a aimée. A travers ces
récits courts, faciles à lire et écrits sans emphase, Pierre Théobald
s'interroge sur l'homme d'aujourd'hui, de ce qui le définit, son couple, sa
paternité : il n'y a pas un archétype de l'homme, mais des hommes, des boys,
qui font ce qu'ils peuvent, avec plus ou moins de bonheur.
Catégorie : Littérature française
nouvelles / homme /
Roman lu dans le cadre des "68 premières fois"
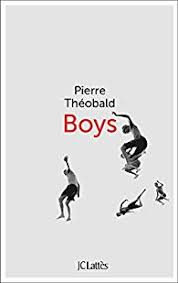
Posté le 15/07/2019 à 16:40
Manuel est schizophrène. Adolescent
difficile, adulte irresponsable, il n'a cessé de tourmenter ses parents qui s'endettent
pour payer ses dépenses exorbitantes, refusé de travailler ; souffrant de maux
de tête terribles, d'hallucinations diverses, il tente plusieurs fois de mettre
fin à ses jours, à coups d'overdose de tranquillisants, de coca et de tabac. On le sait fragile, malade, et à 28 ans, le
diagnostic tombe. Fasciné par sa nièce, il lui lègue l'œuvre sur laquelle il
travaille, un drôle d'héritage dont d'abord elle ne veut pas, des mots écrits de
façon illisible sur d'improbables petits papiers, qu'elle va entreprendre de
trier, tout en espérant échapper à la même maladie.
Le récit donne voix tour à tour à
Manuel et à Anaël, son double romanesque, ainsi qu'à Soledad, la nièce porteuse
de cet héritage maudit. Il nous fait entrer dans le monde étrange, déroutant et
violent de la schozophrénie. Manuel est un montre d'égoïsme, incapable de la
moindre reconnaissance, saisi d'accès de rage incontrôlable ; il est surtout
profondément malheureux, d'une sensibilité trop vive pour le rendre capable de
vivre en société et de se comporter en individu "normal", dans un
monde qui n'a pas su, pas pu lui venir en aide, à commencer par sa mère. En triant
ces notes éparses et folles pour en faire son roman, Sol Elias a rendu hommage
à cet oncle mal aimé et nous ouvre la porte sur un univers qu'on connaît très
mal.
Catégorie
: Littérature française
folie
/ famille / héritage / filiation
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
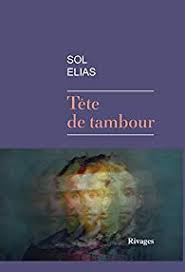
Posté le 27/05/2019 à 17:40
Au cours d'une soirée, O., le narrateur,
rencontre une jeune femme intrigante, acrobate de cirque, dont il tombe
éperdument amoureux. Leur relation dure quelques mois, le temps pour O. de
s'attacher suffisamment à elle pour que, le jour où elle disparaît sans laisser
aucune trace, il sombre dans un désespoir tenace, écoutant en boucle Poor Edward de Tom Waits et du fado
portugais. Six mois plus tard, il reçoit une lettre…
Roman
de la rupture, roman de l'absence et du manque de l'autre, ce récit est
empreint de sensibilité, de poésie et d'intelligence. Il fait appel aux mythes,
notamment celui d'Orphée et Euridice, qu'il revisite à partir du ballet de Pina
Bausch. "J'aime les livres où l'on danse.", écrit Olivier Liron dans
la postface intitulée Autoportrait,
où il donne les clés de son roman, d'inspiration biographique. Il écrit aussi
que "L'écriture n'est pas douce ou gentille ou mignonne. C'est la seule
violence capable de répondre à la violence. C'est une rage de vivre." Le
style d'Olivier Liron incarne parfaitement cette vision de l'écriture. C'est
ample, fluide, parfois lyrique, parfois trash, on y sent du vécu et des
convictions. Un très beau roman.
Catégorie
: Littérature française
amour
/ rupture / maladie /
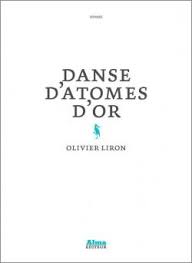
Posté le 27/05/2019 à 17:39
Professeur d'italien, Giula est mère de
trois enfants, auxquels elle a consacré sa vie et son énergie. Ils ont
désormais acquis suffisamment d'autonomie pour qu'elle puisse partir et se
rendre à Capri, dans la maison de Curzio Malaparte, pour écrire un livre
consacré à cet auteur. Au cours de son séjour, alors qu'elle est seule enfin,
libérée de ses obligations maternelles, elle s'interroge sur l'écrivain, auquel
sa mère, qu'elle n'a pas connue, vouait un véritable culte, et sur son statut
de mère. Faire des enfants était-il vraiment un choix ? N'aurait-elle pas rêvé
d'une autre vie, sans eux ?
A travers son roman, l'auteur rend
hommage à l'écrivain toscan, ainsi qu'à la maison où Godard a tourné Le Mépris. C'est aussi et surtout une
réflexion fouillée sur la maternité : sans craindre de choquer ou de passer
pour politiquement incorrecte, l'auteur fait dire à son protagoniste que si
c'était à refaire, elle n'aurait sans doute pas d'enfants. Non qu'elle ne les
ait pas aimés. Mais elle aurait vécu une autre vie, comme sa propre mère qui
est partie alors qu'elle était bébé, ce que lui dit son père : "Ta mère
n'a pas pu construite autre chose qu'un couple et pourtant elle a essayé, mais
le quotidien d'une vie domestique lui faisait peur, la responsabilité d'un
enfant aussi. Elle fait partie de celles et ceux qui ne considèrent pas le sacrifice
de soi comme étant la plus haute valeur morale […]." Saluons bas ce
courage de dire ce que certaines pensent tout bas sans oser l'exprimer, tant la
maternité semble aller de soi et l'instinct maternel rend capable de tout
accepter pour être une bonne mère.
Cela dit, l'introspection a ses limites, et
semble parfois tourner à une forme de complaisance. Giula finit tout de même
par trouver la paix avant de rentrer chez elle. Le récit aurait pu s'arrêter
là, , malheureusement l'auteur a cru bon d'ajouter un chapitre qui vient
apporter un dénouement un peu grossier et inutile à son roman.
Catégorie
: Littérature française
Italie
/ écrivain / maternité / famille /

Posté le 27/05/2019 à 17:39
Un vagabond prénommé Eli met le feu à
la maison dans laquelle il a vécu des jours heureux avec une femme aimée, avant
d'être recueilli par Louise. Laquelle a quitté les siens pour se consacrer aux
chevaux qu'élève un couple d'Américains. Le capitaine de gendarmerie Laurentin,
qui lui a fui quelque chose ou quelqu'un, est nommé depuis peu dans la région
qu'il sillonne avec ses chiens, tentant sans conviction de mener l'enquête sur
cet incendie. Autour d'eux gravitent d'autres personnages, Lison la veuve
inconsolable qui peine à s'occuper de ses deux garçons, Céline la vacancière
qui la console, Jean et Patrick, les deux frères sauvages et taiseux qui vont
tourner la ferme familiale. Ce roman polyphonique dit les âmes cabossées, les
écorchés vifs, les mal dégrossis ou les trop sensibles ; il fait la part belle
à la nature de cette région du Massif Central et à ceux qui y vivent, comme ils
peuvent plutôt que comme ils le voudraient. Certaines pages sont d'une grande
poésie, d'autres d'une grande justesse comme cette description du bal (p.94) où
la musique est assurée par un homme-orchestre qui "appauvrit tout à tour
Tino Rossi et Edith Piaf, leur soustrait toute sève, leur enlève toute portée",
et fait danser les vieux couples tandis que les jeunes n'ont que l'envie d'en
découdre. A travers les bouches de chacun de ces personnages se dessine une
histoire aux multiples méandres, jusqu'à un dénouement un peu onirique et, à
mon avis, quelque peu décevant.
Je ne résiste pas à l'envie de recopier l'extrait du bal :
"La nuit est tombée quand
l'accordéoniste prend place sur son fauteuil. Il a un clavier à main droite qui
lui permet de lancer des boucles d'orchestre préenregistrées. Il a des pédales
à ses pieds qui commandent une boîte à rythme qui fera bien ce qu'elle peut
pour donner naissance aux pulsations dont on a besoin ici pour triompher de la
fatigue. L'homme-orchestre se présente en crachant dans le micro, comme s'il en
était besoin, comme s'il n'écumait pas tous les bals de toutes les villes
environnantes depuis plus de dix ans déjà, comme s'il n'avait jamais pris part
à aucune des rixes qui y naissaient spontanément, inévitablement, comme si les
monts environnants n'abritaient pas les foulées hasardeuses de deux ou trois
rejetons élevés dans la haine de leur père oublieux. Il fait ce qu'il a
toujours fait. D'abord pour les plus vieux, pour ceux d'entre eux qui piétinent
doucement jusqu'au parquet-salon monté en plein milieu de la salle, sur lequel
les souliers glissent et rappellent à ces corps sclérosés les danses d'antan,
il appauvrit tout à tour Tino Rossi et Edith Piaf, leur soustrait toute sève,
leur enlève toute portée, pendant qu'on se presse aux deux bars. C'est comme ça
qu'on appelle les planches posées sur des tréteaux où on se sert canon sur
canon et on s'enflamme le sang parce qu'on déborde d'envie de lancer les
hostilités. Deux couples dansent serrés, oscillant doucement, joue fripée
contre mâchoire ravinée, et leur musique est trouée, chaque fois que la porte
se rouvre, par les coups de chevrotine du stand de tir." (p.94).
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
grands
espaces / deuil / famille / maladie /
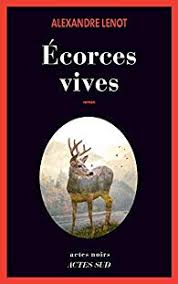
Posté le 24/05/2019 à 11:02
Au départ, c'est un désir brut, bestial, qui
demande à être assouvi immédiatement. L'objet du désir, c'est Suiza, une
étrangère quasi muette, aux "grands yeux vides de chien un peu con",
qui fait depuis son arrivée office de serveuse dans le bar du village et
suscite la convoitise de tous les mâles, Tomas compris. Ce dernier, qui vient
d'apprendre qu'il souffre d'un cancer des poumons, en crève d'envie, de
posséder cette femme idiote et passive. Eros et Thanatos. C'est tout
naturellement qu'il se l'approprie et l'installe chez lui. On pourrait
s'attendre à ce que son propriétaire s'en lasse rapidement : il n'en est rien.
Suiza est une véritable fée du logis, transformant le bouge où vit Tomas en une
maison accueillante, et s'avère ni attardée ni muette. Voilà Tomas qui emmène
la jeune femme au bord de la mer, et lui clame la nuit durant son amour tout
neuf et si fort, se trouvant "beau et bon", se prenant "pour le
fils spirituel de Garcia Lorca et de Rosalia de Castro". La jeune femme
s'est endormie et bave sur sa chemise.
A peine le lyrisme a-t-il atteint son
sommet que la réalité tout prosaïque l'en fait redescendre. Ce passage est tout
à fait représentatif du style de Bénédicte Belpois, qui mêle, de façon parfois
brutale, la beauté des choses et la cruauté du monde. Tomas n'a pas su aimer sa
première femme et se rattrape avec la seconde, dont on se demande si elle est
consciente de déchaîner une telle passion, s'y prend parfois mal mais se
dépense sans compter, dans le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Au moins,
pense-t-on, il aura connu l'amour avant de crever.
Dans son urgence à vivre, Tomas est-il
formidablement égoïste ? Le dénouement, qui laisse le roman dans un inachevé
volontaire et à mon avis un peu décevant, peut le laisser croire. Il n'y a ni
bons ni mauvais dans les personnages de ce roman, tout juste des victimes du
sort – si la vie était juste, cela se saurait – qui se débrouillent comme ils
peuvent. On peut reprocher aux hommes du village leurs réflexions machistes,
leurs préjugés, leur bestialité ; ils expriment une réalité que la candeur de
Suiza vient désarçonner et, malgré elle, dénoncer.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
Espagne
/ passion / maladie /
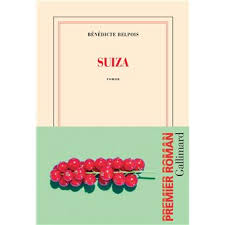
Posté le 10/05/2019 à 13:28
Gabriel, le jeune frère de Nathan, est
décédé dans un accident de voiture. Le jeune homme n'a pas revu sa famille depuis
de nombreuses années, si bien que Gabriel, qui n'avait que huit ans au départ
de son frère, est un mystère pour Nathan, qui essaie de comprendre ce qu'il
était devenu. Il se lie avec une troupe d'artistes entraînés dans le gymnase du
coin, et tombe amoureux d'Appoline, la petite amie de Gabriel. Il suit la
troupe dans un festival médiéval, partage les agapes d'alcool et de joints en
se demandant par bouffées fugaces s'il est à sa place. Gabriel tente de rattraper
le temps perdu et, par-delà la mort, de retrouver son petit frère, au point
d'essayer de vivre comme lui. Peine perdue pense-t-on, tant Gabriel reste une
énigme, et les regrets de Nathan poignants. La mélancolie est prégnante tout le
long de cette sorte de quête qui est surtout une recherche de lui-même.
Le départ en Bretagne de Nathan vient
clore cette quête éperdue et vaine, et permet au protagoniste – et au lecteur !
– de sortir de cette mélancolie un peu pesante, heureusement. Mais on a le
sentiment de passer à une toute autre histoire, jusqu'à la pirouette finale
assez peu convaincante.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
deuil
/ mort / famille / cirque /
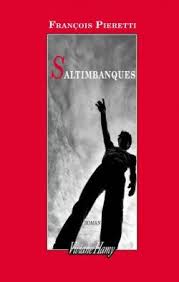
Posté le 10/05/2019 à 13:27
Louis a 3 ans quand il perd
accidentellement la vue. Encouragé par ses parents, le garçon va continuer à
aller à l'école, avant d'intégrer à 10 ans l'Institut des Aveugles à Paris. D'abord
très déçu par la piètre qualité de l'enseignement qui y est dispensé, et choqué
par les conditions de vie très difficiles des pensionnaires, il est malgré tout
le meilleur élève. L'arrivée d'un nouveau directeur va adoucir le régime des
élèves, et permettre à Louis de travailler sur ce qui sera le projet de toute
sa vie : une méthode d'écriture permettant aux aveugles de lire et d'écrire.
Au-delà de la volonté de rendre hommage
à Louis Braille, le roman met en scène Constance, dramaturge, qui est chargée
d'écrire le scénario d'un biopic consacré à Braille. Ce n'est pas vraiment une
écriture scénaristique d'ailleurs, mais un roman où le lecteur entre dans la
tête des personnages. Constance tient un journal dans un carnet rouge, dans
lequel on suit l'avancée de sa rédaction, et les interrogations de son auteur
sur les scènes à construire, sur les faits à mettre en lumière. Elle se prend
d'affection pour celui qu'elle appelle par son prénom, et lui donne corps et
âme. Et comme il s'agit d'un journal, nous pénétrons dans la vie privée de Constance,
qui souffre encore de la disparition de son mari. Cette mise en abyme donne une
dimension très humaine au récit. Elle avait pensé arrêter sa biographie aux 18
ans de Braille ; un événement plus qu'imprévu lui fait ajouter une dernière
scène, qui confirme, s'il n'était besoin, la nature profondément humaine de Louis
Braille.
Roman lu dans le cadre des
"68 premières fois"
Catégorie
: Littérature française
handicap
/ 19ème siècle /
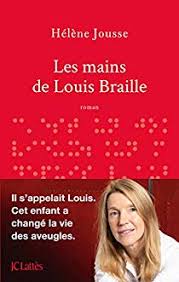
Posté le 02/05/2019 à 09:11